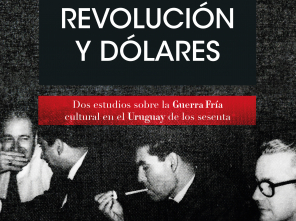Valérie Tesnière, Au bureau de la revue. Une histoire de la publication scientifique
(XIXe-XXe siècle), Paris, Éditions de l’EHESS, 2021.
Dès les premières pages d’Au bureau de la revue, le nouvel ouvrage de Valérie Tesnière apparaît appelé à susciter autant d’intérêt et rendre des services aussi précieux que ses recherches antérieures, à commencer par son étude de référence sur l’histoire de l’édition universitaire centrée sur le « Quadrige » des Presses universitaires de France1.
Si l’examen d’une œuvre doit mesurer en priorité l’adéquation de l’objet fini aux objectifs annoncés, force est de constater que le pari est tenu. Celui-ci consiste à prendre au sérieux l’objet « revue », dans un paysage scientifique qui fait la part belle à l’histoire du livre – un filon historiographique déjà ancien dont l’autrice reconnaît et manie adroitement l’héritage. Excédant l’ambition des monographies consacrées à une revue, ses auteurs et sa fonction dans la fabrique disciplinaire, Valérie Tesnière propose une étude des structures éditoriales de la publication scientifique aux XIXe et XXe siècles, doublée d’une histoire matérielle sensible aux interactions entre forme et contenu des périodiques. Soucieuse de rendre compte de l’économie de la connaissance dont les revues émanent autant qu’elles la construisent, cette perspective aborde le triangle rédacteurs-éditeurs-lecteurs armée d’un vaste éventail de sources primaires : correspondances, archives d’entreprises, catalogues commerciaux, procès-verbaux de sociétés savantes, prospectus et avant-propos de périodiques. Un impressionnant recensement de 1 385 titres publiés en France entre 1800 et 2002 sous l’intitulé de Revue, Bulletin ou Journal fournit une solide assise quantitative permettant à l’autrice de façonner son objet par-delà les fractures chronologiques et partitions disciplinaires. La revue elle-même est donc bien l’épicentre et le terme de l’étude.
L’ouvrage de Valérie Tesnière offre tout d’abord une galerie de profils originaux et méconnus : ainsi des frères Dalloz ou du chimiste Quesneville, dont la Jurisprudence générale et la Revue scientifique et industrielle se détachent au milieu d’un horizon d’agronomes, ingénieurs, juristes, chimistes et pharmaciens des florissantes sociétés savantes du premier XIXe siècle étudiées par Jean-Pierre Chaline et plus récemment par François Ploux. Capitalisant sur des pratiques stratifiées depuis l’époque moderne, comme en témoignent les utiles pages consacrées au Journal des sçavans ou aux plus anciennes Nouvelles de la République des Lettres, leurs entreprises éditoriales donnent ses lettres de noblesse à la revue, à la frontière des mondes de la grande presse et de la librairie générale. Ce processus remonte aux années 1830, où l’idée d’une science ouverte et aux prises avec le flux continu de l’actualité intellectuelle triomphe d’anciennes réticences quant à l’étalage public des savoirs (p. 59-60). Les revues connaissent alors un essor quantitatif et une diversification interne. L’heure est à l’amalgame, au sein de fascicules volatiles ou de recueils durables, de contenus variés, changeant de surcroît au gré des exigences disciplinaires – depuis les textes législatifs jusqu’aux signalements de découvertes archéologiques, en passant par les transcriptions de cours, miroir d’une pensée en éclosion2.
Plusieurs chapitres explorent ensuite la manière dont la spécialisation des pratiques savantes, en un XIXe siècle bourgeois que le « métier » obsède, déteint sur ce paysage. Revues et sociétés se résolvent à la sous-traitance : l’omnipotent « bureau de la revue » se déleste vers 1900 des tâches d’impression, de gestion commerciale, de bibliographie et de diffusion auprès de libraires et éditeurs qui, eux-mêmes, délèguent certaines fonctions, comme le service des abonnements, sous l’effet notamment d’une internationalisation croissante. L’alliance conclue entre le public des pairs et celui du « gens du monde » (p. 136) se délite. Le flot à double sens de contenus savants, qui autorisait jusqu’alors un vivier d’amateurs à remonter le courant de l’information scientifique pour porter ses découvertes aux revues, se réduit à un filet d’entre-soi universitaire et professionnel.
Mais tout n’est pas encore joué, au siècle finissant : de riches hybridations entre livre et revue persistent, tant dans les stratégies de publication que dans les catalogues spécialisés. Entre périodiques et collections scientifiques, des passerelles demeurent, comme le pratique avec succès la Revue philosophique de Théodule Ribot (p. 219-222). Le « directeur de publication » endosse encore un sacerdoce universel, que l’autrice signale sans en donner tout à fait la mesure – impressionnante en l’espèce, puisque, comme nous pourrions le rappeler, un mandarin tel qu’Alphonse Aulard inséra jusqu’à 293 articles et 1 353 comptes rendus dans sa revue La Révolution française, sur laquelle il eut la haute main entre 1887 et 1929… Vertige pour notre temps d’entraves multiples à l’écriture, ces chiffres caractérisent aussi et surtout un moment révolu du pouvoir éditorial, marqué par l’exorbitante hégémonie du directeur ou rédacteur principal des titres. L’autrice en rend notamment compte en évoquant la pratique de l’anonymat au tournant du siècle (p. 111-112). À ne pas se signaler, on signalait bien quelque chose : non pas un régime d’auctorialité lâche, mais la prépondérance absolue du primus inter pares, à la plume duquel on attribuait tacitement tout article sans signature. Nous ajouterions que cette pratique manifestait du même coup l’existence d’un microscopique milieu d’interconnaissance où l’anonymat ne pouvait être que de façade – personne n’ignorait, en lisant la Revue critique d’histoire et de littérature, que le « R. » figurant au bas de dizaines de recensions était la marque de l’érudit Rodolphe Reuss.
Cette autopsie de la revue se conclut enfin sur un constat de déliquescence contemporaine de l’objet. Le partenariat entre auteurs, revues et collections s’effile. Les années maigres de l’entre-deux-guerres ou de l’après-1945, couplées à la démocratisation universitaire, recentrent les éditeurs sur les supports de formation estudiantine, au détriment de revues moins lucratives. On grignote quelques francs à la marge : passage de l’in-octavo à l’in-quarto, économie de pages par la démultiplication des colonnes, facturation des surcoûts aux auteurs. L’équilibre entre ancrage national et ouverture transfrontalière suscite l’institution de niches éditoriales toujours plus différenciées, au besoin par une politique de filialisation comme le montre l’autrice à travers les éclairants exemples de Masson et d’Elsevier. L’internationalisation, le passage au numérique et la formalisation de systèmes de référencement favorisent enfin une spécialisation des contenus et une standardisation des formes éditoriales dont nous ressentons aujourd’hui les ultimes effets et dont nous déchiffrons mieux la sédimentation après ce salutaire éclairage.
Au sortir de ce siècle de routinisation dont l’autrice retrace le mouvement, la recension critique, qui s’autorisait tantôt des controverses hargneuses, déclarations d’amour savant et sursauts d’indignation politique, s’est elle-même normalisée. Sans doute devrions-nous donc sacrifier à cet exercice de binarité codifiée en formulant, après l’éloge, quelques critiques convenues de forme ou de fond, qui sont, pour la « jeunesse » historienne surtout, autant de professions de foi disciplinaires et déclarations de conformité intellectuelle. Nous pourrions alors relever gravement quelques écarts bien véniels au niveau de la sélection des cas analysés3, du système référentiel ou de quelques expressions inégalement heureuses4… À cet exercice inquisitorial ou scolaire (non pas que ces termes s’excluent), on préférera ici quelques réflexions inspirées par les questions que soulève ce stimulant ouvrage et par celles qu’il laisse en suspens.
En en retraçant l’évolution, Au bureau de la revue invite d’abord à un examen critique de la standardisation des formes et contenus des périodiques. Était-elle, est-elle irrésistible ? La « formation à la recherche » consiste aujourd’hui en un apprentissage des formes canoniques (l’article, la recension) dont la consommation (estudiantine) précède l’imitation (professionnelle), en un cycle fermé de reproduction du même. Tout occupé à incorporer le dogme, on en oublierait de palper sa foi. La forme « article », que nous avons tant naturalisée, est-elle pertinente en tout temps, en tout lieu ? Pour ne prendre ici qu’un exemple, les chercheuses et chercheurs investissant de nos jours le marché de la sociologie, où l’article tend à devenir la monnaie-refuge, s’étonneraient peut-être de lire que Durkheim avait renoncé à en publier dans sa propre revue, arguant qu’« en sociologie, le travail original prend plus naturellement la forme du livre que celle de l’article ; car, en ces matières où tous les faits sont solidaires et s’impliquent, et où la part de l’inexploré est si considérable, il est difficile que l’investigation se renferme dans des cadres trop étroits »5. Question annexe, et plus proche de notre actualité : au rythme effréné auquel vont les publications scientifiques, désormais transformées en nécessité alimentaire, l’article de circonstance – à la mode aujourd’hui, obsolète aussitôt – constitue-t-il encore, dans toutes les disciplines, un support favorable à la cumulativité des savoirs ?
La standardisation, par ailleurs, n’exerce pas un empire aussi général qu’il y paraît. Les revues qui dominent le champ ne sont souvent pas les plus empressées à croire les commandements de forme inscrits dans le marbre et à se faire un devoir de s’y soumettre – puisqu’elles pensent pouvoir les inspirer elles-mêmes. Ce sont précisément les Annales qui s’autorisent cette année un hétérodoxe numéro d’« autoportrait » de la revue, sans signature individuelle6. Aucun hasard non plus dans le fait que l’American Historical Review propose une rubrique « History Unclassified », ouverte à tous les formats, méthodes et même « explorations littéraires », tandis que tant de revues de « rang » inférieur pensent trouver leur salut dans le respect scrupuleux de décalogues formels.
La recherche historique était-elle si défavorisée, au XIXe siècle finissant, lorsque la Revue historique consentait, comme le rappelle Valérie Tesnière (p. 177), à publier des articles de vingt pages s’il en fallait vingt, cinquante s’il en fallait cinquante ? N’y a-t-il rien à garder des rubriques de « mélanges », « varia », « chroniques » dans lesquelles les collaborateurs signalaient leurs nouvelles et trouvailles sous des formes imaginatives, publiant jusqu’à des recensions en épigrammes ? Si, aujourd’hui, le besoin se fait parfois sentir de crever le plafond des X-000 caractères fixé par les revues, on gagnerait réciproquement à réintroduire les vieilles rubriques de « glanes » d’archives, où s’étalaient jadis des découvertes heureuses et surprenantes qui n’offraient pas en soi la matière suffisante pour un article. Il faudrait encore soulever, avec l’autrice, l’épineuse question des rapports entre les transformations contemporaines de la publication scientifique et la demande du lectorat (p. 368-369). Si, sans aucun doute, les revues qui se sont les premières pliées à cette normalisation à des fins de clarté éditoriale et de référencement électronique y ont gagné en visibilité, il y a lieu de se demander comment cette « demande » réagirait si jamais les supports de diffusion de la recherche se risquaient à tromper les effets de modes et faire preuve d’une inventivité formelle minimale.
À côté des questions qu’inspire ce foisonnant ouvrage, il en est d’autres qui sourdent de ses silences. Nous pensons plus spécifiquement à l’omission de certains enjeux relatifs à l’environnement économique des revues et aux rapports de pouvoir au sein de l’espace de production savante. Le poids de l’argent est pour l’essentiel soupesé au détour de considérations sur l’ébranlement de l’assise financière des revues autour de la Seconde Guerre mondiale, qui justifia un investissement croissant de l’État dans un domaine pourtant considéré par ses praticiens comme le terrain d’exercice d’une pure liberté scientifique. Mais combien coûtait à la fin du XIXe siècle un fascicule mensuel broché, un volume annuel in-octavo en reliure demi-cuir ? Et aujourd’hui ? Par quels sortilèges comptables une revue française de sciences humaines, dont ni les autrices et auteurs ni le comité ne sont rémunérés, se retrouve-t-elle en librairie à vingt, trente euros ou davantage ? Combien coûte un article sur Cairn sans abonnement, un autre sur Jstor, un abonnement d’Université à un bouquet de périodiques ? Qui peut se les permettre ? Qui doit se les permettre ? Combien de vacataires et d’ATER pourrait-on sous-payer avec ce budget ? Comment en est-on venu à ce que l’Université de Montréal et le CNRS doivent se désabonner d’une partie au moins du bouquet Springer ? Pourquoi voit-on des marque-pages Sci-hub et Libgen fleurir sur tous les navigateurs de nos collègues ? Combien coûte aux autrices et auteurs (et à l’État, qui les rémunère, voire prend l’investissement à sa charge) le passage de leur publication en open access ? Où sont, dans ces quatre cents pages, les mots « francs », « euros » ?
L’autrice évoque bien la gratuité des contributions aux revues, objet d’une rémunération « d’ordre symbolique » (p. 124), sans explorer plus avant ce modèle qui autorise Springer et Elsevier à prospérer sur le terreau d’un travail gratuit, institutionnalisé, généralisé, mais qui ne se dit jamais comme tel, puisque profit il y a, symbolique. Les producteurs, croit-on, semblent s’en satisfaire, puisque peu s’élèvent contre la propriété privée des moyens de publication – lorsqu’ils ne sont pas soumis aux avatars les plus récents du renversement des rôles éditoriaux, sous la forme mesquine du peer review à la charge du rédacteur, ou de la taxe de correction de leur anglais par des « partenaires » des revues ou des maisons d’édition. Assurément, pour les époques plus anciennes, la collecte de données financières est limitée par l’absence ou la difficulté d’accès aux archives des revues qu’ont pu rencontrer et regretter tous les chercheuses et chercheurs travaillant sur ces questions, et que l’autrice rappelle fort justement dès son préambule (p. 21-23). On trouve pourtant dans les revues du XIXe, qui émanaient souvent de sociétés savantes, les comptes de la société, y compris des données relatives aux prix d’abonnement en France et à l’étranger, aux frais d’impression, aux éventuelles souscriptions et subventions publiques, ainsi qu’au produit de la vente des volumes, qui auraient pu fournir la matière nécessaire à des études de cas ciblées.
Il est également difficile d’évoquer l’essoufflement de la science française, voire la provincialisation totale de certaines disciplines, en laissant de côté ces enjeux matériels. L’autrice constate les infidélités nationales des chercheuses et chercheurs résolus à voir paraître leurs travaux dans des « titres étrangers » – disons plutôt : états-uniens et britanniques – dans un contexte où l’internationalisation devient un facteur toujours plus discriminant de différenciation des carrières (p. 313). À l’évidence, les raisons n’en tiennent pas à une passion immodérée pour la langue anglaise, ni à une familiarité supérieure avec les revues « anglo-saxonnes », mais bien à la prépondérance scientifique de ces espaces, qui s’explique elle-même largement par des motifs financiers. Quel autre tour ces stratégies de publication prendraient-elles si les chercheuses et chercheurs de l’Université française pouvaient, comme d’autres, s’offrir le luxe d’assistants de recherche ou de commandes d’archives livrées sur leur bureau, ou si un ouvrage des éditions de l’EHESS n’arrivait pas sur les rayonnages d’une université de la Ivy League plus vite que sur ceux de la Sorbonne ? L’étude historique de la publication scientifique doit bel et bien s’arrimer à un présent qui n’est plus seulement celui du « capitalisme d’édition »7, mais bien du « capitalisme académique »8, porteur d’inégalités structurelles et structurantes, et de dérégulations de l’économie globale de la connaissance.
Enfin, le pouvoir. Il devrait figurer en bonne place dans l’ouvrage, puisqu’un opportun chapitre s’intitule « Fonctions de la revue » et démontre même comment, historiquement, « la revue devient un capital » (p. 79 sq.). Cédant à une forme de fonctionnalisme du meilleur, ce chapitre expédie assez vite la question du pouvoir symbolique, alors qu’il s’agit bien du nœud du problème, ce même problème qui rend, trop souvent, les revues détestables aux « jeunes » chercheuses et chercheurs. Le jeu, d’abord, n’est pas toujours payant : on connaît bien des noms, en sciences humaines, qui se sont faits sur des livres seuls, et plus en histoire qu’ailleurs, vu le rapport spécifique de cette discipline au public profane qui, jusqu’à nouvel ordre, ne lit pas nos articles. Comme on se garde bien de l’annoncer aux doctorantes et doctorants, des stratégies de publication tout à fait divergentes peuvent produire des renommées savantes et des positions presque équivalentes.
Présentées comme une onction obligatoire, les revues sont surtout un jeu de dupes. L’anonymat auto-proclamé des procédures d’évaluation est inégalement respecté selon les espaces et, lorsqu’il l’est, il ne l’est souvent qu’à-demi – si le nom est effectivement tu, le statut professionnel reste un secret mal gardé. Les jeux de réputation des revues ne se font pas qu’au prestige, lequel est d’ailleurs bien indépendant des systèmes d’évaluation et de classement des revues, du moins en sciences humaines. Ces réputations sont aussi indexées sur le traitement qu’elles réservent aux contributions. Savoir écrire un article vaut moins sur ce marché que la connaissance des revues qui ne publient pas les propositions de doctorantes et doctorants, voire ne publient qu’au sein d’un petit monde bien déterminé.
La variété des épreuves subies pour publier selon que l’on soit puissant ou misérable inciterait même à se demander si ce n’est pas la nature même de l’objet qui s’y trouve transformée. Un « article » commandé par une éditrice à une collègue ou un ami est-il bien la même chose qu’un « article » d’une doctorante ou d’un jeune chercheur rejeté par trois revues et défiguré par une quatrième – au point que les économistes tendent parfois à accorder plus de valeur à des working papers mis en ligne qu’à leurs versions déformées pour publication ? Est-ce la même chose encore qu’un « article » publié quatre fois dans des langues différentes, un « article » de mandarin destiné à en accompagner d’autres dans un recueil aux éditions du Seuil, ou un « article » de doctorant placé par une directrice de recherche dans sa propre revue ?
Ces réflexions libres doivent être lues comme un hommage rendu à la valeur du livre de Valérie Tesnière, lequel laisse la liberté de penser dans ses marges, sans prétendre clore ces lourds dilemmes en 400 pages comme le feraient d’autres auteurs, plus pressés ou moins scrupuleux. Ses réflexions sur la routinisation des pratiques éditoriales, la visibilité des contenus savants et l’évolution des rapports des revues à leurs environnements universitaire, éditorial, étatique et technique présentent un caractère d’urgence et offrent un point d’appui à l’exercice de la réflexivité collective sur ces matières brûlantes. Il ne manque à cette histoire de la publication scientifique qu’une histoire des coûts et profits de la publication scientifique, dont la question ne saurait manquer d’être soulevée en un temps où, si ce choix était sans effet sur leur curriculum, tant de chercheuses et chercheurs au stade d’accumulation primitive du capital savant renonceraient purement et simplement à publier dans les revues scientifiques.
Notes
1
Valérie Tesnière, Le Quadrige. Un siècle d’édition universitaire, 1860-1968, Paris, PUF, 2001.
2
Une légère nuance sur ce point : contrairement au diagnostic de disparition, vers le tournant du siècle, de la section des revues consacrée à la vie scientifique, au besoin par une partition des publications des sociétés savantes entre un Journal scientifique et un Bulletin d’actualité (p. 165, 189), nous observons pour notre part dans les revues d’histoire une permanence de ces newsletters disciplinaires jusque dans l’entre-deux-guerres. Vers 1930, la Revue d’histoire moderne informe encore son lectorat de la tenue des congrès nationaux ou internationaux, des décès et soutenances de thèse, de l’apparition de nouveaux périodiques, des évolutions de la politique archivistique, des attributions de chaires, des prix décernés aux livres d’histoire et des réunions de certaines sociétés-sœurs.
3
On s’interroge par exemple sur le statut des développements relatifs au Neues allgemeines Journal der Chemie, au Law Journal ou aux presses universitaires anglo-saxonnes (p. 183, 186, 267 sq.), dans un ouvrage qui assume sa perspective nationale et aborde ces exemples comme des études de cas plus que comme des points de comparaison transnationale. Certaines sous-parties se trouvent par ailleurs consacrées à l’analyse d’une unique citation (p. 70-72) ou au développement d’un exemple de troisième main (p. 79-81, 300-303). Plus fondamentalement, on ne se satisfait qu’à moitié de savoir qu’un exemple est « intéressant » (p. 167, 170) ou qu’un cas constitue « un exemple parmi d’autres » (p. 183, 205) sans que la spécificité en soit explicitée.
4
Une moyenne de 36 notes par chapitre pourra sembler un peu courte à un lectorat tatillon, bien que les contraintes éditoriales du volume soient sans doute à blâmer. Enfin, on se demande s’il faut lire du légitimisme ou une ironie inattendue sous les intitulés de « fleurons » ou de « lumières de la science française » (p. 298, 306).
5
Émile Durkheim, « Préface », L’Année sociologique, t. XI : 1906-1909, 1910, p. I-II.
6
Comme ont voulu le faire encore récemment un certain nombre de revues des plus légitimes, aux articles signés ou cosignés du nom collectif « Camille Noûs » – voulu, ou prétendu, tant il était loisible aux lectrices et lecteurs de retrouver l’identité de chaque « Camille ». Noûs sommes bien peu de choses, face au référencement électronique et au capital symbolique.
7
Jean-Yves Mollier, L’argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition, 1880-1920, Paris, Fayard, 1988.
8
Parmi d’autres titres : Sheila Slaughter, Gary Rhoades, Academic Capitalism and the New Economy. Markets, State, and Higher Education, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2004 ; Richard Münch, Academic Capitalism. Universities in the Global Struggle for Excellence, New York, Routledge, 2014 ; Christophe Charle, Charles Soulié (dir.), La Dérégulation universitaire. La construction étatisée des « marchés » des études supérieures dans le monde, Paris, Syllepse, 2015.