(Université de Lorraine - Centre de recherche sur les expertises, les arts et les transitions (CREAT))
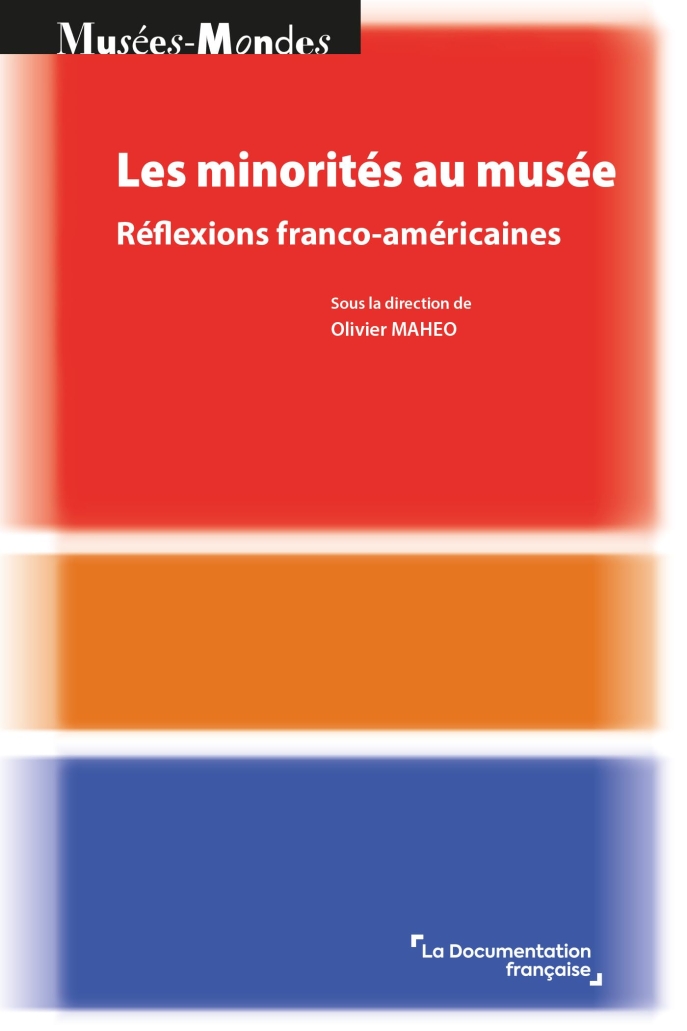
Olivier Maheo (dir.), Les minorités au musée. Réflexions franco-américaines, Paris, La documentation française, collection « Musées-Mondes », 2024.
L’attention portée, depuis les années 1980, par les anthropologues, historiens et chercheurs en Cultural Studies envers ce que Foucault a nommé les « contre-mémoires » a considérablement contribué à reconfigurer les modalités de la mémoire publique. Elle s’est orientée vers des discours sur le rapport des groupes sociaux au passé, une historicité fondée sur les voix et les expériences vécues racontées par ceux et celles dont l’histoire a convenablement oubliés – ces « gens ordinaires » que furent les femmes, les travailleurs et les minorités ethniques et racisées. Les historiens sociaux de la culture se sont par ailleurs rapprochés des acteurs sociaux – tels que les centres culturels et les unions de travailleurs – désormais reconnus comme des agents de l’histoire, bien que toujours subalternes1. Aux côtés des chercheurs, les professionnels des musées et du cinéma se sont rapidement associés aux historiens et anthropologues pour promouvoir de nouvelles pratiques de représentation visant à faire émerger une histoire sociale vivante – sous forme de documentaires, d’expositions et de films – issue d’un militantisme en faveur d’une histoire plus inclusive, constituée d’une multitude d’« autres », et résolument anti-hégémonique2.
Ce tournant vers une histoire publique engagée et de plus en plus militante a contribué, ces dernières années, à faire émerger un regard toujours plus critique sur les acteurs nationaux – notamment les monuments et les musées – encore perçus aujourd’hui comme profondément ancrés dans des héritages coloniaux, perpétuant leur rôle d’arbitres incontestés de la mémoire collective3. En effet, l’attention se porte aujourd’hui autant sur ce qui est raconté que sur ce qui ne l’est pas – les silences et omissions révélant une amnésie sélective ainsi que les mécanismes par lesquels mythes et récits nationaux continuent de perdurer au sein des institutions publiques4.
Les musées doivent reconfigurer et remodeler leurs récits, leur créativité et leur structure organisationnelle pour rendre compte de nos sociétés de plus en plus multiculturelles, pluralistes et mondialisées. Ils doivent répondre à une demande croissante visant à faire de ces institutions des acteurs engagés, capables de stimuler le dialogue sur les enjeux sociétaux contemporains tout en promouvant l’engagement et la participation citoyenne. Surtout, ils doivent devenir un espace mettant en valeur les expériences et les points de vue de différents groupes sociaux, un lieu où le contenu est nourri et déterminé à parts égales par la recherche scientifique et par un travail direct avec les collectivités, les publics de proximité et les communautés sources – et ce, malgré les défis et débats persistants que cela peut impliquer.
Cela revêt une importance particulière, d’autant plus que ces dernières années, un nouveau phénomène émerge : la mise en œuvre d’une mémoire transculturelle, caractérisée par des processus de souvenir et d’oubli situés dans et autour de ce qu’Astrid Erll a désigné comme les multiples contours flous des cultures et politiques nationales de la mémoire. Ces mémoires partagées, à l’ère de la mondialisation, issues des déplacements, du commerce, du colonialisme et d’autres formes d’échanges culturels, mettent en lumière la grande hétérogénéité des cultures nationales – qu’il s’agisse des différentes classes sociales, générations, ethnies, communautés religieuses ou « sous-cultures » – lesquelles génèrent des cadres de mémoire variés, en constante interaction les uns avec les autres5. C’est dans ce contexte que les mémoires migrantes, ainsi que les mémoires et identités diasporiques, ont acquis une place significative, devenant des éléments centraux pour éclairer les grands enjeux sociétaux à l’ère de la mondialisation, notamment ces récits de déplacements et de déplacés, souvent relégués aux marges de l’histoire.
L’ouvrage collectif Les Minorités au musée. Réflexions franco-américaines, dirigé par Olivier Maheo, collaborateur scientifique à l’Institut d’histoire du temps présent, constitue un point d’entrée rigoureux et original sur une pratique muséale en pleine mutation et qui s’inscrit dans ces mouvances mémorielles. Une pratique qui tend à placer au cœur de son action les contre-mémoires et les voix subalternes, lesquelles se négocient et se reconfigurent à l’échelle internationale, souvent en marge des politiques nationales de la mémoire. Ce livre explore également comment, dans et autour des musées aujourd’hui, émergent de nouveaux dialogues avec, pour et par les acteurs sociaux impliqués dans la reformulation et la réaffirmation de stratégies innovantes de contestation et de visibilité.
Issu d’un colloque tenu à Paris en 20226, cet ouvrage propose une étude comparatiste des pratiques et « traditions muséales » en France et en Amérique du Nord. Il s’inscrit dans une lignée d’études comparatives entre la France et l’Amérique – en particulier les États-Unis – qui ont proliféré depuis les années 2000, dont des colloques consacrés aux multiples métamorphoses des musées des deux côtés de l’Atlantique. Parmi ceux-ci, on peut citer, entre autres, le colloque Migration, mémoire et musée : regards croisés France/États-Unis, organisé en 2005 à Carlisle, en Pennsylvanie, par le Clarke Center du Dickinson College, en collaboration avec le laboratoire Framespa-Diaspora de l’université Toulouse Jean Jaurès, dont l’objectif portait à approfondir les approches comparatistes et étudier les expériences musées autour de la représentation de mémoires migratoires7.
Plusieurs éléments distinguent Les minorités au musée d’autres colloques et publications sur le sujet, témoignant à la fois de son originalité, de sa spécificité et du changement d’époque qui s’opère aujourd’hui par rapport au début des années 2000. Tout d’abord, outre d’élargir le champ d’analyse au Canada – Québec surtout –, cet ouvrage figure parmi les rares à se focaliser explicitement sur la notion de minorités. Bien que de nombreux travaux aient été publiés ces dernières années, en français ou en anglais, sur les relations entre musées, patrimoine et des concepts clés tels que la diversité, les publics empêchés ou la médiation culturelle, peu d’entre eux ont abordé de manière exclusive et approfondie la question des minorités. Cela est d’autant plus important alors qu’en France les politiques fondées sur l’universalisme ont historiquement dissuadé la reconnaissance des groupes minoritaires. Aux États-Unis, le mouvement pour la défense des droits civiques à partir des années 1960 a ouvert la voie vers de nouvelles opportunités pour rendre visible les histories de certains groupes minoritaires. Il n’en reste pas moins que d’importants défis persistent toujours en matière de représentation des minorités dans un pays où les tensions liées à un passé (et un présent) marqué par la discrimination se sont considérablement intensifiées ces dernières années, notamment autour de mouvements tels que Black Lives Matter. Bon nombre d’études ont également mis en évidence le manque de diversité et de représentation des minorités au sein des structures des personnels des musées américains, en particulier dans les postes décisionnels. Ces repères historiques et sociopolitiques, ainsi que les récentes manifestations contre le racisme et la discrimination, sont présentés de manière éloquente dans l’introduction de l’ouvrage et offrent au lecteur un terrain fertile pour analyser et comparer leur impact transformateur sur les musées et les monuments aujourd’hui.
Malgré toute la complexité inhérente à la notion de minorités, l’ouvrage propose néanmoins une définition fixe. Plutôt que d’ouvrir le sujet à une longue discussion théorique, les auteurs ont volontairement choisi de fournir un cadre conceptuel et fonctionnel qui permet une compréhension commune dès l’introduction et autour duquel ses auteurs et autrices semblent s’entendre d’emblée. Cette définition, adoptant une approche anthropologique et sociologique, désigne, comme le soulignent Olivier Maheo et Pauline Peretz dans l’introduction, « la mise à l’écart de certains groupes, cantonnés aux marges de l’histoire, exclus ou, au mieux, tenus à distance du récit majoritaire. Faire partie d’une minorité – ethnoraciale, de genre, nationale, religieuse… – implique un mode discriminé ou excluant de participation à la communauté nationale. Les minorités sont perçues et définies par le groupe majoritaire selon deux principes qui ne s’excluent pas : celui du nombre mais aussi celui du statut, tenu pour mineur, renvoyé à la mémoire des vaincus » (p. 12).
Les auteurs reconnaissent la nature polysémique et complexe de la notion de minorités. La mise à l’écart et la discrimination fondées sur des critères de nombre, mais également sur le statut revêt ici une importance particulière. En effet, un groupe peut demeurer minoritaire même lorsqu’il est en nombre dominant, dès lors qu’il manque de pouvoir de représentation. Même si les auteurs ne le présentent pas en ces termes, choisissant de se limiter plus spécifiquement aux minorités ethno-raciales, c’est précisément ce déficit de pouvoir qui constitue l’un des fils conducteurs de l’ouvrage pour y dévoiler les multiples stratégies mises en œuvre, dans et autour des musées, pour renverser les rapports de force dominant/dominé (au sens sociologique de prédominants versus subalternes) dans l’acte de représenter, au bénéfice des groupes minoritaires.
Cela nous conduit à un autre élément distinctif qui apparaît en arrière-plan de l’ouvrage : la pensée décoloniale, qui occupe aujourd’hui une place de plus en plus prépondérante dans les sphères muséale et patrimoniale, tout comme dans les sciences humaines et sociales en général. Cette approche traduit une volonté de rompre avec les asymétries profondément enracinées dans la production des savoirs, notamment l’hégémonie des approches et théories eurocentriques ou euro-américaines perçues comme des legs coloniaux8. Une telle approche caractérise aujourd’hui une pratique qui se mobilise pour dénormaliser, déstabiliser et décentrer le discours muséal, afin de favoriser une plus grande participation des voix marginalisées – et, ainsi, promouvoir une polyphonie au sein du musée9.
Olivier Maheo et Pauline Peretz proposent une approche singulière qui est tout à fait en phase avec une pensée/pratique décoloniale : celle de « déplacer le regard » (p. 13) pour adopter une perspective minoritaire. L’objectif est de mettre en lumière et de comprendre les diverses mobilisations, revendications et démarches visant à faire usage du patrimoine et des musées comme outils d’autodétermination (empowerment) et de reconnaissance. Une petite nuance s’impose tout de même : le regard (pris au sens de positionnalité) demeure néanmoins fondamentalement académique. L’ouvrage rassemble principalement des universitaires – enseignants-chercheurs, doctorants et jeunes docteurs – ainsi que quelques professionnels des musées et du patrimoine. À quelques exceptions près, les voix et les actions militantes des groupes minoritaires y sont relayées par celles des chercheurs et chercheures, la plupart non issus minorités (sauf quelques-uns). Cela ne remet en rien l’exceptionnelle qualité ni la pertinence des vingt-et-un chapitres répartis en quatre sections dans un ouvrage qui privilégie une approche monographique. À l’exception d’un texte théorique situé à mi-parcours, ainsi que de l’introduction et de la conclusion, tous les chapitres présentent des études de cas, dont la majorité s’appuie sur l’analyse des stratégies de représentation, de mémorialisation et des discours muséographiques, incluant bon nombre contributions sur les relations, revendications et nouvelles stratégies de représentation élaborées avec, pour et par les communautés sources (notamment les groupes autochtones et leur rapport au patrimoine).
Afin de resserrer l’analyse, l’ouvrage se concentre sur le développement des musées de société comparée à celui de leurs équivalents aux États-Unis et au Canada, les musées communautaires (community museums, également appelés culturally-specific museums dans l’ouvrage). Cette approche constitue une originalité notable, car elle permet d’approfondir la compréhension de ces types de musées à une échelle internationale. Les musées de société, ou de « civilisation », ont émergé dans les années 1990 comme des institutions interdisciplinaires adoptant une perspective holistique sur les territoires et les sociétés, tout en valorisant un travail collaboratif et inclusif avec leurs publics10. L’ouvrage éclaire et compare leurs importantes transformations, notamment en situant la transition progressive qui s’opère ces dernières années des musées d’ethnographie vers des musées de cultures du monde. En contexte américain et canadien, il contribue également à cartographier la création et le développement des musées communautaires. La majorité de ces musées ont vu le jour dans de grandes zones urbaines, souvent situées dans des quartiers historiquement associés à des groupes ethniques spécifiques. L’introduction d’Olivier Maheo et Pauline Peretz, tout comme le reste des chapitres, retrace l’histoire de ces musées en tant qu’agents d’une contre-mémoire, ayant progressivement – et souvent difficilement – acquis une place pour contester l’hégémonie de l’histoire monolithique nord-américaine.
La structure de l’ouvrage est divisée en quatre parties. La première, « Mobilisations patrimoniales », explore les différentes manières dont les minorités se sont approprié les musées et les sites patrimoniaux pour lutter en faveur d’une plus grande visibilité dans les imaginaires nationaux et politiques. Les contributions de cette section analysent successivement : les mobilisations des groupes arméno-américains pour la mémorialisation et la patrimonialisation du génocide arménien du début du XXe siècle, à travers la création de musées, de monuments et de maisons historiques (Anouche Der Sarkissian et Julien Zarifian) ; les efforts d’autodétermination des communautés de la nation Cherokee, visant à défendre « la possibilité pour tout peuple indigène d’interpréter son passé et de décider de son avenir » (p. 49), par la création et la gestion de musées de plein air (Barry L. Steifel) ; les avancées en recherche de provenance et l’implication des groupes autochtones au Canada dans les procédures de rapatriement (Carole Delamour) ; enfin, l’analyse de la démarche artistique de l’artiste amérindien cri Kent Monkman, en tant que pratique activiste destinée à décentrer l’histoire de l’art occidental, où ses œuvres sont intégrées dans des stratégies –visiblement politiques– d’invitation et d’intégration de l’artiste dans des programmations d’expositions temporaires, notamment dans le cadre de commémorations, l’une au Musée d’art de l’université de Toronto, l’autre au Centre culturel canadien à Paris (Beatriz Martinez Sosa).
Si la première partie explore, dans un cadre plus large, les tensions entre les gouvernements, les politiques et pratiques locales, et les actions d’autodétermination des groupes marginalisés, la deuxième partie, « Représentations de soi », se concentre sur les pratiques et dispositifs muséographiques développés dans quatre musées communautaires aux États-Unis pour renverser les perspectives. À la Nouvelle-Orléans, la Whitney Plantation réoriente le regard vers l’histoire de l’esclavage et des esclaves, devenant ainsi un véritable « lieu de mémoire pour les Afro-descendants dans un processus de réappropriation d’un espace d’oppression » (p. 96) (Melaine Harnay). L’histoire de l’esclavage et des personnes esclavisées est également au cœur de la première exposition permanente du Smithsonian National Museum of African American History and Culture, à Washington D.C. (Ana Lucia Araujo). Le musée ainsi que son exposition reposent sur la mise en récit d’objets de collection acquis auprès de citoyens afro-américains et de membres de la diaspora africaine, incluant certains objets fabriqués et utilisés par des personnes esclavisées. Dans les réserves des nations Oneidas et Mohicans, dans le Wisconsin, les musées, mémoriaux et pow-wows (rassemblements estivaux dans les réserves), comme le décrit Karim M. Tiro, font usage de « leur histoire de la guerre de l’Indépendance pour revendiquer une place d’honneur dans le récit plus large de l’histoire américaine, et pour souligner certaines de leurs valeurs et leur identité » (p. 123).
Les deux derniers chapitres de cette section analysent deux projets muséologiques, l’un aux États-Unis, l’autre en France, développés en réponse au contexte politique et social difficile qui a suivi les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ainsi, aux États-Unis, l’Arab American National Museum a adopté des stratégies centrées sur la participation et le dialogue (Dominique Cadinot), tandis qu’en France, le département des Arts de l’Islam du musée du Louvre, créé en 2002, s’est initialement orienté vers des approches curatoriales et des programmes de médiation destinés aux communautés musulmanes « dans un esprit de promotion d’un patrimoine commun » (Constance Jame). Le contraste entre ces deux études de cas est particulièrement révélateur des réflexes et pratiques muséologiques de part et d’autre de l’Atlantique, mettant en lumière une distinction notable : en France, les pratiques muséologiques s’appuient fondamentalement sur l’objet, tandis qu’aux États-Unis, elles tendent davantage (bien que non exclusivement) à privilégier la mémoire et la participation citoyenne.
La troisième partie, « La fabrique du discours muséal », se concentre sur des « contributions depuis un point de vue professionnel » (p. 31) dans lesquelles les chercheurs proposent un regard critique plus spécifique sur les pratiques d’exposition et de collectionnement. Une contribution de Gaëlle Crenn examine trois expositions aux États-Unis sur l’internement des Japonais-Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Deux sont des expositions permanentes dans des musées d’État, alors que la troisième est une exposition temporaire présentée dans un centre associatif. Ensemble elles mettent en évidence l’articulation complexe entre récit national et histoires vécues et difficiles qui sont encore enracinées dans les communautés. La lecture du chapitre permet de souligner également la flexibilité évidente des expositions temporaires pour des pratiques muséologiques militantes. Une analyse comparative de Andréa Delaplace explore ensuite les mémoires migrantes dans deux musées new-yorkais, le Ellis Island Migration Museum, qui privilégie une approche plus historique, et le Tenement Museum, qui privilégie une pratique muséographique centrée sur l’histoire récente et fondée sur les principes d’une politique de diversité. Trois autres chapitres interrogent respectivement les « nouveaux modes de monstration » (p. 187) des collections nord-américaines dans des musées en France et aux États-Unis (Mathilde Schneider), les mémoires de l’esclavage traitées par un projet en recherche-création photographique (Nicola Lo Calzo), et la place des arts autochtones dans les musées d’art canadiens (Julia Etournay-Lemay). La section se conclut par un chapitre théorique de Fabien van Geert – qui fait office de préface pour la section suivante –, proposant un modèle pour évaluer le rôle social des musées, contextualisé par les transformations, défis et possibilités liées à la nouvelle définition du musée adoptée par l’Icom en 2019.
La quatrième partie, « Coproduction et dialogue », rassemble un ensemble de chapitres qui mettent en lumière des pratiques muséologiques entièrement dédiées au travail participatif avec les citoyens, dans un esprit de partage des savoirs et de remise en question de « l’autorité muséale ». Les contributions présentent une série de projets menés au Québec et en France. Le premier, par Ève Lamoureux et al., porte sur le projet de recherche participative InterReconnaissance, qui a réuni chercheurs et activistes pour étudier les mouvements communautaires au Québec. Ce projet a donné lieu à des expositions et des initiatives de médiation fondées sur la coconstruction et la participation, dans une démarche avec, pour et par les groupes marginalisés.
Un autre chapitre de Geneviève De Muys et al. examine les politiques d’inclusion et de collaboration avec les peuples autochtones au Musée de la civilisation à Québec. Cette institution s’inscrit dans une pensée décoloniale, marquant son engagement à repenser son mode de fonctionnement et son modèle organisationnel de dotation en personnel. Parmi ces initiatives figure la création d’un poste permanent de conseiller aux affaires autochtones, chargé notamment d’animer un nouveau comité permanent composé de représentants de 11 nations autochtones du Québec. Ce comité assure un dialogue continu et une autorité partagée sur les projets futurs du musée.
Enfin, le chapitre de Elikya Kandot et Justine Vambre sur l’expérience du musée de Boulogne-sur-Mer, en France, dans ses relations et coopérations avec les communautés Kodiak, en Alaska, est tout aussi riche. Il met en lumière un véritable effort de dialogue et de coconstruction de politiques de collectionnement durables, centrées sur la mise en visibilité et l’accession dans les collections françaises d’œuvres d’artistes contemporains Kodiak. Un autre chapitre de Alina Maggiore présente les étapes conception collaborative derrière l’exposition Barvalo au Mucem qui s’est donnée pour défi d’une création avec la participation de « personnes engagées par la recherche, le militantisme, ou la pratique de l’art dans des projets de reconnaissance, de justice, ou de valorisation culturelle des populations romani » (p. 287). Dans ce chapitre, tout comme c’était le cas pour celui de l’expérience du Musée de la civilisation, l’auteur partage autant les succès tout comme les défis encourus lors du projet, ce qui constitue une réelle plus-value pour le lecteur. Enfin, dans un texte plus académique pour cette section, mais tout autant fascinant, Vanessa Ferrey, à travers une étude de la collection nord-américaine du marquis de Sérent, explore la production de nouveaux cadres épistémiques à travers l’invitation qu’elle aborde comme « geste de pluralisation de savoirs au musée ».
Les chapitres sont remarquablement bien rédigés et documentés, enrichis par des illustrations de qualité. Il convient également de souligner la présence de textes d’auteurs anglophones, dont la qualité rédactionnelle témoigne du travail de traduction minutieux réalisé par Olivier Maheo. L’accent mis sur les discours muséographiques crée par moments quelques zones d’ombre qui peuvent laisser le lecteur sur sa faim. Par exemple, certains chapitres mentionnent le « comité organisateur » des expositions sans fournir davantage de précisions. Ces éléments, pourtant essentiels, auraient permis de mieux cerner les spécificités de la construction du « regard » du musée. Cela reste toutefois un détail, et peut-être même une stratégie délibérée de l’ouvrage, puisque ces questions sont abordées de manière approfondie dans la section « Coproduction et dialogue ».
L’approche comparatiste est par ailleurs très riche, bien qu’on puisse regretter par moments l’absence de conclusions pour les différentes parties ou à la fin de l’ouvrage. Une synthèse aurait permis de regrouper les principaux enjeux et pratiques évoqués. Ce choix laisse néanmoins au lecteur une grande liberté d’interprétation tout au long des études de cas. Enfin, la conclusion offre une ouverture stimulante sur des dynamiques plus larges, prolongeant ainsi la réflexion amorcée dans l’ouvrage. Signée par deux figures de proue des études sur le patrimoine, Yves Bergeron, spécialiste du développement de la muséologie francophone et québécoise, et Bruno Brulon Soares, en muséologie latino-américaine et acteur clé dans la redéfinition du musée par l’Icom, elle offre une analyse rétrospective et croisée sur la manière dont les musées participent à la création et à la perpétuation de mythes et de récits nationaux. Selon les auteurs, ces récits, bien éloignés de la réalité, sont construits et embellis, tout en étant partagés et transmis au sein des communautés muséales sur de longues périodes historiques (p. 310). Ils reviennent également sur les fondements de la pensée décoloniale, et ses liens avec les revendications pour une muséologie décolonisée en Amérique latine et ailleurs depuis les années 1970. Au cœur de cette pensée décoloniale se trouve l’importance de reconnaître les multiples formes de savoir coexistantes, qui reflètent la diversité des manières de penser et de vivre le monde. La pensée décoloniale implique une rupture avec la mentalité occidentale de production de savoir et un effort pour parvenir à un « pluriversalisme hétérogène11 ».
Les Minorités au musée. Réflexions franco-américaines offre un panorama essentiel pour les chercheurs, étudiants et professionnels des musées et du patrimoine, en explorant les représentations des minorités aux États-Unis, au Canada et en France. Cet ouvrage contribue également à la réflexion sur la manière dont se construisent et se négocient des formes de mémoires, contre-mémoires et résistances transculturelles au sein des musées et des réseaux patrimoniaux, désormais inscrits dans un dialogue international. Celle-ci s’inscrit dans une revendication partagée par de nombreux muséologues ces dernières années : celle de reconnaître et aborder « les profondes inégalités sociétales et les asymétries de pouvoir et de richesse – à l’échelle mondiale, mais aussi au niveau national, régional et local12 ».
Comme l’écrivait Pierre Mayrand :
« Aujourd’hui, le rouleau compresseur de la mondialisation oblige le muséologue à unir son énergie à celle des communautés et organisations engagées dans la transformation des instruments muséologiques en un Forum Citoyen, une Agora. Il l’oblige également à se placer du côté de la diversité avec une posture didactique et dialectique, capable de générer, à travers les énergies qu’elle suscite, un dialogue entre les peuples13. »
Cette réflexion met en lumière comment la scène muséale internationale se métamorphose et se mobilise pour contribuer, aux côtés d’autres formes d’expression culturelles, à l’émergence d’une mémoire vivante qui permet de générer une approche critique et changer les perceptions du passé sur une scène de débat sur la mémoire publique et les limites de la représentation14.
Notes
1
Lisa M. Knauer et Daniel J. Walkowitz, « Introduction », in Daniel J. Walkowitz et Lisa M. Knauer (dir.), Contested Histories and Public Space: Memory, Race, and Nation, Durham/Londres, Duke University Press, 2009, p. 3-4.
2
Lisa M. Knauer et Daniel J. Walkowitz, « Introduction », in Daniel J. Walkowitz et Lisa M. Knauer (dir.), Contested Histories and Public Space: Memory, Race, and Nation, Durham/Londres, Duke University Press, 2009, p. 3-4.
3
Comme l’a récemment aussi souligné le groupe sur les musées et la mémoire de la Memory Studies Association (voir https://www.memorystudiesassociation.org/call-for-papers-museums-memory-politics-museums-and-memory-wg/) (dernière consultation le 3 décembre 2024).
4
Jay Winter, « Thinking about silence », in Efrat Ben-Ze’ev, Ruth Ginio et Jay Winter (dir.), Shadows of War: A Social History of Silence in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 3-31.
5
Astrid Erll, Memory in Culture, Londres, Palgrave Macmillan Memory Studies, 2011, p. 65.
6
Colloque Raconter et exposer les minorités : médiations muséales en France et en Amérique du Nord, tenu au musée du quai Branly – Jacques Chirac, Paris, les 21-22 avril 2022, organisé par l’Institut d’histoire du temps présent en collaboration avec le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Comité organisateur : Olivier Maheo (IHTP), Pauline Peretz (IHTP), Sarah Frioux-Salgas (musée du quai Branly – Jacques Chirac).
7
Laure Teulières, « Migration, mémoire et musée : regards croisés France/États-Unis. Compte rendu du colloque international organisé par le Clarke Center du Dickinson College en coopération avec le laboratoire Framespa-Diasporas (CNRS UMR 5136) “Migration, Memory and Museum ” Dickinson College (Carlisle, États-Unis), 10-11-12 novembre 2005 », Diasporas. Histoire et sociétés, n° 8, 2006, p. 224-230. URL : https://www.persee.fr/doc/diasp_1637-5823_2006_num_8_1_1059 (dernière consultation le 9 décembre 2024).
8
Walter Mignolo, La Désobésissance épistémique, Lausanne, Peter Lang, 2021.
9
Les ouvrages publiés ces dernières années sur les pratiques décoloniales au musée sont nombreux. Voir notamment : Csilla E. Ariese et Magdalena Wróblewska, Practicing Decoloniality in Museums : A Guide with Global Examples, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2021 ; Sharon Macdonald, « Re-worlding the museum. Or the museum for possible futures », in Schnittpunkt et Joachim Baur (dir.), Das Museum der Zukunft, Bielefeld, transcript Verlag, 2020, p. 189-194 ; Nina Möntmann, Decentring the Museum. Contemporary Art Institutions and Colonial Legacies, Londres, Lund Humphries, 2023 ; Felwinn Sarr et Béatrice Savoy, Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain - Vers une nouvelle éthique relationnelle, Paris, ministère de la Culture, 2018 ; Françoise Vergès, Programme de désordre absolu. Décoloniser le musée, Paris, La Fabrique, 2023.
10
Fabien Van Geert et Mathieu Viau-Courville, « Introduction. Pour une mise en perspective internationale des musées de société », Culture & Musées, n° 39, 2022, p. 11-26. URL : https://journals.openedition.org/culturemusees/7528 (dernière consultation le 9 décembre 2024).
11
Walter Mignolo, La Désobésissance épistémique, Lausanne, Peter Lang, 2021, p. 37-38.
12
Jette Sandahl, « The Museum Definition as the Backbone of ICOM », Museum International, vol. 71, n° 1-2, 2019, p. vi-9.
13
Pierre Mayrand cité dans Mario Chagas, « Museums, memory and social mouvements », Sociomuseology IV, Cadernos de Sociomuseologia, vol. 38, 2010, p. 50-51.
14
Andreas Hyussen, Memory Art in the Contemporary World. Confronting Violence in the Global South, Londres, Lund Humphries, 2022, p. 10.









