Un bulletin confidentiel des services spéciaux de l’armée française rend compte de l’état moral des soldats du front de l’ouest dans la semaine du 9 au 15 juillet 1917. À propos des chefs, on y lit : « Les remarques, les jugements, approbations ou critiques sur les officiers sont relativement nombreux. (…) Leurs opinions se manifestent en général sans commentaires : un tel est bon, l’autre est mauvais1. » La lecture des archives militaires des armées européennes, comme celle de la littérature de témoignage, produite par ceux qui commandent, ceux qui obéissent, ou ceux qui font les deux, laissent un même sentiment : au front, passés les premiers jours de combat, il n’y a plus de « grands chefs ». Dans la boue des tranchées du Nord-Est de la France, lors des affrontements anomiques à la mortalité effrayante des Eparges, de Verdun ou de la Somme, entre 1914 et 1918, il n’y a plus que des « bons » ou des « mauvais » chefs.
Notre interrogation se pose en deux temps. Sur la ligne de front, que devient dès 1914, la notion de « grand homme », de « grand commandant » au sens des dictionnaires du XVIIIe et du XIXe siècle et dont la littérature militaire se nourrit encore au début du XXe siècle ? Si le terme de grandeur, au sens d’une « élévation en dignité2 » semble se dissoudre sous les effets de la violence et de la durée du combat, la question très simple qui en découle devient dès lors qu’est-ce qu’un bon ou un mauvais chef entre 1914 et 1918, au sein de l’armée, lors de la plus longue expérience de guerre de son histoire ? Peut-on suggérer que la Première Guerre mondiale entraîne – au front davantage qu’à l’arrière – la construction d’une culture partagée entre officiers et hommes du rang, une représentation en quelque sorte déhiérarchisée d’une autorité « positive » ou « négative » qui empêcherait, jusqu’à un certain point, l’émergence de « grands » au sein d’une armée de conscription ? Si oui, il reste à en présenter et à en expliquer le contenu.
On l’aura compris, cet article s’intéresse aux interactions entre hommes du rang et officiers de terrain en présence sur le front. Les chefs dont il est question sont ceux du terrain et non pas les figures des commandants stratégiques des états-majors. Il s’agit bien ici d’offrir une représentation du commandement sous le feu de l’ennemi et/ou au contact des hommes du rang.
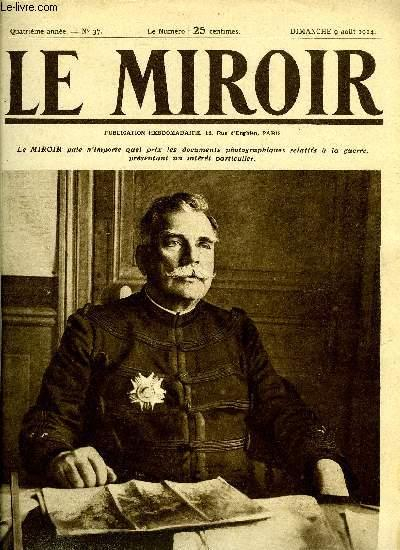
Le Miroir n° 37 - Le chef suprême de l'armée française, Les premiers départs de mobilisés, le 2 aout, Un grand ami de la France : S.M. Albert 1e, Une union défensive de la Suisse et des cinq petits états européens du Nord, peut-elle se nouer et s'exercer, 9 aout 1914
Dans un premier temps, il semble impératif de s’arrêter sur un moment singulier dans l’histoire de l’autorité, un moment charnière entre XIXe et XXe siècle, du point de vue des représentations des chefs : août 1914. En effet, le premier mois de la guerre est en même temps l’aboutissement de réflexions engagées dès la fin du XIXe siècle et une expérience inaugurale de commandement et d’encadrement au cœur d’une expérience de violence combattante d’une ampleur inédite. La notion d’autorité partagée fait naître un nombre inédit de chefs de contact : officiers et sous-officiers. L’ampleur de l’expérience sociale de l’encadrement laisse dès lors des traces nombreuses qui permettent de saisir les tensions du commandement et les discours des chefs sur eux-mêmes. Enfin il sera temps de comparer ce discours sur les bons et les mauvais chefs avec les représentations qu’en offrent les simples soldats. L’obéissance ou le refus d’obéissance des hommes du rang devenant au cours du conflit la plus importante, sinon l’unique, pierre de touche de l’autorité des chefs.
La fin des grands : du discours à la pratique
« L’armée est de principe autoritaire : parce que l'obéissance qui seule rend possible l'unité de volonté, et l'unité d'action, est l'indispensable condition de la victoire. Elle est de gouvernement aristocratique parce que l'obéissance n'est possible qu'envers qui mérite d'être obéi, envers le plus digne, le meilleur3. » C’est en 1914 que le colonel Montaigne tente ainsi de réagir aux mutations des représentations et des discours militaires de l’autorité et du commandement. Lui, et quelques autres officiers catholiques et conservateurs4, publient autour des années 1910 des essais dénonçant les accents sociaux, démocratiques et psychologiques des propos sur le commandement, caractéristiques de la dernière décennie du XIXe siècle. Depuis 1890 en effet, les discours sur l’autorité ont subi une triple inflexion qui relativise, intentionnellement ou non, l’autorité du chef militaire et semble aux yeux des plus réactionnaires, diminuer son prestige. La première, on le sait, est initiée par Lyautey qui fait du rôle social de l’officier un impératif de l’armée de conscription, transformant selon certains, de possibles grands capitaines en éducateurs bienveillants5. Mais la révolution du point de vue de l’autorité militaire vient des conséquences de l’évolution des combats et de la puissance nouvelle du feu. Dans un texte publié en 18806, très lu dans les milieux militaires avant 1914, le colonel Ardant du Picq annonce deux évolutions majeures de l’autorité militaire sur le champ de bataille. D’abord, le chef devient invisible pour la plupart des hommes du rang, tant les conditions modernes de combat (intensité du feu, explosions, bruits, fumées…) empêchent dorénavant les hommes de tenir le rang derrière ou devant leur chef. Ensuite, de manière implicite, l’officier suggère que la peur est tellement intense, tellement inévitable sur le champ de bataille moderne, qu’elle peut, sans préparation adéquate, paralyser les hommes et empêcher toute action efficace de commandement. Cette première prise en compte militaire d’une possible déhiérarchisation entraînée par le combat moderne est confirmée par les observateurs français des guerres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ainsi, entre 1905 et 1911, le capitaine Simon, professeur à Saint-Cyr, enseigne à ses élèves officiers que les chefs tactiques lors de la guerre des Boers et de Mandchourie étaient, à l’instar de leurs hommes, couchés et cachés, deux postures antinomiques des grandes figures de l’autorité militaire dressées et empanachées :
« Une des impressions enregistrées le plus régulièrement par les témoins des combats récents est l'impossibilité à peu près complète de conduire le combat sur la ligne de feu. Les officiers subalternes, obligés de se terrer comme leurs hommes, ne peuvent exercer leur action que dans un rayon peu étendu. Chacun fait comme il peut ; plus d'ordre, plus de régularité, plus de méthode7. »
Enfin, les militaires s’ouvrent aux nouvelles disciplines universitaires qui elles aussi viennent écorner les croyances au « prestige naturel », qualité presque divine mise en avant par les tenants d’une autorité efficace qui, à l’échelle des grandes unités, ne pourrait être exercée que par des « grands » commandants. Or, les psychologues et les médecins enseignent dorénavant que la suggestion et l’autorité s’acquièrent. Les techniques de l’hypnose elle-même peuvent s’enseigner et avec elles les façons d’exercer son influence sur ses patients8, ses élèves9 ou ses soldats10. Par ailleurs Gustave Le Bon, auteur préféré des professions d’autorité au tournant du XIXe et du XXe siècle, écrit que l’autorité légitime peut et doit reconquérir ses espaces face à l’autorité des meneurs qui subvertit l’ordre social. Il résulte de tout cela que le prestige s’apprend. Ce dernier n’est plus seulement « une faculté (…) que possède un petit nombre de personnes et qui leur permet d'exercer une fascination véritablement magnétique sur ceux qui les entourent11». Le prestige devient aussi un ensemble de valeurs qui permet de commander et qui s’acquiert à force de travail et de techniques « qu'on peut développer en soi-même par une éducation personnelle volontaire, à force de persistance, sous la pression du sens du devoir12]. » Les cours des écoles d’infanterie ou d’artillerie sont là pour l’attester : les années 1900-1910 sont les années où se publient de très nombreux essais, articles méthodes et autres cours professionnels sur la façon d’exercer son autorité et d’obtenir l’obéissance de ses hommes13.
Néanmoins, le colonel Montaigne n’est pas le seul à regretter le temps des aristoï, des grands soldats, des grands chefs. La nouvelle vision d’une autorité sociale et technique, qui s’acquiert et qu’on prédit malgré tout fragile dans des combats futurs, heurte de plein fouet la vision traditionnelle de la grandeur, encore présente dans l’armée de métier de 1914, et également dans la société civile14. Ainsi, le général Dubail, dès le milieu des années 1890, regrettait les prémices d’une républicanisation des cadres militaires et défendait déjà la vision des meilleurs, si proche de la reconnaissance explicite des grands hommes : « Ce n'est ni le ton de la voix, ni la grandeur de la taille ni même l'âge et la science, ni (…) les menaces qui donnent une telle autorité ; ce qui le domine et ce qui le soutient, c'est une trempe d'âme ferme et égale qui se possède, se gouverne toujours et par là se montre digne de gouverner les autres15. »
Or, s’il est une chose que révèle l’expérience combattante d’août 1914, c’est bien l’incapacité d’une partie importante des états-majors à se gouverner soi-même sous la pression d’un engagement gigantesque, incertain et d’une extrême violence. Si l’administration républicaine parvient avec succès à mobiliser près de 3 400 000 soldats en quinze jours et à en concentrer 1 700 000 dans la zone des armées, sur un front de 700 km environ, la plupart des cadres supérieurs de cette énorme armée va alors s’éloigner définitivement de l’image des grands commandants. Essentiellement de trois façons dont aucune n’est exclusive. Soit en étant tués avant même d’avoir pu réaliser des actes de commandement efficaces ou reconnus comme tels, soit en se montrant incapable d’assumer leur responsabilité logistique et tactique, soit enfin en commandant efficacement mais au prix d’une tension nerveuse et d’une angoisse si intenses que leur représentation d’eux-mêmes s’en trouva durablement altérée.
Rappelons le contexte de ces journées. Entre le 19 et le 24 août une série d’engagements massifs a lieu entre les armées belligérantes qui se termine par un retrait des troupes françaises, britanniques et belges face aux troupes allemandes. L’armée française recule en Lorraine les 20 et 21 août, les Franco-Belges sont battus autour de Charleroi et les Britanniques à Mons entre le 21 et le 24 août. Bruxelles et Namur sont prises et le Nord de la France est occupé à partir du 24 août. La retraite cette fois-ci ne provoque pas la débâcle. Le gros de l’armée française est préservé ce qui rend, comme on sait, la contre-offensive possible dès le 6 septembre à partir de la Marne. Ces batailles d’août 1914, jusqu’à récemment disparues des repères mémoriaux français de la Grande Guerre sont pourtant capitales au moins à deux titres. Ce sont d’abord des journées d’une brutalité inédite : entre le 20 et le 23 août 1914, 40 000 soldats français sont tués, dont 27 000 le samedi 22 août, jour le plus sanglant de l’histoire militaire de France16. En partie pour cela, elles inaugurent des transformations radicales du commandement, de l’encadrement et des relations d’autorité au cœur de la nation en arme.
Premier point, les cadres meurent en nombre au cours de ces batailles, souvent dans la confusion, parfois l’inefficacité stratégique et même tactique. La violence du feu de l’artillerie allemande décime le rang des officiers subalternes mais aussi supérieurs. Le 22 août à Châtelet, le 129e régiment d’infanterie perd un commandant, quatre capitaines, sept lieutenants et un sous-lieutenant17. Dans ses mémoires, le général Lanrezac se souvient des pertes en officiers des 19e et 20e Divisions pour les trois journées de la bataille de Charleroi (cent dix-sept) soit un taux en pourcentage, supérieur à celui des hommes du rang (17 % de pertes chez les officiers, 15,5 % chez les hommes du rang18). Les témoignages portent la trace de nombreuses pertes provoquées par les obus, morts souvent « invisibles » pour la plupart des soldats de l’unité, morts anonymes en quelque sorte, très éloignées des postures sacrificielles et édificatrices de l’éthique héroïque prônées par certains officiers d’active. « Le commandant du bataillon abrité derrière une maison fut gravement atteint par un éclat. Je ne l’ai jamais regretté. Je n’avais aucune confiance en lui comme chef19 », écrit ainsi Etienne Derville lorsqu’il témoigne des combats du 15 août, à Dinant.
Les journées paroxystiques du 22, 23 et 24 août 1914 révèlent également de profondes failles du côté des officiers supérieurs. Peut-être ces défaillances furent-elles, intentionnellement ou non, surestimées par Joffre et son état-major, afin de masquer d’éventuelles erreurs stratégiques commises au sein du Grand Quartier Général. Peu importe ici : le fait est que Joffre lui-même va opérer la « purge » la plus importante de l’histoire de l’armée française en guerre. Adolphe Messimy, ministre de la Guerre remplacé lui aussi le 27 août 1914, consacre un chapitre de ses mémoires à ces limogés dont il partage le sort. Du 2 au 6 septembre, en réaction directe aux défaites d’août, Joffre remplace deux commandants d’armée, dix commandants de Corps d’armée et 38 généraux de division. Au total, un tiers des 400 généraux que comptait l’armée Française en août 1914 est remplacé20. Les archives révèlent des défections notamment à l’échelle des corps d’armée ou des divisions. Là, c’est le colonel du 43e Régiment d’artillerie qui ne se tient pas en liaison avec son général de division21. Ici, ce sont des généraux de division, Bloch de la 6e ou Verrier de la 5e, qui ont « absolument perdu la tête et laissé leur troupe sans direction22. » Jusqu’aux généraux de Corps d’armée qui disparaissent en pleine bataille sans donner d’ordres ni d’indications. En date du 23 août, le JMO de l’artillerie du 3e CA note sobrement : « Vers 16 h 30 le général commandant le corps d’armée quitte son poste de commandement et sans donner d’ordre. Le général Rouquerol se porte (…) sur le front pour continuer le combat ». Les spécialistes d’histoire militaire expliquent une telle proportion d’incompétence par deux facteurs : « La faiblesse de l’entraînement au commandement des grandes unités et le décalage avec l’évolution récente des armements 23». S’ajoutent sans doute à ces deux facteurs les effets physiques et psychiques de la puissance de feu de l’artillerie allemande. L’épreuve infligée aux corps et aux nerfs des cadres a provoqué une tension et une angoisse incompatibles avec tout sentiment de grandeur guerrière.
L’autorité en partage : être un bon chef selon soi-même
Le général Rouquerol, qui remplace à l’improviste ce général du 3e corps d’armée, introuvable sur le champ de bataille, a laissé un témoignage d’un intérêt remarquable, jadis signalé par Yves Cohen24, sur son expérience de commandement au cours de la Grande Guerre et particulièrement en août 1914. « J’ignore si j’ai réussi à donner le change à mes subordonnées sur le doute et le trouble qui étaient en moi. J’ignore si véritablement je leur inspirai confiance. En tout cas, je me disais parfois qu’ils seraient bien désillusionnés s’ils voyaient ce qui se passait au fond de moi25 » écrit-il à propos des journées de Charleroi. Il n’est pas certain qu’une analyse de cet extrait sous l’angle de la fausse modestie de son auteur ou d’un excès de dépréciation soit opérante. La bataille de Charleroi a fait s’écrouler l’ensemble de ses représentations du commandement militaire :
« Toutes mes idées sur les chefs et les soldats des guerres passées, principalement sur celles de l’épopée de la Révolution et de l’Empire, s’en trouvaient bouleversées. C’étaient sans doute des hommes pareils à ceux qui m’entouraient, à ceux qui me commandaient et à ceux qui m’obéissaient (…). La grande courbature morale que j’éprouvais ne m’empêchait pas d’agir quand il le fallait ; mais elle se traduisait, (…) par un ardent désir de sortir de cet état permanent de tension (…) dans lequel je vivais26. »
Rouquerol confesse son angoisse d’autant mieux qu’elle ne l’a pas empêché d’agir. Mais la « courbature » évoquée ici l’empêche peut-être réellement de se considérer comme un « grand commandant ». Comme la majorité des officiers supérieurs et subalternes en 1914, Rouquerol n’a jamais commandé sous le feu et connaît donc sa première expérience combattante. La peur d’avoir peur est ici celle d’un chef de terrain, mais d’un chef stratégique, qui assiste sans participer en tant que soldat aux combats. Sa peur est d’abord celle de sa propre défaillance, dramatique pour le regard sur soi et écrasante par ses conséquences : « des dizaines, des centaines, des milliers d’existences humaines27 ! ».
Cette tension, particulière lors du baptême du feu mais résurgente à chaque engagement, est un topos de la littérature de témoignage des chefs de contact. La triple exigence semble alors effrayante : affronter les risques de mort et de blessures sous le feu, ne pas laisser percevoir sa peur par les hommes de son unité et enfin diriger ou encadrer les soldats avec efficacité tactique. Notons que ce sentiment de responsabilité touche jusqu’au caporal, que bien peu de choses distingue pourtant du simple soldat, excepté ses charges au sein de son escouade (une dizaine d’hommes). C’est la fonction qu’occupe Galtier-Boissière en 1917 lorsqu’il décrit les si lourds enjeux de son action :
« Malgré mon atroce anxiété, le sentiment (…) que je prends des décisions pour ma sauvegarde et celle de mes hommes me soutient. Mais quelle terrible responsabilité ! Parfois, quand j'ai crié "à droite !" la torpille dévie sous un coup de vent, et je hurle, affolé : " À gauche, à gauche ! à gauche ! " Une seconde d'inattention, une erreur d'appréciation, c'est l'écrabouillement de ces douze braves garçons (…)28. »
« Courbature morale », « tension », « angoisse », « anxiété », c’est bien le champ lexical de la peur qui structure en partie le témoignage des chefs tactiques, des officiers de contact pendant la Première Guerre mondiale. Et il est important de se souvenir ici que cette expérience de peur ressentie au niveau des cadres n’avait jamais été partagée à une telle échelle. Entre 1914 et 1918, pour la seule armée française, 700 000 hommes au moins, officiers ou sous-officiers se sont trouvés en posture d’autorité directe sur d’autres hommes29. Bien davantage qu’un laboratoire, il s’agit de la plus grande expérience d’autorité partagée au sein d’un même corps sur une telle période. Aussi le partage de cette peur à un tel niveau est sans doute un des facteurs principaux de la transformation profonde du regard sur ce qu’est un grand, un bon ou un mauvais chef. C’est également ce partage de l’autorité au sein de l’armée qui rend si importantes les figures du bon et du mauvais chef entre 1914 et 1918.

De Gaulle Captif en 1915.
Un bon chef, selon les officiers qui en témoignent, est un officier qui d’abord conserve les valeurs militaires traditionnelles. Courage, volonté, sang-froid, énergie, décision, les grandes vertus de l’autorité combattante d’avant 1914 restent opérantes tout au long de la guerre. Ces vertus doivent être visibles par l’ensemble de l’unité que commande le chef, l’escouade pour le caporal, la demi-section ou la section pour le sergent, le sous-lieutenant ou le lieutenant, la compagnie dans son entier pour le capitaine, et ainsi de suite jusqu’au grade de colonel, dernier officier généralement à être connu des hommes de son régiment. Le seul courage qui semble compter est celui de l’exposition au combat : ne pas rester sur les positions de l’arrière et exposer son corps aux tirs de l’ennemi. Le sang-froid, comme toutes les vertus du contrôle de soi, reste au cœur de l’autorité bien exercée. Calme, maîtrise de ses nerfs, impassibilité, toutes ces qualités du gouvernement de soi restent celles du bon chef de 1914-1918 pour tous ceux qui ont écrit sur leur expérience d’officiers au cours de la guerre30. Ces figures de chefs dessinent en même temps leur contraire. Un mauvais chef est un officier qui n’a pas ou n’a plus ces vertus, perçues comme indispensables par l’ensemble de la communauté combattante. L’énervement répété, la panique, l’incapacité à prendre des décisions et le fait de ne pas partager les risques du combat sont vus comme des signes d’incapacité faisant perdre toute autorité aux officiers lorsque de tels comportements se répètent.
Or, avec la prolongation de la guerre, ces vertus restent nécessaires mais ne sont plus suffisantes. D’une part la durée du conflit entraîne une certaine professionnalisation des soldats, à qui les chefs eux-mêmes ne tardent pas à reconnaître des qualités guerrières jusque-là réservées à l’autorité. Ainsi dans la correspondance des officiers, les hommes de troupe sont parés des vertus traditionnelles des chefs : maîtrise de soi, héroïsme, sacrifice, courage. D’autre part, la tendance dès 1916 est à la création d’unités combattantes de plus en plus petites (25 soldats), composées de guerriers davantage spécialisés et interdépendants. Au sein même de l’infanterie dont il est issu, le poilu disparaît et laisse la place au grenadier, au mitrailleur, au fusilier, au téléphoniste… Dans de petites unités aguerries et très spécialisées, l’autorité de contact peine à se justifier par ses seules qualités guerrières et techniques désormais largement partagées par la communauté combattante.
Enfin, la détresse occasionnée – sur de très jeunes hommes – par la violence et la durée des combats crée un immense besoin de consolation31. Les postures guerrières, viriles, paternelles ne comblent plus l’attente des soldats. L’autorité doit s’adapter et les officiers ont alors recours à des gestes et des mots qui vont féminiser, au moins maternaliser les figures du chef. « Je lui fais un pansement plus délicatement, plus doucement que je n’en fis jamais, comme une maman habille son nouveau-né. Je ne sais comment je résiste à l’envie folle qui me prend d’embrasser là, devant tous, ce pauvre petit gars dont je ne saurai jamais le nom et qui va mourir32 ». Ainsi le registre lexical se déplace vers la bienveillance, la douceur, le soin, le réconfort. L’image de la mère est convoquée dans les descriptions de l’autorité positive et efficace, jusqu’à la tendresse qui devient une vertu nommée par ceux qui encadrent les soldats. Le chef n’est plus seulement un père, il est devenu une mère. En 1916, le sous-lieutenant Mairet peut écrire : « Voyez-vous, madame, on est des chefs, pas des dompteurs. On ne cherche pas à ennuyer le monde. On est comme une mère de famille33. » Cet adoucissement suggéré, sinon imposé par les combattants du rang, brouille davantage encore l’éventuelle émergence d’une figure de « grand homme » de guerre aux contours convenus, au moins du point de vue de ceux qui encadrent.
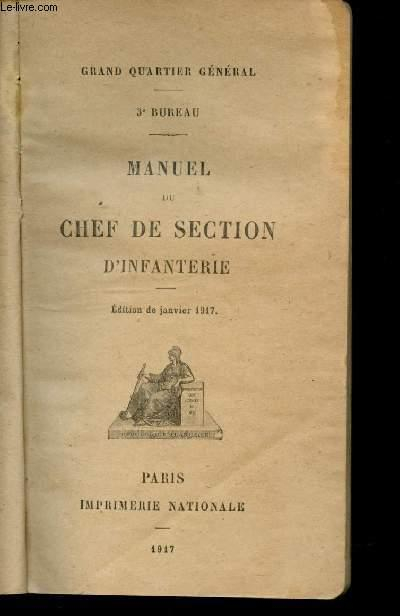
Grand quartier général, Manuel de chef de section d'infanterie de 1917. Pendant la guerre, il a été réédité chaque année avec des variations sur la façon d’encadrer les hommes.
Bons chefs et mauvais chefs : le point de vue de ceux qui obéissent
Notre intention est ici de croiser deux types de sources qui permettent de nous approcher des représentations des hommes du rang : les archives du contrôle postal et les archives judiciaires. Nous nous appuyons dans un premier temps sur les rapports du contrôle postal, ces documents de synthèse, rédigés par des officiers, censés résumer l’état moral des troupes du front et de l’arrière. Soulignons d’abord qu’au cours des premiers mois, l’autorité ne semble pas intéresser les hommes du rang. En tout cas ce n’est pas un sujet de correspondance avec l’arrière. Dans son classement des préoccupations des soldats selon leur correspondance, Annick Cochet classe les chefs et le commandement dans la dernière catégorie des « thèmes peu représentés »34. Les rapports généraux de fin 1915 et les premiers rapports systématiques du contrôle postal de 1916 ne portent aucune mention sur l’obéissance elle-même et très peu sur l’autorité35. En 1914 et 1915, la question du bon chef, du mauvais chef, voire du grand chef semble donc davantage préoccuper ceux qui commandent que ceux qui obéissent.
Néanmoins, avec la durée de la guerre, la question des chefs devient une préoccupation et les rapporteurs du contrôle postal témoignent de nombreux propos sur les officiers, notamment au moment des grandes offensives et des périodes de grands combats meurtriers en 1916, ou au printemps 1917. Le contenu des rapports varie d’une unité à l’autre, mais pas les termes qui désignent l’autorité : « On les loue de n'être "pas fiers", d'aimer leurs hommes, de ne pas se ménager et d'avoir de la décision (…). La confiance réciproque des officiers et des soldats paraît un des éléments essentiels de la force morale des troupes, "nous avons de bons officiers, il fait bon vivre avec des hommes comme eux", (…). Nous ne vivons que pour cette cause, nos chefs en tête et je te prie de croire qu'ils ne se ménagent pas"(…)36». Les mutineries de 1917 laissent ensuite de nombreuses traces écrites de l’appréciation des chefs par les soldats. Les contrôleurs postaux notent que les hommes réagissent dans leur correspondance aux nombreuses mutations de corps d’officiers subalternes, suite aux événements du printemps, en exprimant leur joie ou leur regret de voir partir tel officier. De nombreuses appréciations ressemblent au contenu du rapport qui suit et qui résume les jugements sur les chefs exprimés par les hommes du rang :
« Les qualités que les soldats apprécient chez leurs chefs sont qu’ils ne les "embêtent pas", qu’ils leur témoignent une certaine bonhommie et une certaine familiarité de ton ; le tutoiement affectueux les touche. Ils aiment que le chef leur parle et leur parle avec son cœur. Ils louent ceux qui "s’occupent d’eux", c’est à dire de leur nourriture, de leur confort, de leurs distractions, ceux qui viennent les voir, au repos et aux tranchées, et leur donnent l’exemple au combat. Les principaux reproches portent sur un certain esprit de césarisme dont le réveil est assez souvent signalé, sur le manque d’expérience et de justice de plusieurs, sur une manière d’être arrogante et brutale, sur l’absence de sens psychologique et la maladresse d’aucuns. Quelques lettres signalent que les officiers se retirent à l’écart des hommes dans la zone dangereuse (sic) ou en ligne pour s’abriter37. »
On reconnaît ici des qualificatifs partagés de l’autorité, identiques en tout cas à ceux déployés par les officiers subalternes et les sous-officiers. Les valeurs traditionnelles sont présentes : il est rédhibitoire pour un chef de rester à l’abri lorsque les hommes sont exposés en première ligne et l’exemple du courage demeure un impératif de l’exercice d’une autorité efficace. Se lit aussi l’exigence de douceur de la part des hommes qui entraîne une nécessaire mobilisation des affects de la part des officiers. La brutalité est dorénavant exclue du commandement direct si l’officier veut conserver le respect de ses soldats. En août 1917, le rapporteur résume : « Les officiers pour qui les hommes manifestent de la sympathie et du dévouement sont ceux qui les aiment, leur parlent avec simplicité et s’intéressent à leur bien-être38. » Enfin, se perçoivent les attentes du nécessaire assouplissement disciplinaire propre au front en dehors de l’activité combattante, sorte de bénéfice secondaire accordé au soldat en compensation des souffrances morales et physiques des premières lignes et qui exclut une discipline de caserne. Le dernier point qui laisse supposer un rapprochement entre l’officier de contact et l’homme du rang est la mention dans la correspondance de la délicate question de la distance entre chef et soldat. La guerre qui dure et la violence des combats semblent ici rapprocher soldats et chefs de terrain (au moins jusqu’au grade de capitaine).

Charles Vuillermet commence la guerre comme sous-officier en 1914, puis sous-lieutenant, lieutenant et commandant. C’est à ce grade qu’il est tué le 3 juin 1918 à Bussiares dans l’Aisne.
Ce rapprochement n’est peut-être ici qu’un effet de sources. Les officiers du contrôle postal pouvaient relever certains contenus des lettres en les transformant plus ou moins et surtout en les résumant sans bien restituer leur aspect général ou, à l’inverse, marginal au sein des correspondances. L’essentiel des « discours cachés39 » des subordonnés propres à toute relation de pouvoir, aurait ainsi échappé aux rapporteurs. Mais une autre source, les archives judiciaires, donne des indices d’une culture de l’autorité, partagée entre hommes du rang, officiers subalternes et, d’une certaine façon, officiers supérieurs de terrain (jusqu’au grade de colonel).
Les conseils de guerre pour refus d’obéissance livrent de précieux témoignages sur l’autorité. Infiniment moins nombreux que les procès pour « abandon de poste » ou « désertion », ils ont néanmoins, du point de vue qui nous intéresse, un immense avantage : ils concernent des ruptures personnelles du lien hiérarchique, le refus d’une autorité incarnée par un officier. Or, en étudiant ces refus d’obéissance40 et la façon dont les jurys militaires (composés de quatre officiers et d’un sous-officier) les apprécient, il nous a semblé percevoir la construction d’un socle commun des figures du « bons » et du « mauvais » chef.
Les causes généralement évoquées par le prévenu pour expliquer son refus concernent trois types de pratique d’autorité devenus insupportables pour ces soldats : l’injustice, l’arbitraire et la brutalité. Un changement non justifié d’unité (pièce d’artillerie ou escouade) une corvée de ravitaillement ou de nettoyage qui ne tient pas compte des tours implicites ou négociés, un ordre perçu comme autoritaire ou inutile, sont autant de situations qui créent un type de tension caractéristique des dossiers de refus d’obéissance. Un seul exemple parmi tant d’autres : le 14 décembre 1915, le soldat Jules Corbu est jugé par le tribunal de la 3e DI pour « refus d’obéissance sur un territoire en état de guerre et outrages41 ». Le chasseur Corbu était en train d’écrire dans la cuisine du cantonnement lorsque son maréchal des logis lui demande d’aller aux distributions. Corbu refuse et dans un premier temps, se dit malade. Le maréchal des logis vérifie alors le cahier de visite et constate qu’aucune mention de visite n’est portée au cahier de l’infirmerie42. Le chef revenant à la charge, le soldat fait alors valoir que ce n’est pas son tour43. Le sous-officier insiste, le chasseur se fâche et l’insulte. L’outrage est « fleuri », et apparaît sans point de suspension dans le rapport du commandant du 4e escadron44. Le prétexte « ce n’était pas mon tour » est asséné à trois reprises par Corbu dans son interrogatoire. C’est en quelque sorte sa stratégie de défense : « Ce n’est pas moi qui étais désigné primitivement, le maréchal des logis a changé au dernier moment45 ». Même le très léger regret qu’exprime l’inculpé à propos des outrages rend compte, encore, du sentiment d’injustice ressenti par le soldat à l’encontre de l’ordre donné par son maréchal des logis « dans ces moments-là, on n’est pas toujours maître de ses paroles46 ». Il ne s’excuse pas du refus auprès des juges mais de l’outrage. Or, ici, Corbu est acquitté, ce qui est un désaveu pour le sous-officier mais aussi pour l’officier commandant la compagnie qui a rédigé le rapport de plainte en conseil de guerre. Un acquittement pour une telle insulte aurait été improbable dans une caserne française du temps de paix. Il semble bien que les tribunaux finissent par donner une légitimité au sentiment d’injustice forgé par l’expérience de guerre, s’affranchissant de toute règle écrite. Aucun règlement n’oblige en effet un chef à respecter un tour dans la distribution des corvées, mais cela devient une pratique obligatoire d’un juste exercice de l’autorité.
Ces « petites affaires » sont caractéristiques des refus jugés pendant la guerre. Ceux-ci ont toujours pour cadre l’arrière-front et se déroulent très majoritairement au cantonnement. Ces anecdotes de temps de guerre révèlent un refus grandissant de l’autoritarisme, c'est-à-dire d’ordres « qu’on ne discute pas ». Après l’injustice et l’autoritarisme, la brutalité physique du supérieur apparaît comme une cause de la rupture du lien. Les archives des conseils de guerre portent les traces de cette évolution sensible du rapport à la brutalité dans l’exercice du commandement. En effet, Les « coups de poings », « bousculades » ou « bourrades » du supérieur n’apparaissent jamais dans les dossiers de conseils de guerre avant 1916. Ils ne sont jamais dénoncés par les prévenus, ni même évoqués dans la défense des accusés. C’est au cours de l’année 1916, et plus précisément du printemps, qu’ils sont mentionnés dans les dépositions des prévenus. Or, à partir d’avril 1916, lorsque l’instruction révélait qu’en amont d’un refus d’obéissance, le soldat avait reçu un coup de son chef (gifle ou coup de poing), le prévenu était le plus souvent condamné à la plus faible peine prévue par le code de justice militaire.
Un exemple, là encore parmi d’autres : c’est lors de son interrogatoire que le territorial Jean-Marie Poizeau, jugé en juin 1916 pour « rébellion avec armes », révèle avoir reçu une gifle par l’un des deux gendarmes qui l’escortaient. Cela lui semble une excuse recevable pour justifier, aux yeux des juges, les « voies de fait » commises ensuite. Ici, le manouvrier Poizeau qui présente pourtant des appréciations extrêmement défavorables47 se voit accorder les circonstances atténuantes et reçoit une condamnation à deux ans de prison, peine minimum prévue par le code. Ce justificatif du refus prouve que le geste de violence autoritaire devient, au cours de la guerre, inacceptable pour les hommes du rang et cette perception semble partagée par la défense et d’une certaine manière, à partir de 1916, par les juges des conseils de guerre eux-mêmes. Injuste, autoritaire, brutal, arbitraire, ainsi se dessine en creux du refus d’obéissance du soldat le portrait du « mauvais chef ». Ces chefs dépourvus de l’autorité à laquelle on obéit facilement, ressemblent bien aux « mauvais chefs » de la littérature de témoignage ou des rapports du contrôle postal.

La transmisson par le téléphone qui a transformé la façon de commander éloignant notamment les officiers supérieurs du champ de bataille. Photo de Austin C. Lescarboura pour Scientific American publishing Company.
Conclusion
L’obéissance – ou son refus visible – éclaire l’autorité du chef et sa perception. Son étude et la description de ses modalités laissent penser que si l’autorité entraîne ou obtient la soumission, l’obéissance des uns entraîne ou modèle aussi l’autorité des autres. Lors de la Première Guerre mondiale, le « bon chef » fut finalement celui qui sut s’adapter au degré d’adhésion de ses hommes et le « mauvais » probablement celui qui n’accepta pas ces variations du degré d’obéissance.
Les concessions de l’autorité de contact (seul moyen d’éviter la rupture du lien hiérarchique), la proximité entre les hommes et les chefs subalternes, la tension des combats et l’émergence de valeurs maternelles dans l’exercice de l’encadrement, ont contribué à déconstruire l’image et la figure des grands chefs dans la communauté combattante au cours de la guerre. Néanmoins, au tournant des années 1920 et 1930, la nostalgie de ces pratiques d’encadrement est criante : « J'étais un chef. Je voulais m'emparer de tous ces hommes autour de moi, m'en accroître, les accroître par moi et nous lancer tous en bloc, moi en pointe, à travers l'univers48» écrit Drieu La Rochelle en 1934, l’année même de son tournant fasciste. Ce témoin attendu n’est pas isolé, et les traces de cette fascination polymorphe pour la relation d’autorité au cours de la Grande Guerre se trouvent chez de nombreux acteurs sociaux, dans l’ensemble des grands corps de la IIIe République : le chef de bataillon Charles de Gaulle49, le philosophe, inspecteur général de Philosophie, André Bridoux[50 ou le journaliste de L’Humanité Paul Vaillant-Couturier51, témoignent à leur façon de cette fascination. Derrière ce qui ressemble à une sorte de nostalgie de cette relation sociale de temps de guerre, il resterait à étudier la chronologie et les modalités exactes du réinvestissement de ces pratiques dans les sociétés civiles européennes et leur place dans « l’ère des chefs » que représentent les années 1920 et 1930, pas seulement dans l’Allemagne nazie ou l’Italie fasciste. En attendant, peut-on avancer que la Première Guerre mondiale eut en France également une influence décisive et irrémédiable sur l’histoire de l’autorité ? Nous le pensons et il s’agirait d’une rupture en deux temps. En premier lieu on assiste à la dilution de la notion de grandeur au sein de la communauté combattante et à la construction d’une nouvelle grammaire de la relation d’autorité entre des centaines de milliers de chefs de contact et des millions de conscrits. Ensuite seulement, au lendemain de la guerre, on assisterait à la domination de la mémoire positive de cette relation d’autorité et à une volonté de la réinvestir dans la société civile afin peut-être de retrouver des grands, des chefs, des charismatiques.
Notes
1
Service historique de la défense, (SHD), 16 N 1519, Etat-Major Général, Bulletin n°2.
2
Dictionnaire de l’Académie française, 5e édition, Paris, Smits et Ce, 1799.
3
Lieutenant-colonel Montaigne, Le Devoir étant maître, Paris, Lavauzelle, 1914, p. 37.
4
Général Donop, Obéissance et commandement, Paris, Librairie nationale, 1906 ou Capitaine Couderc de Fonlongue, La Pierre de touche, essai sur l'autorité dans l'armée, Paris, Perrin, 1908.
5
E. B., « À propos du rôle social de l'officier », Journal des Sciences militaires, Paris, novembre-mars 1896, p. 397-402.
6
Colonel Ardant du Picq, Études sur le combat, [1880], Paris, Chapelot, 1904.
7
Capitaine Paul Simon, La Discipline Moderne, Paris, Lavauzelle, 1909, p. 15.
8
Hippolyte Bernheim, Hypnotisme, suggestion, psychothérapie, [1891], Paris, Fayard, 1995.
9
Felix Thomas, La Suggestion son rôle dans l'éducation, Félix Alcan, 1903.
10
Paul Lapie, « La pédagogie contemporaine et l'Education du soldat », in Vers la fusion, Conférences faites à l'Ecole Militaire de Saint-Maixent en 1907 et 1908, Paris, Limoges, Lavauzelle, 1908, p. 59-84.
11
Gustave Le Bon, Psychologie des Foules, [1895], Paris, PUF, 1961, p. 77.
12
Capitaine Gavet, L'Art de commander, Paris, Nancy, Berger-Levrault, 1899, p.193.
13
Outre les textes cités dans cet article signalons parmi des dizaines d’autres, Lieutenant B., « Les émotions du chef », in Revue militaire générale, décembre 1909, p. 649-672 ou Colonel Gory, « Autorité, Subordination et Moyens de Discipline », in Journal des sciences militaires, Paris, juin 1911, p. 401-417.
14
Paul Gerbod, « L'éthique héroïque en France (1870-1914) », Revue historique, octobre-décembre 1982, n° 544, p. 409-429.
15
J.S.G., Le Soldat français aujourd'hui-demain, Paris, Librairie Delhomme,1893, p. 175.
16
Henry Contamine, La Victoire de la Marne, 9 septembre 1914, Paris, Gallimard, 1970, p. 120.
17
SHD, Journal de marches et des opérations (JMO) 129e RI, 22/08/1914.
18
Général Lanrezac, Le Plan de campagne français (2 août-3 septembre 14), Paris, Payot, 1920, p. 93.
19
Étienne Derville, Correspondances et notes, Tourcoing, J. Duvivier, 1921.
20
Général Messimy, Mes souvenirs, Paris, Plon, 1937.
21
SHD, 19 N 901, Télégramme chiffré, Gral Ve armée à général commandant en chef, 25 août 1914.
22
SHD, 19 N 901, Télégramme chiffré, Gral Ve armée à général commandant en chef, 25 août 1914.
23
Michel Goya, La Chair et l’acier, l’invention de la guerre moderne (1914-1918), Paris, Tallandier, 2004, p.179
24
Yves Cohen" Les polytechniciens dans le discours sur le commandement (1891-1940)", " in La France des X, B. Belhoste, A. Dahan, D. Pestre, et A. Antoine (dir.), Paris, Economica, 1995, p. 157-169.
25
Général Rouquerol, Le 3e corps d’armée de Charleroi à la Marne. Essai de psychologie militaire, Paris, Berger-Levrault, 1934, p. 104.
26
Général Rouquerol, Le 3e corps d’armée de Charleroi à la Marne. Essai de psychologie militaire, Paris, Berger-Levrault, 1934, p. 114.
27
Général Rouquerol, Le 3e corps d’armée de Charleroi à la Marne. Essai de psychologie militaire, Paris, Berger-Levrault, 1934, p. 137.
28
Jean Galtier-Boissière, Un hiver à Souchez, [1917], Du Lérot éditeur, 1998, p. 37.
29
Sur ce chiffre, je me permets de renvoyer à Emmanuel Saint-Fuscien, A vos ordres ? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre, Paris, EHESS, 2011.
30
Outre les ouvrages déjà cités on peut consulter parmi des centaines d’autres : Louis Barthas, Pierre Chaine, Paul Tufrau ou Maurice Genevoix.
31
Annette Becker, La Guerre et la foi, de la mort à la mémoire 1914-1930, Paris, Armand Colin, 1994.
32
Gaston Top, Un groupe de 75, Paris, Plon, 1919, p.31.
33
Louis Mairet, Carnet d'un combattant, Paris, Georges Crès, 1919, p. 292.
34
Annick Cochet, L'Opinion et le moral des soldats en 1916 d'après les archives du contrôle postal, thèse de doctorat, J.-J. Becker (dir.), soutenue à l'université de Paris X Nanterre en 1986, p. 167.
35
Voir par exemple Rapport général du 15 au 21 novembre 1915, Rapport du secteur postal n° XVIII du 19 au 25 décembre 1915 (SHD 16 N 294), Rapport du 9 au 16 février 1916, Commission du contrôle de la correspondance de la 1ère Armée (SHD, 16 N 295).
36
SHD, 16 N 295, 1er mai 1916, Service courant contrôle postal. Sur les correspondances des troupes.
37
SHD, 16 N 1519, Bureau des services spéciaux, Bulletin confidentiel n°2, semaine du 9 au 15 juillet 1917.
38
SHD, 16 N 1519, Bureau des services spéciaux, Bulletin confidentiel n°6, semaine du 5 au 11 août 1917.
39
James C. Scott, La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne. Paris, Éditions Amsterdam, 2008.
40
Les dossiers dont il est question ici sont extraits des archives des conseils de guerre aux armées de la 3e division d’infanterie.
41
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Corbu, Jules, 19e RC.
42
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Rapport du lieutenant commandant le 4e escadron du 19e RC, décembre 1915.
43
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Interrogatoire du chasseur Corbu Jules sur les faits qui lui sont reprochés, sans date.
44
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Rapport du lieutenant commandant le 4e escadron du 19e RC : « d’abord j’en ai assez du 19e vous n’êtes tous bons qu’à vous branler les couilles à 40 km en arrière du front ».
45
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Interrogatoire du chasseur Corbu Jules sur les faits qui lui sont reprochés, sans date.
46
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Interrogatoire du chasseur Corbu Jules sur les faits qui lui sont reprochés, sans date.
47
SHD, 11 J 385, CG 14/12/1915, Rapport du capitaine Fontanet 4e Cie tendant à faire traduire devant un CG le soldat Poizeau, 16 juin 1916 : « (…) il est un très mauvais exemple pour ses camarades et très dangereux pour les gradés et ses chefs... »
48
Pierre Drieu la Rochelle, La Comédie de Charleroi, [1934], Paris, Gallimard, coll. Folio, 1982, p. 68.
49
Charles de Gaulle, « L'action de guerre et le chef », in Revue militaire française, tome XXVII, janvier-mars 1928, p. 299-316.
50
André Bridoux, Souvenirs du temps des morts, Paris, Albin Michel, 1930.
51
Paul Vaillant-Couturier, in Ce que j’ai appris à la guerre, Paris, éd. Montaigne, 1927.












