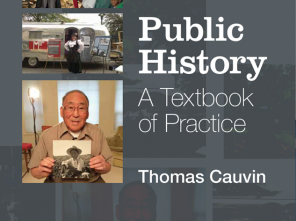(FLEPES - Académie de Versailles)
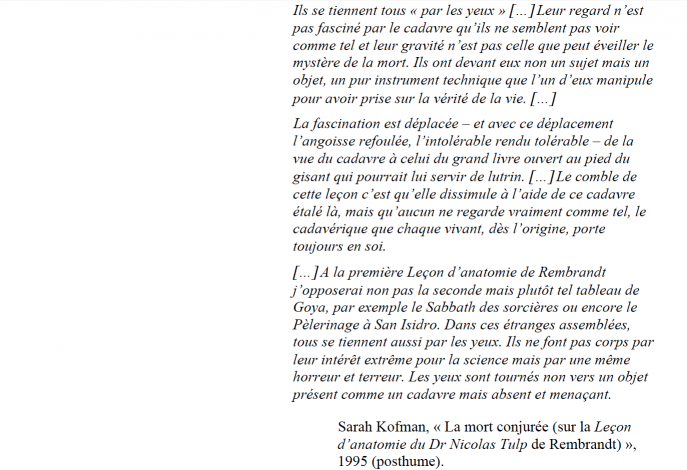
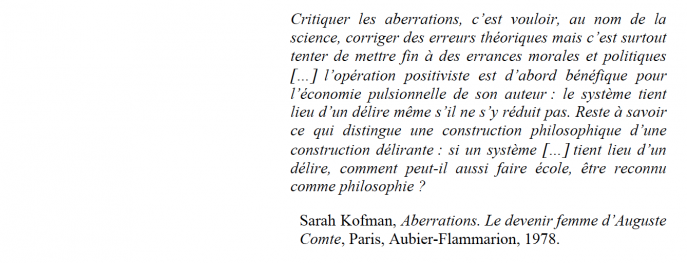
Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine) est un livre collectif1, déjà âgé de quatre ans, qui propose un ensemble d’interventions internationales de chercheurs et praticiens de différentes disciplines (principalement : chercheurs européens en histoire ou philosophie et praticiens hospitaliers engagés dans l’éthique médicale), dont la réunion fut organisée pour un colloque public, à l’Institut Goethe en novembre 2011. Sa particularité la plus intéressante, qui a déterminé ma décision d’en parler dans ces lignes, est d’être situé en dehors de tout programme de recherches, juste porté par une initiative de débat civil dans la sphère publique. J’entends par civil, pour ce livre, cette qualité due à des situations pratiques convoquant les prises de parole, qualité propre à l’agir en commun où Hannah Arendt voit la faculté de liberté humaine, liberté toujours politique, sociétale, et liberté qui se conditionne à l’obligation individuelle de choisir, selon que nos choix et paroles nous définissent dans le registre responsable de l’éthique (pas de façon totale, ni de façon générale, juste : « que dois-je faire ? »). Aussi dominent d’emblée, par ce geste portant ce livre, l’impossibilité vivante de toute synthèse sur le sujet d’éthique médicale et politique qu’il aborde ainsi que l’irrévocable disparate (ou pluralité polyphonique, ou différend) entre les prises de parole qui s’y engagent.

Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort. Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine, Paris, Vendémiaire, 2014.
Je voudrais insister sur un paradoxe : la pertinence civile de ces réflexions est inséparable de certaines de leurs faiblesses rhétoriques dues à leur disparate assumé. En effet, l’ensemble du livre affronte ce qu’on a coutume désormais d’appeler l’impasse du passé et il le fait sans parcours systématique préalable (par exemple, une partie des procès de Nuremberg est évoquée sans qu’un exposé spécifique lui soit consacré). Grâce à ce manque, on mesure en le lisant à quel point il s’agit bien de hantises, de réminiscences incompréhensibles, toujours en attente d’être pensées... Par sa force et ses faiblesses paradoxales, le livre permet au lecteur d’éprouver, en allant d’article en article sans vue d’ensemble disponible, que penser ne peut consister à affirmer simplement de façon moraliste que le passé ne passe, en dénonçant en général les crimes contre l’humanité – cette possibilité performative effrayante dont la généalogie des démocraties dépend. Comme l’a montré la philosophe Sarah Kofman, dans les travaux que j’évoque en exergue, la raison critique (épistémologique et morale) ne peut pas simplement servir de protection psychique ou d’exutoire pour nos inquiétudes les plus troubles, les plus malaisément accessibles. Si c’était le cas, l’histoire serait une donneuse de leçon efficace à coup de preuves rétrospectives (de culpabilité pour les uns, d’innocence pour les autres), un étrange rempart de certitudes établies sans pourquoi (« Hier ist kein warum »), contre l’erreur et contre la fatalité qui inscrit l’effroi d’un tel crime en politique également que de façon existentielle prégnante.
Qu’est-ce qui est en jeu dans ce qui ne passe pas ? Et qu’est-ce qui est jeu singulièrement, ici : en éthique médicale contemporaine rapportée au code de Nuremberg ?
Une proposition épistémologique (théorique) en éthique, et ses limites
L’introduction (p. 9-15), mise au regard du plan du livre (p. 381-383), montre comment le travail des maîtres d’ouvrage, Lise Haddad (philosophe, consultante en éthique de la clinique médicale, notamment membre de la SRLF, société savante créée en 1971 par des médecins réanimateurs2) et l’historien contemporanéiste Jean-Marc Dreyfus (spécialiste « des configurations génocidaires »3), a consisté à tisser une cartographie ordonnant les propos des différents contributeurs sans que leur propre questionnement initial s’y résolve. Cet essai d’ajustement dessine quelques propositions logiques peut-être significatrices du problème que les auteurs du livre affrontent.
Le plan du livre, par-dessus le détail de ses contenus, présente une trame épistémologique articulée à celle que certaines interventions entendent à l’évidence affirmer pour l’ensemble de la question posée : on commence en effet par une partie dite de « fondements théoriques » (p. 17-50). En avançant dans la lecture des parties suivantes, on comprend que ces « fondements théoriques » sont ceux que l’on attribue aux pratiques et crimes médicaux nazis (en l’occurrence le darwinisme et l’esprit de classification du XIXe siècle)4, à la fois parce ce que certains intellectuels nazis s’en réclamaient (dans le domaine de la santé et de l’hygiène) et parce que des chercheurs ont rétrospectivement accentué cette généalogie idéologique. Mais est-il rigoureux d’attribuer des « fondements théoriques » aux crimes nazis ?
Le livre n’interroge pas directement cette affirmation qu’il dispose par sa charpente et son entrée en matière. Or ne pas l’interroger en soi envoie directement dans le problème abyssal que toute construction rationnelle de la généalogie du nazisme produit. Il y a une sorte de valeur logique du fondement ou de la théorie qu’on retrouve revendiquée dans les arguments propres à la banalité du mal (qu’on entend dans les défenses des accusés des crimes contre l’humanité), de même que dans le négationnisme, et cette teneur rationnelle embarquée là forme un piège : ou bien on voudra invalider le criminel avéré qui tient des propos, par exemple, de type moral sans pour autant invalider ce qu’il dit ; ou bien on incriminera rétrospectivement la morale invoquée de permettre ou de ne pas empêcher qu’on l’utilise à des fins criminelles...
De la sorte, au niveau de la composition de l’ouvrage, cette affirmation insuffisamment interrogée de « fondements théoriques » trouve son pendant dans les « conclusions » du livre (p. 289-318). Elles sont, elles aussi, posées dans le registre théorique ou fondamental de la philosophie, ici de la philosophie morale : les contributeurs des conclusions réaffirment successivement l’universalité logique, ou en raison, de la morale, puis un état d’urgence impérieux du temps présent dans le champ médical, enfin une obligation inéluctable (parce que liée à l’avènement progressif de la démocratie moderne) de substituer l’éthique de la responsabilité à l’ancienne recherche du bien5. Il y aurait un sens de l’histoire en quelque sorte, à travers un présent caractérisé par l’urgence il faut accentuer la démocratisation en augmentant, en elle, la régulation éthique, en tant que l’éthique permet de s’orienter dans un tel présent sur la modalité même de la démocratie...
La charpente du livre produit donc une première, et double, proposition :
- d’une part, il conviendrait de toujours revenir aux cauchemars positivistes du XIXe siècle pour éclairer nos investissements de la médecine qui, par ailleurs, ne cesse de se perfectionner techniquement et cognitivement ; et il convient que ce retour soit critique, c’est-à-dire selon la démarche réflexive de la critique du jugement où la question « que puis-je savoir ? » (connaissance historique comprise) oriente ou éclaire celle « que dois-je faire ? » ;
- d’autre part, ce qui va devenir le cœur du livre et de son propos (décliné par les trois autres parties), est résolument encadré par une configuration épistémologique très repérable, procédant de ce recours théorique que je viens juste d’évoquer : en revenant aux « fondements théoriques » du nazisme on peut connaître ce qu’il convient de révoquer historiquement et moralement. Je qualifie théorique cette épistémologie, par son aspect systématique (valant à travers un certain sens historique) et par sa prétention régulatrice de la pluralité irréductible des contributions invitées dans le livre et qu’elle est mise en position d’encadrer.
Restent alors les propos posés dans les trois parties, qui excèdent cette charpente épistémologique : la pluralité des réflexions et des analyses attestées par les contributions qui n’en relèvent pas limitent l’impact de l’esprit de synthèse qui introduit et qui conclut le livre.
Le cœur du livre, tout d’abord, ne constitue pas une configuration historique simple, ni sous ses aspects principaux ni seulement par un état des lieux la recherche récente en éthique médicale ou concernant le code de Nuremberg. Autrement dit, on ne trouvera pas d’approche de l’histoire des procès de Nuremberg ou de ce qu’ils ont tenté de juger par ses causes ou fondements (en outre, bien des historiens ont montré que l’histoire nazie de la médecine, notamment, n’est pas directement rattachable aux idéologies du XIXe siècle évoquées en première partie ; il faut en passer par le détail politique, socioéconomique et intersubjectif6 des pratiques médicales et de l’avènement du nazisme puis du IIIe Reich pour l’entreprendre ; à juste titre, en plus des notes des intervenants, la « Bibliographie sélective » donnée en fin du livre permet un aperçu sur les recherches internationales récentes à ce propos, p. 371-372).
Les trois parties (en réalité les parties 2, 3 et 4) disposent plutôt un problème moral vécu, un malaise actuel, sous divers aspects dont l’étude reste inachevée ou interminable. L’interminable procède des faits et recherches historiques, politiques et juridiques qui incorporent ou, plutôt, sont augmentées et bouleversées par les prises en compte des témoignages de victimes. Les terribles « paroles de survivants », très présentes dans l’ouvrage, modifient complètement l’économie des débats historiographiques, le travail de mémoire et le débat sur sa valeur dans l’espace public7.
Dans la deuxième partie (p. 53-127), quatre interventions8 rappellent, sans prétention exhaustives, les crimes médicaux nazis organisés, justifiés et perpétrés à différents registres : par le médecin de Hitler, lors des expérimentations d’Auschwitz, selon l’administration étatique et de ligue de la médecine, par ses opérations massives d’euthanasie. La plongée dans les différents cas de figure fait signe vers la complexité sociétale interminable du processus génocidaire, sans lâcher la piste ferme des actes imputables à des auteurs précis.
Les trois interventions de la troisième partie (p. 129-190)9 font face au fait politique de ces crimes médicaux d’État et regardent les travaux engagés dans les réparations des dommages, fussent-ils incommensurables (au registre de ce que l’humain fit à l’humain en abîmant le pacte humain lui-même) : précisément, face à cela, toute « justice [est] imparfaite » énonce le titre de cette partie. La banalité du mal reste bien l’ombre portée de la criminalisation progressive des médecins dans le régime nazi ; les procès des médecins criminels ont continué avec bien des aléas « du côté soviétique » et au-delà de la guerre froide, ils sont inachevés ; aucune indemnisation n’est aisée ni satisfaisante, au plan matériel comme au plus subjectif individuel et interindividuel, le constater n’est pas s’y résoudre. La quatrième partie (p. 193-288) nous place en regard vis à vis de cette plongée dans l’histoire des crimes médicaux les plus massifs du XXe siècle européen : un article énonce enfin la question proposée par l’introduction, savoir celle de considérer s’il y a une « éthique après Nuremberg ».
Cette partie est la plus surprenante. Elle commence de façon formellement conforme à l’initiative énoncée lors des deux premiers chapitres : se plaçant dans l’urgence éthique et démocratique du présent, le premier article10 dispose une configuration dialectique, de principe, pour traiter de la question actuelle du « consentement » éclairé attendu de la part de tout patient. Ce consentement détermine en effet l’exercice médical démocratique, à partir de législations encore récente, notamment en France11. On apprend à la lecture du livre que ce type de législation démocratique a été initié lors du de la conception du code de Nuremberg. Malgré ce premier temps, ce chapitre renvoie imparfaitement au sous-titre du livre qui évoque en effet « le code de Nuremberg » sans qu’on ne dispose toutefois nulle part d’une information historiographique faisant un point récent quant au procès dont émane ce fameux code et ce qu’on en connaît à présent. Qu’on ne dispose d’aucune information dédiée à ce code même constitue à l’évidence une lacune (deux interventions reviennent sur le procès et le code de Nuremberg, mais au détour de leurs pages12). Plus surprenant que cette lacune, la suite des considérations éthiques de cette partie13 se démarque nettement de la configuration néokantienne et épistémologique (autrement dit transcendantale) que j’ai soulignée d’emblée en tant qu’elle prétend charpente le livre et qu’on retrouve à l’œuvre dans l’intervention sur le consentement juste évoquée. Ce qui suit, en effet, n’est en rien transcendantal.
En premier lieu, vient une étude de différentes opérations de repentance et réhabilitation d’institutions allemandes de recherches en sciences de la vie qui ont survécu à leurs implications criminelles sous le nazisme. L’article s’ouvre par les tourments et polémiques, argumentées, suscités lors d’une cérémonie d’excuse en 2001, à Berlin-Dahlem, initiée durant un colloque scientifique par le directeur de la Max Planck Gesellschaft, Huber Markl. Ce dernier s’excusait au nom de l’institut pour les crimes commis par l’élite allemande des spécialistes des sciences de la vie et de l’expérimentation humaines rattachés à la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, sur des êtres humains sous le IIIe Reich14 (j’y reviens pour finir). Est ensuite proposé un parcours de l’état des lieux contemporain (XXe et début XXIe siècles) des crimes en médecine (expérimentations et clinique) ainsi que des dispositifs éthiques pour les prendre en compte, y parer de façon démocratique, collective, interactive, publique15. Enfin, une étude plus culturelle (du malaise dans la culture) de la « carence éthique » qui se « creuse » dans le langage moderne et contemporain (XIXe, XXe siècles) est développée. L’auteur, en les apposant pour les éclairer autrement, relève des paroles écrites et prononcées (littéraires, ordinaires, savantes) dans différents champs concomitants, relatifs aux pratiques nazies de la médecine, aux sciences de la vie (en rien nazies), aux entreprises d’expérimentation visant le progrès de la recherche16. Cette démarche de réflexion éthique n’a rien à voir avec une recherche des « fondements » des crimes nazis, elle regarde comment la parole achoppe sur sa propre portée, comment parler nous échappe et nous revient en miroir oblique. Ce qui est éthique, là, c’est d’assumer le performatif du dire et du dit (de l’écrit, du publié).
Au lieu de considérer cette auto-contradiction dans le tissu éthique du livre (contradiction entre une charpente et ce qui l’excède) comme étant, en toute logique (théorique et pratique) susceptible d’invalider son propos, je propose de ne pas souscrire à cette perspective transcendantale et de chercher, au contraire, dans ses contradictions, son foisonnement d’études, ce qui en trame la validité : non pas malgré ce disparate (nul n’a le dernier mot sur les questions abordées) mais bien à travers lui et, plus encore, par l’insatisfaction que cela sollicite (aucun dossier n’est clos, rien n’aboutit). Précisément, cette économie me semble relever du malaise en actes et contemporain, de son assise sociétale même. Regardé dans sa dynamique de paroles, ce livre se révèle un essai qui donne à penser de façon active ou interactive, par le travail d’une lecture bousculée, notre destin sociétal actuel tout en considérant que le recours au passé, dans ce temps présent, constituerait un geste éthique n’ayant à sa seule disposition que le fil de la parole, dite, pensée, motrice.
En effet, ce n’est pas le recours à l’épistémologie qui convainc ou valide les considérations éthiques de ce livre mais plutôt tout ce qui résiste à cette épistémologie, en attestant une économie vécue de la réflexion, celle qui s’édifie en s’exposant. Le disparate des points de vue porté par le livre, chacun y étant tenu par sa rigueur propre, garde une préséance inchoative sur sa propre tentative d’ordonnancement : mettre en ordre les propos ne contient pas leurs différences, celles-ci renvoient à la complexité trouble de la question posée, à l’impossibilité de la trancher ou la clarifier ou y mettre fin comme à l’incapacité intellectuelle ou réflexive de la réguler pour tous (ce sont les rapports entre la recherche éthique et la situation démocratique qui s’avèrent eux-mêmes non théoriques ou non théorisables). Tel est le matériau incandescent de la question affrontée : lorsqu’il s’est agi de juger des crimes commis par les médecins et scientifiques nazis, toute tentative de définition théorique ou conceptuelle du « crime médical » s’est avérée réfutable et retournable contre ceux mêmes qui s’en servaient pour accuser les génocideurs. Telle fut l’expérience pénible du procès des médecins nazis de Nuremberg dont est aussi « né » le code de Nuremberg. Or cette expérience semble bien se répéter depuis, tel serait le rapport non généalogique entre hier et aujourd’hui.
L’actuel du passé : il n’y a pas de progrès en médecine
Cette tentative étoffée de lecture publique et actuelle du passé criminel de la médecine montre que les réponses contradictoires jugeant, dénonçant, luttant contre ces crimes singuliers appartiennent à l’actualité de ce passé, à son accessibilité. Cet indissociable est la hantise même qui réclame notre attention et notre effort de penser : comme le titre « médecine de mort » l’indique, non sans choquer (à moins de choisir le cynisme), cette hantise du morbide humain dans le soin qui le constitue éthiquement (selon le souci premier de l’autre) procède, de part en part, de l’univers présent des pratiques médicales tel qu’on peut le percevoir et en être, à un moment ou un autre nécessairement, usager dans une démocratie contemporaine17. Cette hantise prégnante, tantôt visible tantôt plus sourde, ne tient pas exactement au fait que l’univers médical, dont nos vies dépendent une à une, est complexe en remaniements scientifiques et techniques constants (démesurément inaccessible pour le citoyen ordinaire, aussi instruit soit-il). Non. Elle tient à ce que cet univers, l’élan de connaître qui le meut et le légitime, est animé d’un aveuglement inhérent aux sources létales de la médecine : en butte avec ce qui empêche ou attaque la vie, elle soigne entre ses avancées, expérimentations, pratiques et administrations politiques et financières, où aucune des composantes n’est lisible sans ses imbrication dans les autres.
La dynamique d’Une médecine de mort cherche à alerter ses destinataires d’une façon qui renvoie à une telle hantise en sous-main : un désordre de réminiscences d’un passé social et politique criminel, que le lecteur de l’essai est invité à étudier sur une scène non spécialisée d’inquiétudes éthiques. En revenant cette fois à l’introduction, on peut lire que c’est une conversation ordinaire, celle des deux éditeurs entre eux, qui initie un usage public du passé, et non un champs de recherches qui publie des résultats partageables :
[Cet ouvrage] a été conçu à partir des nombreuses conversations que nous avons eues au sujet de nos recherches et de nos réflexions, en apparence bien éloignées […] Notre désir de réunir des historiens et des philosophes pour produire un récit historique nourri des concepts de l’éthique contemporaine est parti d’un simple constat : certaines nouvelles techniques médicales litigieuses, ainsi que les débats, les controverses et les réflexions éthiques qu’elles impliquent, sont systématiquement évités par l’Allemagne, pourtant l’une des premières puissances économiques et scientifiques du monde. Sont évoquées “d’évidentes raisons historiques” qui n’ont jamais été explicitées et qui se contentent de renvoyer à ce que les Américains appellent les “medical crimes” […] Leur importance dans l’imaginaire occidental et dans le développement de la réflexion médicale rend leur étude indispensable. De fait, de nombreux historiens, pour la plupart allemands ou américains, consacrent depuis une dizaine d’années leurs recherches à ces chapitres noirs de l’histoire européenne […]. Lire ces travaux permettrait d’évite[r] ainsi de tomber dans l’illusion selon laquelle les interrogations contemporaines ne sont suscitées que par les avancées techniques récentes. Toutes les recherches historiques existant dans ce domaine […] trouvent un écho dans les réflexions éthiques contemporaines18.
En réalité, le constat que nous proposent ces deux intellectuels nous plonge dans l’angoisse, c’est-à-dire dans une inquiétude sans objet précis, loin de la simplicité censée le qualifier : ils dessinent d’emblée un domaine très, trop étendu, dans l’espace et dans le temps « occidentaux » modernes, vaste champs constant de crimes perpétrés par des médecins ou au nom de la médecine, crime tenant lieu de l’acte médical même - d’où le titre effarant du livre, « médecine de mort ».
Le lecteur comprend peu à peu que c’est conformément au titre de la deuxième partie, « Médecine nazie, médecine de mort » (p. 53), que l’expression terrible « médecine de mort » désigne, par condensation ou métonymie, à la fois le complexe circonscrit de la « médecine nazie » et un ensemble plus actuel de crimes médicaux. En partant d’un nœud historique (qu’on peut a minima tracer entre la création des premières ligues allemandes d’étudiants et de médecins nationaux-socialistes (1928 à 1930), et l’effondrement du IIIe Reich)19, l’acception de « médecine de mort » est étendue à l’actuel de la médecine : il n’y a pas de progrès médical dans la perspective du code de Nuremberg20.
L’usage public du passé que proposent Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus est donc, non seulement d’en appeler aux « concepts » éthiques, mais aussi d’invoquer l’expression américaine de « medical crimes », dérivée du code de Nuremberg, pour spécifier l’actualité angoissante de la « médecine de mort ».
Quelques précisions annexes à propos du code de Nuremberg
Pour quelque clarté, et sans prétendre faire état de la recherche, j’ajoute ici quelques éléments à ceux que présente le livre, pour synthétiser une première approche de ce code à partir des études qui y donnent aujourd’hui accès.
Il s’agit d’une liste de dix critères de licéité, pour l’expérimentation médicale, encore souvent prises seulement comme une liste de préconisations ou recommandations éthiques. Elle a été progressivement élaborée, notamment par deux experts américains (Leo Alexander et Andrew Ivy) au cours du procès des médecins à Nuremberg et définitivement mise en forme par les quatre juges à la fin du procès (l’auteur précis, individu ou équipe, n’en est toutefois pas assurément identifié). Aussi appelé « second procès de Nuremberg », le procès des médecins nazis criminels eut lieu du 9 décembre 1946 au 19 août 194721. On dispose enfin, en français tout au moins, du texte du code de Nuremberg de façon critique, grâce à l’étude de ses « déformations » dans la réception (ici, française), étude publiée en 2009 par les chercheurs Philippe Amiel et François Vialla, qui en rétablissent la validité juridique22.
Ce qui est aujourd’hui unanimement retenu parmi ces critères de licéité (auxquels d’autres commissions d’expertises d’autres crimes médicaux, évoqués dans Une médecine de mort23, en ont ajouté d’autres), c’est la nécessité du consentement du patient, le caractère nécessaire de la recherche (enjeu de vie et de mort pour l’espèce humaine, inaliénable et non privatisable), l’interdiction de privilégier l’intérêt général de la société aux dépens de l’intérêt propre du patient (souffrance, mort, dommage évitable ou durable). Évoquer la continuation de ces débats éthiques et leur profusion, si déterminantes aujourd’hui, nous éloignerait toutefois du propos de ces lignes.
Ce procès, les Russes soviétiques n’y ont pas participé à cause de la guerre froide déjà enclenchée, ce qui écarta un certain nombre de crimes majeurs hors du champ couvert par les accusations (ces cas ne sont pas encore tous jugés ni les archives de leurs jugements toutes ouvertes ou étudiées). Il opposait le gouvernement militaire américain à un groupe de vingt médecins et trois scientifiques allemands. Il avait les mêmes fondements légaux (et limites) que le premier procès contre les crimes contre l’humanité, une loi fixée lors des accords de Londres en 1945 et son inscription explicite dans la continuité des décisions prises pendant la guerre par différents États européens de poursuivre les criminels nazis.
Les crimes médicaux jugés sont effroyables (je ne reviens ni sur l’opération T4 et ses extensions, ni sur les expérimentations dans les camps de concentration et les centres de mise à mort, ni sur l’envergure économique complexe et établie de l’ensemble de ce système de « santé » ayant concerné l’ensemble du corps médical allemand sous le régime nazi ; et tous les médecins actifs dans ce système n’étaient pas des nazis24), mais la défense des accusés ouvre la boite de Pandore de pratiques expérimentales et d’arguments qui justifient l’insoutenable, de façon autrement plus tenace, répandue, durable : les inculpés contrattaquèrent, d’une façon morale qui laisse encore pantois – et réclamerait une analyse approfondie comme je l’évoquais d’emblée, à propos de l’ambiguïté de reconstituer des « fondements » pour cela – : en invoquant le caractère obsolète du serment d’Hippocrate, la responsabilité du totalitarisme hitlérien, le caractère désintéressé des chercheurs, le souhait d’améliorer le sort de l’humanité, la limite des modèles animaux expérimentaux, l’occasion pour les détenus de se racheter pour les crimes qu’ils avaient commis, et l’analogie avec les expériences menées aux États-Unis (argument en réalité en deuxième position dans l’architecture de la défense). Arguer des crimes médicaux des expérimentations médicales américaines (USA) conduites avant et pendant la période de guerre, mit l’accusation et certains de ses témoins en grande difficulté. De ces affrontements émanent le code et ses ambivalences : il pare aux coups de la morale accusée qui, elle, attaque. Étrange économie renversée, native en cela de l’éthique contemporaine sommée de répondre des crimes contre l’humanité. Or de tels crimes ont continué dans l’univers occidental démocratique après 1947 (ils sont bien sûr évoqués dans Une médecine de mort25 ). Pire, d’aucuns ont cherché à sauver les données des recherches nazies, ont continué de défendre les droits absolus de l’expérimentation pour la pure recherche (le progrès visant un bien à venir), certains expérimentateurs nazis connurent une carrière ultérieure (tel Werner von Braun recruté par les USA pour la recherche spatiale) et un médecin, encore honoré aujourd’hui par ses pairs allemands, ancien membre de la SS, présumé coupable de la mort d’enfants en nombre, se retrouva, en 1992, président d’une commission internationale d’éthique médicale26.
Non seulement le code de Nuremberg n’eut longtemps pas d’effet au-delà de ce qu’il fut juste reconnu utile et « bon pour les barbares » exclusivement27, mais il contraint de considérer l’histoire longue des crimes perpétrés dans le cadre et au nom de la médecine en les replaçant au cœur de l’histoire même de la médecine. Et celle-ci nous renvoie face à un miroir troublant dans le rapport au passé et dans le rapport à la démarche de connaissance : l’histoire de la médecine est celle de la distorsion inévitable des repères éthiques qu’elle édifie en marchant ; l’économie même de la connaissance médicale est connaissable à travers l’histoire de ses résistances mortifères à l’éthique... en quelque sorte comme si la démarche de connaissance et la morale qu’on y rattache (comme faculté de juger) se neutralisaient l’une l’autre.
Oser penser le délire de la raison même ?
C’est par ce court-circuit que le recours épistémologique ou dialectique trouve ses limites. C’est dans ce court-circuit que les interrogations non moralistes de Sarah Kofman, évoquées en exergue, sur l’attractivité sociale de la part délirante d’un système philosophique ou rationnel n’a pas fini de nous pousser à penser.
Le délire n’invalide pas la raison où il se niche, constate-t-elle, il sert au contraire la santé de l’auteur (et ce constat, chez elle, est à la fois nietzschéen et freudien). Dans plusieurs études (à la suite de ce que dit Nietzsche sur Socrate et son rapport révélateur à la maladie des Athéniens)28, elle montre qu’on ne peut invalider simplement une œuvre dont l’auteur bascule dans la folie (Nietzsche), au motif d’un tel effondrement. A contrario, mais cela procède de la même ambivalence à affronter, on ne peut dire non plus d’une personne censée inscrite dans un système d’actes délirants et criminels qu’elle s’est simplement « égarée » sous la pression dudit système (argument souvent entendu à propos des crimes médicaux et pas seulement). Paradoxe auquel s’est confrontée Hannah Arendt, provoquant la controverse sans l’avoir voulu. Dans son étude la plus saisissante à cet égard, Aberrations. Le devenir-femme d’Auguste Comte29, Sarah Kofman montre que la rationalité de ce positivisme, qu’on attribue aux sources objectives et raisonnées du nazisme, est rigoureusement porteuse d’une folie privée qu’elle dissimule en en protégeant celui qui l’écrit, qui s’y fait publiquement accepter comme un savant progressiste alors même qu’une perversité l’anime : Sarah Kofman appose aux lettres et livres de Comte des pages de l’étude de Freud consacrée au délire antisémite du juriste allemand Schreber30. Autrement dit, la fragilité morale des discours, qui n’empêche pas leur réversibilité (un nazi renvoie à son accusateur son propre raisonnement pour sa défense à lui), ne relève pas du seul jugement, ni de la raison morale, elle tient à la position éthique de la parole même, de son énonciation face, avec l’autre, les autres : c’est par là que la question éthique est accessible, porteuse, mais elle l’est comme en deçà de toute l’économie culturelle dont, simultanément, nul ne peut s’extraire. S’ouvre, ici et entre tous ces cas, une série de buttées problématiques ; matière à recherches aussi « urgentes » que celle de revenir à l’impensé du passé. Ce qu’énoncent les criminels procèdent de nos langages...
Le travail de Kofman montre comment accepter, en philosophie (donc dans la démarche de la réflexivité, de l’élucidation, de l’éclairement), l’économie intime du délire et de la raison, en en considérant par le détail l’amplitude culturelle inévitable. Ce geste oriente le regard critique par l’affrontement de cette fragilité plutôt que sur des procédés fondamentaux pour conjurer la déraison : face à l’ambivalence, il n’y a pas de moyen de trancher et d’extraire le mortifère, le délétère, la possibilité et l’effectivité du crime. L’assumer n’est pas l’accepter, c’est initier le travail interminablement, en s’engageant dans les eaux troubles par le choix de faire en sorte d’en sortir, inlassablement. Aussi, pour affronter l’actuel du passé, ne faudrait-il pas déplacer la critique généalogique du contemporain dans l’étude des écrits des criminels contre l’humanité les plus censés plutôt que dans ceux qui en seraient les précurseurs mais dont les auteurs n’ont pas eux-mêmes commis de tels crimes ? Le plus difficile est de devoir lire ça31.
Le dernier mot de ma lecture sera rendu à l’une des contributions d’Une médecine de mort et aux voix citoyennes qu’elle relaie. L’article de Carole Sachse32 parcourt différentes tactiques de réhabilitation et de repentance d’institutions allemandes intimement impliquées dans les crimes médicaux nazis. Elle conforte en cela les analyses des limites effectives des rituels de contrition publique auxquels les politiques recourent pour assumer une histoire politique criminelle sans la dénier ni s’y détruire. Elle met en valeur les confrontations publiques auxquelles cela donne lieu – en évoquant le détail des arguments et contre-arguments des parties en présence. Ces confrontations se déploient grâce à ceux qui, de cette façon, maintiennent la qualité démocratique du problème de l’héritage des crimes médicaux, problème qui comprend les procès de ces crimes, comme geste politique obstiné d’œuvrer à leur criminalisation pénale. A lire ces débats, on comprend comment, à quel prix aussi, il n’est d’éthique en politique que dans la mesure où sont inlassablement affrontés et déployés des désaccords qui résistent, qui resteront interminables parce que l’ambivalence se referme comme la mer efface le sillage des bateaux qui la traversent. Que le différend soit exposé plutôt que refusé tend aussi à indiquer que l’éthique est de nature réactive, elle n’est pas spontanée ni déjà là : elle est un choix intransmissible. Il faut recommencer, parce que la réminiscence précède le choix d’en sortir. Chaque génération, partant, en elle, chaque individu se voit contraint de refaire le choix de l’éthique. Sans cette chaîne généalogique discontinue où chacun est irréductible, à la fois solidaire (au sens contractuel et au sens biologique) mais seul (libre en cela), le mot d’éthique n’a sans doute aucune assise. C’est de cette façon que l’argument du travail de mémoire, qui refuse que l’histoire ne soit qu’une parole impersonnelle, nous reconduit dans la vie humaine et intersubjective de sa transmission.
Carole Sasche rapporte ainsi le propos de Joan Laks à l’encontre de la déclaration d’excuses de Huber Markl, pour les crimes commis par l’élite allemande des spécialistes des sciences de la vie et de l’expérimentation humaines rattachés à la Kaiser Wilhelm Gesellschaft, sur des êtres humains sous le IIIe Reich (Jona Laks, Tel Aviv, est présidente de l’organisation « des jumeaux de Mengele » qui rassemble les jumeaux victimes d’expériences médicales à Auschwitz). Huber Markl, au cours des controverses liées à sa demande d’excuse, prônait pour finir la reconnaissance du passé criminel de l’institution uniquement en prenant appui sur « les résultats incontestables » de la recherche scientifique. Argument moral et cognitif à la fois, c’est-à-dire les deux ensemble (où l’on retrouve l’épistémologie), il entend ainsi « faire table rase des crimes nazis »33. Or Jona Laks, sans prendre en rien position sur la question du pardon, ni se prétendre destinataire de quelque chose qui ne peut s’adresser qu’à des morts, a rétorqué :
Vous voulez faire “table rase des crimes nazis” dont nous voulons conserver le souvenir […]. Nous exigeons de vous que vous fassiez mémoire de ce dont vous voulez faire “table rase”…34.
Il ne s’agit pas de faire régner le joug moral du devoir de mémoire mais de renouer chaque fois le procès dont la pensée éthique se trame entre nous, intimement, invitant à choisir sans pouvoir y contraindre.
Notes
1
Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014.
2
Société de Réanimation de Langue Française, en voir la présentation ici. Site consulté le 31 août 2017.
3
Il contribue notamment à la revue en ligne La vie des idées. Site consulté le 2 septembre 2017.
4
Interventions de Marino Pulliero (Paris, spécialiste de l’histoire intellectuelle allemande des XIXe et XXe siècles) et de Carole Raynaud-Paligot (Paris, spécialiste de l’histoire intellectuelle et raciale du XIXe siècle).
5
Interventions d’Eric Fiat (Marne la Vallée, spécialiste d’éthique médicale), Dominique Folscheid (Marne la Vallée, professeur de philosophie morale) et Heinz Wismann (Paris, directeur d’études à l’EHESS, herméneutique et histoire de la pensée allemande).
6
Je veux parler de tous les face à face entre « perprétateur » du crime médical et sa ou ses victimes, dont les survivants témoignent, d’ailleurs évoqués dans ce livre par deux études : Kamila Uzarczyk, « “J’entendais ses cris”. Paroles de survivants des expérimentations d’Auschwitz », in Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 69-91 et notes et références p. 339-343, et Carola Sasche, « Des excuses pour quoi faire ? », in Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 219-236 et notes et références p. 359-363.
7
Kamila Uzarczyk, « “J’entendais ses cris”. Paroles de survivants des expérimentations d’Auschwitz » (traduit du polonais par Eva Tartakowski), dans Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 69-91 et notes et références p. 339-343.
8
Interventions de Ulf Schmidt (Kent, histoire de la médecine), Kamila Uzarczyk (Wrocław, histoire de la médecine), Susanne Heim (Munich, histoire du nazisme et de la Shoah) et Patricia Heberer Rice (Washington, histoire de l’Holocauste).
9
Interventions de Dick de Mildt (Amsterdam, histoire du droit), Annette Weinke (Iéna, histoire de la justice) et Constantin Goschler (Bochum, historien notamment des spoliations et restitutions des biens juifs en Europe).
10
Intervention du théologien protestant et philosophe suisse, Jean-Marc Tetaz.
11
En 2002, deux lois sont votées, dans le champ de l’action sanitaire et dans celui de l’action sociale, toutes deux énonçant ce principe des droits et du consentement du « patient » ou de « l’usager », la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
12
Kamila Uzarczyk, « “J’entendais ses cris”. Paroles de survivants des expérimentations d’Auschwitz », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 90-91 ; et Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? » in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 238-242.
13
Interventions de Carola Sachse (Vienne, anthropologie historique du XXe siècle européen), Didier Dreyfuss et François Lemaire (praticiens hospitaliers et universitaires engagés dans la réflexion éthique à propos de la recherche) et de Gérard Rabinovitch (philosophe et sociologue spécialiste des « crises culturelles de la Modernité »).
14
Carola Sasche, « Des excuses pour quoi faire ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 219-236 et notes et références p. 359-363.
15
Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 237-258 et notes et références p. 363-365.
16
Gérard Rabinovitch, « Des “praticiens dotés d’un regard d’éleveurs” », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 259-288 et notes et références p. 365-369.
17
Pensons, comme Lise Haddad en parle, aux pratiques de réanimation par les anesthésistes en vue du prélèvement d’organes et dans un contexte de manque d’organes à donner. Les travaux d’expertise de Lise Haddad, souvent non publiés, sont notamment évoqués en ligne. Site reconsulté le 5 septembre 2017.
18
Lise Haddad, Jean-Marc Dreyfus, « Introduction », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 9-10.
19
Pour circonscrire cela de cette façon minimaliste, je prends par exemple aussi appui sur les travaux et recensions d’Yves Ternon : Yves Ternon, Socrate Helman, Les Médecins allemands et le national-socialisme. Les métamorphoses du darwinisme, Tournai, Casterman, 1973 et Yves Ternon, « Les médecins nazis », Les Cahiers de la Shoah 2007/1, n° 9, p. 15-60. Pour la recherche plus récente, voir bien sûr la « Bibliographie sélective » de Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 371-372 et les états des recherches disponibles dans les publications qu’elle réfère.
20
Sur le web, une vidéo d’entretiens brefs avec Lise Haddad et Jean-Marc Dreyfus (concomitante à la parution de l’ouvrage qu’ils dirigent, Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, en mars 2014) synthétise leur avant-propos et leur hypothèse de travail. Vidéo consultée le 9 août 2017.
21
Voir George J. Annas, Michael A. Grodin (dir.), The Nazi Doctors and the Nuremberg Code, New York, Oxford University Press, 1992 ; Paul Wendling, Nazi Medicine and the Nuremberg Trials : From Medical War Crimes to Informed Consent, Basingstoke, Palgrave-Macmillan, 2004.
22
Philippe Amiel, François Vialla, « La vérité perdue du “code de Nuremberg” : réception et déformations du “code de Nuremberg” en France », Revue de droit sanitaire et social, n° 4, 2009, p. 673-687.
23
Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 237-258 et notes et références p. 363-365.
24
Voir l’ouvrage précurseur d’Alexander Mitscherlich avec Fred Mielke, dont le premier titre fut Das Diktat der Menschenverachtung. Der Nürnberger Ärzteprozeß und seine Quellen, Heidelberg, Verlag Lambert Schneider, März 1947, le deuxième des mêmes auteurs : Wissenschaft ohne Menschlichkeit. Medizinische und Eugenische Irrwege unter Diktatur, Bürokratie und Krieg, Lambert Schneider, Heidelberg 1949 (la Chambre médicale allemande s’y opposa et le tirage fut intégralement détruit), enfin : Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses; Neuauflage von Wissenschaft ohne Menschlichkeit im Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt 1960. Désormais ce travail est référé sous son titre emblématique, « Médecine sans humanité ».
25
Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 237-258 et notes et références p. 363-365.
26
Ce cas, toujours controversé (comme le profil wikipédia anglophone de la personne le montre) est évoqué par Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 248 et note 21 p. 364. J’en tais le nom faute d’informations publiées étayées.
27
Didier Dreyfuss, François Lemaire, « De Nuremberg à nos jours : Quels changements dans l’éthique de la recherche ? », in L. Haddad, J.-M. Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 242 et suiv.
28
Sarah Kofman a publié de nombreux livres et articles sur les textes de Nietzsche, n’en citer qu’un seul serait manquer de rigueur.
29
Sarah Kofman, Aberrations. Le devenir femme d’Auguste Comte, Paris, Aubier-Flammarion, 1978.
30
Daniel Paul Schreber (1842-1911), juriste allemand, président de la cour d’appel de Dresde, fut l’auteur des Mémoires d’un névropathe (1903) : il se croyait persécuté par Dieu et prétendait avoir pour mission de se changer en femme pour engendrer une nouvelle race. Sigmund Freud a étudié son journal dans « Remarques psychanalytiques sur l’autobiographie d’un cas de paranoïa (le Président Schreber) » (1911), d’abord publié dans son ouvrage Cinq psychanalyses, (traduction française de M. Bonaparte et de R. M. Loewenstein), Paris, PUF, 1977. On le trouve notamment dans une édition française plus récente : Sigmund Freud, Le Président Schreber. Un cas de paranoïa, (traduit de l’allemand par Olivier Mannoni), Paris, PUF, 2011. [nb. Olivier Mannoni est le traducteur en français du Journal de Goebbels et de Mein Kampf].
31
Suite à la note précédente, concernant Olivier Mannoni, je renvoie à l’entretien que l’hebdomadaire Le Point avait publié après sa traduction de Mein Kampf de Hitler : Saïd Mahrane, « Olivier Mannoni, traducteur de “Mein Kampf” : “Un travail accablant” », le 20 octobre 2015 (consulté le 4 février 2018).
32
Carola Sasche, « Des excuses pour quoi faire ? », in L. Haddad, J.-M.Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 219-236 et notes et références p. 359-363.
33
Carola Sasche, « Des excuses pour quoi faire ? », in L. Haddad, J.-M.Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 227-228.
34
Carola Sasche, « Des excuses pour quoi faire ? », in L. Haddad, J.-M.Dreyfus (dir.), Une médecine de mort (Du code de Nuremberg à l’éthique médicale contemporaine), Paris, Vendémiaire, 2014, p. 229 et note 27, p. 362.