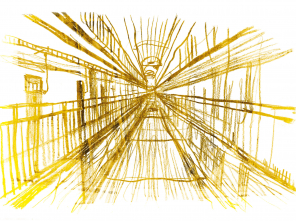Lorsque je propose à Marie Crétenot de retracer son parcours et son engagement, elle accepte sans réserve de se prêter au jeu. La démarche n’est cependant pas évidente pour une militante plus habituée à faire parler les autres qu’à raconter son parcours et ses propres expériences. Nous nous retrouvons dans un café parisien le 24 janvier 2020, installées dans un coin calme, propice à la confidence. L’échange se tisse au fil des questions, Marie exposant avec finesse ses réflexions et se refusant à des discours caricaturaux sur la prison. Elle décrit peu à peu, non sans émotions ni détours par des souvenirs forts, les étapes de son parcours à un moment très particulier pour elle : son départ de l’OIP (Observatoire international des prisons) après quinze ans de plein engagement. La transition est en cours lorsque nous réalisons l’entretien, Marie parle d’ailleurs parfois de l’OIP au présent, parfois au passé, et ce moment charnière s’avère particulièrement fécond pour la réflexivité. Son récit nous permet de retracer l’histoire d’un milieu et de l’OIP, organisation non gouvernementale de défense des droits et de la dignité des personnes détenues, souvent présenté comme un contre-pouvoir. À travers ce témoignage personnel d’un parcours de militante se pose la question du changement de l’administration pénitentiaire, des freins et les leviers permettant d’engager des réformes.
Caroline Touraut est sociologue, spécialiste des prisons. Elle a travaillé notamment sur l’emprise de l’institution carcérale sur les familles de détenus et sur la prise en charge des personnes âgées en détention. Elle est chercheure associée au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP).
Marie Crétenot est juriste. Membre de l’Observatoire international des prisons (OIP) pendant quinze années, elle a récemment quitté l’association militante pour rejoindre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).
Caroline Touraut – Jusqu’ici, tu as consacré toute ta carrière à la question carcérale, peux-tu revenir sur ton parcours et sur ce qui t’a amenée à t’intéresser à la prison ?
Marie Crétenot – J’ai commencé à m’y intéresser pendant mes études de droit. La fac de droit je n’ai pas beaucoup accroché. En première année, on ne s’intéresse pas du tout aux libertés publiques mais bon, j’ai fait mes années. Même quand j’ai eu des cours de droit pénal je trouvais qu’on ne se posait pas assez de questions… Je travaillais sur des exercices de rhétorique en dehors avec des proches. Quand j’étais au lycée, la plaidoirie de Julien Sorel dans le Rouge et le Noir, je la connaissais par cœur. Pour moi, ce livre, c’était une claque. Quand Julien arrive devant les jurés en disant, en somme : « Je n’ai pas l’honneur d’appartenir à votre classe, je ne suis pas jugé par mes pairs, mais je vais prendre la parole, me défendre avec vos armes », j’étais fan ! Moi, j’avais dès le départ cette vision du droit comme une arme : quelque chose que tu acquières et avec lequel tu vas pouvoir te défendre, qui va être au service de la défense. Donc à la fac j’étais quand-même assez tiraillée parce que ce n’était pas l’ambiance générale, même en droit pénal… C’était un apprentissage extrêmement froid, détaché des problématiques, des situations de vies… Quand j’ai étudié la procédure pénale, on n’a jamais abordé cette vaste question du sens de la peine. On pouvait te parler de Beccaria1 par exemple mais c’était présenté comme des principes établis, sans questionnement sur le système. Les études de cas concrets étaient encore plus rares. Je ne comprenais pas ce type d’enseignement et les étudiants ne se posaient à peu près aucune question. Je m’ennuyais profondément. Alors j’ai commencé à aller en prison dans le cadre du Génépi2 et ça répondait à ces aspirations-là, d’aller sur place, voir comment cela se passait. J’ai commencé à me rendre régulièrement à la prison de la Santé, tous les lundi matin, et quand j’en parlais à la fac, j’étais surprise ! Des étudiants qui étaient pourtant orientés vers une carrière judiciaire mais qui étaient très éloignés du réel, et qui étaient fascinés par le sensationnel me demandaient : « Mais tu n’as pas peur ? Ils sont comment ? ». Ils n’avaient pas vraiment de réflexion sur l’institution elle-même, ni sur le système pénal… Je trouvais ça assez étonnant d’avoir des étudiants qui s’intéressent à cette matière-là avec une telle mise à distance : « Ce sont des autres ! ».
– Pourquoi est-ce que tu as eu ce besoin de t’intéresser à la prison, d’aller voir à l’intérieur ? Comment l’expliques-tu ?
– Si je remonte dans le passé… Dans le jardin de ma grand-mère à Douai, je voyais la maison d’arrêt. Je ne sais pas comment je la voyais, petite, je ne sais pas ce que l’on m’a dit, même si on m’a dit quelque chose pour justifier l’institution, sa présence… mais ce bâtiment pour moi dégageait quelque chose de très mystérieux et surtout de très anormal. C’est étrange mais j’ai gardé une impression de silence. Je ne sais pas si elle est réelle… La prison a toujours représenté pour moi une interrogation… Mais ce n’était pas tant l’institution que les détenus qui m’intéressaient. Pas pour leur exotisme (« quel est donc ce groupe étrange ? ») mais j’ai toujours eu un vrai souci de rencontre, de comprendre ce qui se passe entre les murs. Au Génépi, à l’époque, ce n’était pas non plus très politisé, il n’y avait pas d’énormes réflexions sur l’institution, c’était vraiment fidèle à l’esprit initial d’aller faire de l’enseignement. Mais cette expérience en prison m’a nourrie de manière incroyable… C’était très étrange… Tout de suite on nous lâche avec une dizaine de détenus… On faisait un atelier cinéma, et je me souviens du conseiller d’insertion et de probation, qui regarde la liste et me dit : « Ah ce ne sont pas des anges ! ». Mais cela s’est super bien passé parce qu’il y avait plein de formes de régulations négociées dans le groupe, entre eux, vis-à-vis de moi, dans une forme de double respect. Ça c’était ma première année, ça devait être 2001… Ensuite j’ai refait une deuxième année au Génépi où on m’a donné un autre groupe mais je ne suis pas restée longtemps. C’était un atelier jeux de société, dans une salle informatique, avec une intervenante qui est venue une ou deux fois et qui est devenue surveillante… Donc je suis restée seule avec eux mais là, c’était tout à fait différent, je me suis retrouvée à devoir faire la police, à devoir gérer des ordinateurs dont je me foutais strictement mais on nous avait mis dans la salle informatique, avec des portes qui ne fermaient pas, des entrées et des sorties… Mais le pire dans tout cela c’est que le seul jeu disponible c’était le « Trivial poursuit Genius ». C’était affreusement humiliant ! Moi je prenais les cartes et je changeais les questions, j’ajoutais des réponses, je leur épelais presque les mots à trouver… Il y avait vraiment des situations absurdes ! Je ne suis pas restée bien longtemps…

– Après cette expérience mitigée au Génépi, tu as rejoint l’Observatoire international des prisons ?
– Oui, j’ai rejoint directement l’OIP. D’abord je suis allée à une réunion d’un groupe local, puis j’ai rencontré François Bès et j’ai vu la lumière ! Je l’ai suivi jusqu’à la rue des Lilas3 et je ne suis plus jamais partie. J’ai commencé en 2004 je crois. Ce qui m’intéressait beaucoup à l’OIP c’était son origine, c’était animé par Patrick Marest qui venait du milieu anarchiste, de « Ras les murs »4… La notion du droit comme arme était déjà présente : on va réutiliser le droit, on va user de ce moyen là pour combattre ! Quand je suis arrivée à l’OIP, j’étais bénévole au courrier : il y avait une pile de courriers en retard et je me suis dit que j’allais aider comme ça. Patrick m’a proposé de travailler sur « Dedans-Dehors »5. On a fait un essai, mais vu mon rythme de production cela n’a pas marché ! Même pour l’article le plus basique, je faisais des recherches dans tous les sens ! Je crois que j’avais déjà bien intégré l’exigence d’objectivité : à l’OIP, on passait notre temps à recouper l’information avant de la sortir. L’idée c’est que s’il y a une atteinte aux droits et qu’elle est gravissime, il n’y a pas besoin d’une série d’adjectifs, cela doit sauter aux yeux, c’est tout.
– Tout ce travail t’a amené à porter quel regard sur la prison ?
– Il y avait à l’époque dans une frange de la société un discours très critique et je fréquentais beaucoup de groupes anarchistes : « La prison, dernier maillon de la répression », « la réinsertion, une notion bourgeoise que l’on impose », etc. De mon côté, je souhaitais militer, et même si je savais que l’OIP n’intervenait pas en prison, je voulais mieux la connaître, affiner mon regard. Mon expérience au Génépi et à la Santé m’avait permis de comprendre que tout est compliqué : on n’est pas dans un monde manichéen où il y a le méchant surveillant et le bon détenu… Cela m’a toujours intéressée de voir toutes les interactions entre les uns et les autres, de constater le fait qu’individuellement, mis dans telle ou telle situation, tu vas présenter tel ou tel visage. Mais plus globalement, l’institution me posait problème : ce projet de la prison d’aller chercher le déviant, celui qui n’a pas respecté la loi… La loi pour moi, elle n’a jamais représenté grand-chose… la loi en tant que telle, c’est-à-dire que les valeurs que la loi peut protéger, j’y adhère mais je n’accorde pas une valeur particulière à la loi parce qu’elle est loi. Une loi peut être injuste.
– Tu t’es très vite engagée dans le militantisme, mais est-ce que tu as envisagé de changer la prison « de l’intérieur » en travaillant comme professionnelle de la Justice ?
– J’ai eu la velléité de devenir conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, je suis allée au concours. Je faisais une prépa universitaire pour passer le concours d’avocat, je n’étais pas vraiment motivée, je me cherchais et il fallait que je pense à un avenir professionnel, j’avais dû me convaincre en me disant : « ouais je peux être au service de… », mais au fond, je n’y croyais pas une seule seconde. Je suis entrée dans la salle du concours, il y avait des personnels pénitentiaires en uniforme en train de parler avec un haut-parleur et là je me suis dit que non… J’ai pris mes affaires et je suis partie ! Je crois que je comprends la démarche, l’idée de vouloir réformer de l’intérieur, mais je ne la comprends qu’à moitié en fait. Croire qu’un CPIP va faire la différence, c’est se bercer d’illusions ! Il n’en n’a pas les moyens, pas le temps, il ne peut pas faire grand-chose pour vraiment aider les gens en milieu ouvert et encore moins en prison. Quant à directeur de prison, jamais de ma vie je n’aurais pu faire ça… Pour moi c’est diriger une institution qui n’est pas tout à fait légitime à mes yeux, et avec un manque de moyens tels que même avec les meilleures intentions du monde, tu sais que tu vas être le témoin d’atteintes au droit auxquelles tu ne vas pas pouvoir remédier. En tant que directeur, je ne dormirais pas la nuit…
– Et le métier d’avocate, de juge ? Tu préparais le concours d’avocat ?
– J’ai vite renoncé. Dans le cadre de mes études, j’avais fait un stage au parquet. J’étais dans le bureau de traitement en temps réel, avec le substitut et j’ai assisté à des comparutions immédiates à l’issue desquelles je me suis dit que je ne serai jamais juge. Jamais ! J’étais avec le substitut, je lui posais plein de questions sur l’exécution des peines, et il n’avait rien à m’en dire… Pendant toute la session de comparution immédiate, pendant les délibérations, ils m’ont mise sur l’estrade, à la place du parquet… J’ai ressenti ce poids de me retrouver symboliquement en train d’assumer la violence du prononcé… C’était une histoire d’alcool, je ne me souviens plus exactement de la qualification. Le type se défend tout seul, il a du verbe et je vois le substitut qui commence à faire baisser la peine pour sa réquisition… Là tu vois tout d’un coup que, juste pour des questions d’éloquence, les faits n’avaient pas changé, il baisse. Après, le gars se prend les pieds dans le tapis, se vautre et le substitut remonte… Et toute cette batterie d’avocats… Ils ne connaissent pas les dossiers… Ce n’est pas contre eux, c’est le dispositif… Ils ne connaissent pas le dossier et ce sont toutes ces phrases-types qui reviennent et reviennent les unes après les autres, peu importe l’avocat, tu entends toujours la même chose et tu n’écoutes pas, je pense que personne n’écoute… En réalité, la défense elle est complétement factice dans ces cas-là. On demande de la compassion, de l’indulgence… Ils ne plaident même pas la peine… Ils pourraient essayer de plaider, bon s’il n’y a pas de débat sur la qualification des faits et leur matérialité, on peut au moins débattre de la nature de la peine, et qu’est-ce qui fait sens ou pas mais non… On demande de l’indulgence, de la bienveillance, il y a un truc insupportable, même pour moi et pourtant c’était la première fois mais c’était insupportable donc j’imagine tout le temps, tout le temps, tout le temps… C’est un spectacle désolant…

– Donc tu arrives à l’OIP en 2004, et tu commences par les courriers en retard, mais tu vas ensuite élargir ton champ d’action ?
– Ça a l’air anodin, mais il y avait énormément d’informations dans les courriers ! J’avais construit une base de données pour pouvoir retrouver les données établissement par établissement, pour pouvoir aussi retrouver les problématiques. J’avais construit un truc monstrueux, mais qui permettait de ne pas se reposer seulement sur la mémoire. Après ça, on m’a confié la préparation du Guide du sortant de prison6, puis je me suis retrouvée salariée à la permanence « Informative et juridique ». Il s’agissait de répondre aux courriers et de faire des enquêtes. On était deux, je travaillais avec un collègue qui était animé par le désir de sortir beaucoup de communiqués. Moi, j’avais surtout l’envie de creuser thématique par thématique, avec ce but de comprendre. Je dépouillais beaucoup, je documentais avec au départ une vision très juridique. Par exemple, à l’époque émergeait la question des régimes différenciés et j’allais prendre tous les règlements intérieurs pour repérer les logiques à l’œuvre, comment les gars en parlaient, les recours possibles. Je creusais dans tous les sens ! Je n’étais pas tout à fait dans la même logique que mon collègue, et parfois c’était compliqué… Je crois que derrière, cela traduisait une tension à l’OIP autour de ce que devait être la bonne approche : produire du communiqué, privilégier certains cas, comme les cas de violence de personnels pénitentiaires sur détenus notamment ? Ou bien connaître et documenter le mieux possible les conditions de détention pour pouvoir jouer un rôle d’alerte dans son ensemble ? Pour moi il fallait faire les deux ! Mais tout ça avec peu de moyens ! Donc on avait des grosses discussions politiques là-dessus. Mais c’était aussi des questions d’appétence, ou de compétences. Moi, j’étais plus à l’aise dans cette approche documentaire, plus transversale. Et je défendais l’idée que, pour être crédible, il fallait être capable de décrypter la condition carcérale dans son ensemble… J’estimais qu’il fallait éviter les prismes déformants, ciblés sur telles ou telles atteintes … Cela ne me convenait pas complétement… Chacun a donc fait un peu son truc et cela s’est un peu équilibré. Mais en interne, à certaines époques, il y a eu des confrontations tendues entre ces différentes approches…
– Comment retracerais-tu l’histoire de l’OIP, les évolutions que tu as pu y observer ? Et comment est-ce que tu expliques ces changements au fil du temps ?
– Le point de départ, c’est quand même une petite équipe resserrée, unie derrière un certain nombre de principes et derrière le fondateur de la section française, Patrick Marest. On ne comptait pas notre temps, il y avait des nuits blanches… La question du salariat ne se posait pas vraiment, on était indemnisés pour militer ou pour faire fonctionner l’institution, bénévole ou pas, peu importe… On n’était vraiment pas très nombreux, et la situation d’adversité était plus forte qu’aujourd’hui. On se sentait dans le rôle d’un contre-pouvoir. Et puis on avait une urgence terrible à faire sortir l’information, à essayer d’activer tous les leviers possibles. Il y avait un bouillonnement permanent, et une équipe constituée de gens qui avaient traversé d’autres luttes : Zina Rouabah, une ancienne de Libération, François Bès qui venait d’Act Up, par exemple. Notre objectif c’était d’être les trublions, de déranger les petits systèmes établis. Il y a eu la période, après 2001, les auditions parlementaires, puis les États Généraux de la Condition Pénitentiaire7… Les États Généraux ça a été complètement fou : l’idée a germé à table au départ et puis… ce n’est pas que ça nous a dépassés, mais c’était comme un rêve éveillé.
– Tout à coup la prison est devenue un objet d’intérêt public ?
– Oui, et tout d’un coup, on a été obligé de frayer avec d’autres… Ce n’est pas qu’on ne voulait pas être associés mais c’est surtout que certains ne voulaient pas être associés avec l’OIP. Le médiateur rentre dans la danse, la chancellerie nous donne l’autorisation d’introduire des questionnaires. Sans avoir rien planifié, tout s’est goupillé petit à petit. Recueillir la parole des détenus en si grand nombre, celles de leurs familles, c’était complétement inédit. Un des grands souvenirs pour moi, c’est le manifeste ou la déclaration finale, je ne me souviens plus, au studio 104, à la Maison de la radio, avec Robert Badinter qui lit son texte et qui fait lever la salle entière… Là, tu as l’impression que le changement est possible. Tu as plein de gens qui se lèvent, qui sont d’accord sur des principes et tu te dis qu’il est possible d’obtenir un changement, ou en tout cas tu as envie d’y croire.
– Et tu penses que cela a eu des effets ?
– Je pense que cette consultation restera historique. Faire sortir cette parole-là c’était important. Moi, j’ai plein de retours de détenus que l’on questionnait au fin fond d’un quartier d’isolement ou du mitard et rien que le fait qu’on leur demande leur avis, ça c’est historique… Quand-même, un quart de la population détenue a répondu, c’est complétement dingue ! Ça, c’est marquant et pour moi, c’est une des plus belles réussites… À cette période on se demandait comment peser sur les présidentielles de 2007 : on a envoyé le manifeste à chaque parti politique mais chacun a récupéré le truc politiquement comme il l’entendait… Et puis au moment de la loi pénitentiaire cela n’a pas été du tout déterminant... Finalement, en dehors du milieu prison, je ne sais pas si cela a marqué vraiment les esprits. Même les nouveaux arrivés à l’OIP n’ont pas le souvenir de ces États Généraux. Cela aurait pu devenir un socle de réflexion et ça n’a pas été le cas. Dans les rapports parlementaires, cela n’apparaît pas, ce n’est pas devenu une base, une matière qui sert à la réflexion… Mais les États Généraux, pour moi, ça restera un moment où on a réussi à être ensemble, soudés, en train de réussir à déplacer une montagne et c’est euphorisant… Ce sont les mêmes sensations quand on arrive à ouvrir une voix de recours, à faire sauter un certain nombre de verrous… Récemment par exemple, l’OIP a beaucoup travaillé sur la présomption d’urgence (à l’isolement et au mitard)8, c’est un peu technique, mais bon, ça fait dix ans, voire même plutôt quinze ans qu’on se bat pour ça. Au moment de la loi pénitentiaire de 2009 il y a eu des amendements en ce sens-là, il y a eu des débats, on a perdu et là, on a gagné, en 2019, sur l’isolement !
– Quelle énergie ! Tu ne te décourages jamais ?
– Si, si mais… Il y a une phrase de Brecht qui dit : « Celui qui combat peut perdre mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Ben là c’est ça, comme on ne peut pas baisser les bras et qu’on ne peut pas ne rien dire, ne rien faire sur ces atteintes, tu vas inlassablement reprendre le combat, même si, quand tu le mènes, tu sais que tu as trois chances sur quatre de le perdre. Mais à force de taper, taper, taper sur le même clou… À plein d’autres niveaux, on a vu des combats qui mettaient dix ans, cinq ans, quatre ans… Et à un moment on arrive à obtenir quelque chose et rien que ce petit bout de droit peut permettre aujourd’hui de faire des recours. Et en même temps oui, il y a quelque-chose de désespérant, parce que tu peux faire progresser la protection des droits fondamentaux d’un côté tandis que, de l’autre, l’administration, avec l’aval du juge administratif, réussit à recréer des voies d’arbitraire. Pour te donner un exemple, toute la bataille menée – toujours en cours d’ailleurs – pour que le placement en régime fermé soit susceptible d’un recours effectif, est mise à mal par la multiplication des unités spécifiques créées au nom de la lutte contre la radicalisation. On retombe dans une période où on laisse l’administration décider seule du placement dans tel ou tel régime. Ce sont des combats permanents…

– Tu présentes le droit comme une arme. C’est une arme plus puissante que les médias ? Plus puissante que les enquêtes en sciences sociales ?
– Ce qui a les résultats les plus concrets, c’est le droit. Ce sont les recours. Parce que le juge ordonne et, même si l’administration n’exécute pas toujours, quand il y a une condamnation, ce sont des mots-clés, donc les médias reprennent. Les médias font écho, ça gêne, ils ne peuvent pas complètement balayer. Fin janvier 2019, il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme qui condamne la France pour la surpopulation carcérale. Évidemment, ça n’est pas pleinement contraignant, il n’y a pas d’indications précises des politiques pénales à mener, donc la réponse du gouvernement a été de dire : « On vient de faire une loi et on va faire baisser la population carcérale ». Mais cette décision va avoir des impacts concrets sur la possibilité de faire des recours9. Et si les recours se multiplient, ça peut finir par aboutir. Il faut vraiment arriver à avoir une accumulation, l’effet masse. C’est pareil sur les indemnisations pour conditions indignes de détention. L’administration peut tout à fait gérer quelques indemnités, mais si les recours se multiplient, ça commence à déranger. J’imagine que, même quand tu diriges une administration, la multiplication des condamnations pour indignité du traitement des gens que tu héberges, cela bouscule un peu. Enfin je l’espère. À partir de ce que nous faisons, l’administration pourrait se battre aussi sur plusieurs fronts, elle pourrait s’en servir pour essayer de changer les choses aussi… ça c’est quelque chose qui m’échappe ! Pourquoi ils ne se servent pas des recours pour faire levier, obtenir des budgets de rénovation par exemple !
– Je me souviens d’un entretien de Bernard Bolze, interrogé par Claire de Galembert, qui disait : « Si le droit pouvait changer la prison, cela se saurait depuis longtemps »10. Tu n’es donc pas d’accord ?
– Ça c’est le point de départ de l’OIP. En 1991, l’idée de départ de Bernard Bolze11, c’est de créer un observatoire. Dans l’appel du journal Le Monde à la création d’un « observatoire international des prisons », il y a cette volonté de faire en sorte que les citoyens s’intéressent à ce qui se passe derrière les murs, en créant des groupes locaux un peu partout, qui observent leur prison. L’idée est géniale, mais elle peu opérante… Ça a permis de monter des groupes locaux, mais malgré tous les efforts, ça partait dans tous les sens, il n’y avait pas suffisamment de lien pour imposer une méthodologie. La survie de l’OIP a toujours été liée à la possibilité de sortir des informations sûres. L’essentiel, au départ, c’était l’alerte, faire sortir l’information, faire connaître l’atteinte au droit, la rattacher à la loi. À chaque fin de communiqué il y avait le rappel des textes violés. Tout compilé, cela donne le premier rapport qui sera publié à L’Esprit frappeur, qui était en réalité le texte de l’audition de l’OIP devant la commission d’enquête de l’Assemblée nationale en 2000. Tout mis bout à bout, thème par thème, c’était effrayant ! L’idée était d’alerter les médias, les parlementaires, les autorités et finalement, par la mauvaise publicité, de faire évoluer la situation. Cela supposait que chacun s’en empare, et que l’atteinte soit vécue par tous de manière tellement intolérable qu’on allait résoudre le problème. C’était peut-être possible dans les années 1990, ou 2000 quand Véronique Vasseur a publié son bouquin, qui ne disait d’ailleurs pas forcément beaucoup plus que ce que l’OIP sortait dans ses communiqués, mais ça a fait une onde de choc. Aujourd’hui, ce choc n’existe plus. Le bouquin de Vasseur n’avait rien d’exceptionnel dans son contenu, mais c’était une parole de l’intérieur qui sortait, et cela a entraîné deux commissions d’enquête parlementaires. À l’époque, tout le monde s’est mis à regarder la prison, à éprouver de la honte et ça a entraîné de vraies réflexions. Malheureusement sans grandes suites.
– Donc la dénonciation ne suffit plus aujourd’hui ?
– Non. Déjà il n’y a plus les mêmes relais, il y a une forme d’habitude… Soit tout le monde est désespéré, soit on s’habitue… En tout cas il n’y a plus cette mobilisation par l’alerte. L’importance de faire des recours, l’OIP l’a vraiment compris quand Hugues de Suremain est arrivé au siège et a développé cette stratégie. C’est une période où on s’est mis à essayer de tenir les deux, l’alerte et le contentieux, en veillant à ce que les recours ne prennent pas le pas sur l’alerte. Mais c’est vrai que les résultats concrets, palpables, sont plus souvent le fruit du contentieux. Pourtant, ce n’est pas une voie facile. On expose des situations individuelles. Il y a des gens derrière, des familles, des proches qui sont en détresse, et on doit leur dire : on ne sait pas du tout si ça aboutira. Il y a des moments où un simple communiqué peut résoudre une situation, ou rétablir la personne dans ses droits – parce que la situation est dénoncée comme inacceptable, une atteinte aux règles, sachant qu’ils ont été condamnés pour ne pas avoir respecté la loi… Ça a un impact. Mais ce n’est pas toujours le cas. Or, un recours ça prend un temps fou, le traitement est long. C’est une histoire de persévérance ! L’alerte aussi finalement. Il faut recouper l’information, vérifier par les écrits, avoir plusieurs sources qui nous confirment. Si l’information n’est pas consolidée, on ne va pas la mettre. Et c’est pareil avec les enquêtes thématiques : par exemple sur le thème des formations professionnelles, tu dois connaître tous les circuits de financement, suivre les lignes budgétaires d’année en année. Après, on creuse la question de la qualité, quelles sont les formations proposées, les modalités d’accès pour les détenus, comment se prennent les décisions, ceux qui n’y ont pas accès, ceux qui sont rejetés pour tel ou tel motif, etc. Il faut donc que l’on récupère toute la base documentaire qui existe, les textes, les circulaires, les rapports annuels des établissements. Ensuite, il faut faire parler les acteurs mais dans ces cas-là on ne peut pas interroger chaque établissement donc il faut avoir, par exemple, des gens de l’intérieur qui vont nous dire quelles sont les problématiques. Après, on va chercher des cas individuels, pour illustrer, pour voir concrètement pourquoi ils n’ont pas eu accès à la formation, pourquoi elle a été interrompue… Et puis on lit aussi ce qui a pu être produit en sciences sociales. Et on procède comme ça, thème par thème...
– Tu parles des sciences sociales. Est-ce qu’il y a des travaux qui ont influencé ta manière de penser la prison ?
– Souvent, cela me nourrit, ça apporte des nouvelles problématiques… Je pense à des travaux très spécifiques, par exemple les travaux de Fanny Salane12 sur l’enseignement, il y a plein de questions que l’on ne s’était pas posées comme ça. Les travaux d’Antoinette Chauvenet13 sur la violence carcérale, c’est une bible pour nous et puis ç’a été une claque. De voir que ces travaux-là sont produits, financés par la DAP, c’est dingue ! C’est considérable ce qui a pu être amassé… Plein de choses extrêmement intéressantes sont produites, mais cela ne semble jamais aboutir à des transformations majeures. J’imagine bien qu’en réalité, cela se diffuse, cela nourrit différents acteurs au sein de l’institution mais ce que je veux dire, c’est que cela n’emporte pas la transformation. Comme les États Généraux, je n’ai pas le sentiment que ce soit un socle de réflexions sur lequel sont menées des politiques. Je ne pense pas que cela ne serve à rien, c’est fondamental, mais il y a une forme de désespérance et d’incompréhension à voir autant d’analyses de qualité qui ne servent pas de point d’appui à des transformations qui seraient utiles à tous.
– Comment te l’expliques-tu ? Où sont les freins ?
– Ce qui crée cet immobilisme, je ne sais pas… J’aimerais beaucoup une étude là-dessus pour comprendre… Peut-être est-ce le réflexe identitaire d’une institution dépréciée, mal aimée... Avec des personnels qui pensent qu’on va leur coller tout le temps une étiquette de tortionnaires et dont le premier réflexe est de se défendre, envers et contre tout. Ou parce qu’une partie des critiques est parfois disproportionnée… Après il y a le rôle des syndicats… mais cela ne justifie pas tout et puis le poids donné aux syndicats pourrait être repensé. Je ne suis pas sûre que les syndicats soient représentatifs de toute la profession. Notamment des surveillants. Et cette parole-là du coup on ne l’entend pas.

– Les discours sur la prison peuvent en effet être très caricaturaux. Pour revenir à l’OIP, vous avez longtemps fait l’effet d’un épouvantail. Est-ce que tu penses que c’est toujours le cas ?
– Beaucoup moins depuis quelques années ! Cela tient peut-être en partie au départ de Patrick Marest, qui avait une personnalité attractive, mais qui pouvait être clivante. Et puis on a peut-être été moins frontal dans notre manière de s’exprimer. Certains diront qu’on a pris plus de temps pour écouter et rencontrer des gens de l’institution. Que l’on s’est ouverts – déjà avec les États Généraux – on s’est insérés dans des dynamiques avec d’autres associations… Il y a eu aussi les années Gorce14, Taubira15, des personnes qui étaient capables de nous dire bonjour, de nous écouter, de nous faire participer à des événements institutionnels, comme la conférence de consensus sur la probation, où l’on a pu faire entendre notre voix, tout en respectant notre approche indépendante, c’est-à-dire sans être partenaire, ni apporter notre caution aux politiques conduites. Et puis on a gagné de plus en plus de recours… Ça nous a apporté de la crédibilité, de l’intérêt ! Notamment dans le milieu universitaire. Des chercheurs sont venus chercher de la matière, de plus en plus d’étudiants ont commencé à vouloir venir en stage… Bref, ça n’est plus juste une organisation qui braille, c’est aussi une organisation qui gagne des recours, qui est reconnue comme capable d’analyser, de documenter la question carcérale. Et puis, la composition de l’équipe a évolué : sont arrivées de nouvelles personnes, aux parcours divers - Nicolas Ferran vient du droit des étrangers, Cécile Marcel, l’actuelle directrice, de Penal Reform International. Ils n’ont pas connu cette période plus conflictuelle et ne sont pas marqués par cela.
– Quels changements penses-tu que cela a créé au sein de l’OIP ?
– C’est sûr que le côté militant sans limite, où on pouvait passer nos nuits, nos week-ends sur une question, s’est atténué… Nous ne comptions pas nos heures. On était même allés un peu trop loin je pense, il fallait donc revenir à une forme plus classique, où on travaille pour la cause, mais comme salariés, dans un cadre plus respectueux, moins dur, c’est bien. Mais c’est dur pour moi de juger, parce que cette époque très militante, c’est aussi ce qui m’a constituée. Et puis il y avait une énergie : les États Généraux ont pu se faire parce qu’il y avait des dingues qui ne comptaient pas leur temps ! Je vois aussi qu’il y a des choses qui évoluent, des façons de voir, de se positionner. Par exemple, à la fin du rapport sur les violences16, il y a une liste de recommandations. C’est un détail, mais mon réflexe, c’est de me dire « Hé on ne fait pas l’aumône ! On n’est pas dans une boîte de conseil ! ». Ce terme de « recommandation » me gratte. J’aurais aimé « exigences minimales » ou une formule de ce style. Dans le terme « recommandations », il y a quelque chose de très institutionnel, ça fait « on ne veut pas trop vous déranger ! ». Mais, bien sûr, l’important c’est que le rapport sorte, qu’il soit irréprochable sur le fond. Comme les dossiers de Dedans-Dehors coordonnés par Laure Anelli, fouillés, avec un réel souci de précision et des données fournies par la DAP. A une époque je ne pense pas qu’on ne se serait adressés à la DAP pour avoir des statistiques par exemple ! Il faut dire aussi que le DAP, Claude d’Harcourt, avait interdit à ses personnels de communiquer avec nous.
– Est-ce que ces changements participent des raisons de ton départ ?
– Non, non, non… Mon départ, tu sais… cela fait plus de quinze ans ! Là, depuis quelques années, j’étais surtout sur les questions de plaidoyers, et c’est un domaine que j’aime beaucoup, où tu peux croiser les problématiques. Mais par contre les relations avec le politique, je ne peux plus. Je ne peux plus ! Il ne faut pas renoncer à taper toujours sur le même clou, mais parfois, il vaut mieux que quelqu’un d’autre prenne le marteau. Là vraiment, ça commençait à devenir douloureux, cette impression d’immobilisme, de tourner en rond, de ne plus y croire. C’est mieux qu’arrivent des personnes qui y croient, même si c’est une illusion, peu importe, au moins il y aura de l’énergie. En même temps c’est complètement dingue que cela n’arrive pas à évoluer réellement… Parce qu’entre les acteurs qui ont envie de changement sur le terrain, et la masse de travaux qui existent aujourd’hui pour savoir ce qu’il ne faut pas faire…
– La question carcérale te touche encore on le voit… Tu vas continuer à t’y intéresser, c’est cela ?
– Oui ! J’ai déjà commencé à travailler ces derniers temps avec Patrick Marest et Philippe Pottier dans le cadre d’un soutien à l’élaboration d’un Guide du prisonnier et d’un Manuel de droit pénitentiaire porté par le ministère de la Justice et l’organe de contrôle en Tunisie. Là c’est marrant, parce que les surveillants demandent un guide des surveillants ! Le guide est remis aux surveillants et des sessions de formation sont organisées. On aimerait que s’initie la même chose au Maroc et tenter de faire émerger du contentieux en Tunisie. Pour moi, c’est une ouverture incroyable. Ce sont d’autres acteurs que je connaissais moins, le cadre, le contexte est complétement différent. Tout à coup, c’est l’administration qui est motrice ou en tout cas qui ne freine pas… En décembre 2019, on a assisté à la conférence de presse de présentation du Guide du prisonnier au sein de l’école de l’administration pénitentiaire : les surveillants étaient là, le ministre a pris des engagements assez forts en faveur de réformes… Ici, en France, jamais un guide du prisonnier n’a suscité cela ! Soudain, tout le monde débarque dans la plus grosse prison de Tunisie. De nombreux détenus étaient là et ont eu la possibilité de s’exprimer… Voir d’autres cadres, d’autres systèmes pénitentiaires… C’est assez enthousiasmant !

Notes
1
Cesare Beccaria est un juriste, criminaliste, philosophe du XVIIIème siècle (1738-1794) considéré comme l’un des fondateurs du droit pénal dont il édicte les principes fondamentaux dans son Traité des délits et des peines, publié en 1764. Il défend dans ce texte les exigences de légalité, de non-rétroactivité des peines, de présomption d’innocence et de proportionnalité de la peine au délit.
2
Le Génépi est une association crée en 1976 à la suite des grandes mutineries en prison du début des années 1970. Initialement appelé Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, l’association regroupait de nombreux étudiants qui assuraient des cours et des activités sportives ou culturelles en prison. L’association avait également pour vocation de sensibiliser les citoyens au fonctionnement de la prison via l’organisation de journées d’information par exemple. Récemment, l’association a redéfini profondément son mandat. En 2014, l'acronyme est abandonné pour devenir Genepi et l’association décide en 2019 de stopper les actions en prison.
3
Adresse du siège de l’OIP pendant plusieurs années.
4
Ras les murs est une radio libertaire, fondée en 1989, qui proposait des émissions dédiées à l'actualité de la prison et des détenus. L’équipe qui assurait sa programmation et son animation a récemment cessée ses activités, mettant un terme à l’émission.
5
« Dedans dehors » est une des publications emblématiques de l’OIP. La revue propose un dossier thématique, présente des articles nourris de témoignages de détenues, de leur famille ou de professionnels, informe sur le droit.
6
La première publication du Guide des prisonniers paraît en 1996. Rédigé et publié par l’OIP, l’ouvrage regroupe l’ensemble des informations juridiques sur l'intégralité du parcours en détention, en confrontant pratique et droit dans un souci d’exhaustivité. Il est distribué gratuitement à l’ensemble des bibliothèques des établissements pénitentiaires pour être rendu facilement accessible aux personnes détenues. La 4éme version actualisée de cet ouvrage est paru le 10 décembre 2021.
7
Consultation lancée le 10 janvier 2006, à l'initiative de l'OIP et placée sous l’égide de l’ancien garde des sceaux Robert Badinter en partenariat avec une dizaine d’organisations du monde judiciaire, pénitentiaire, et de la défense des droits de l’Homme. Une consultation individuelle a été organisée auprès des acteurs du monde judiciaire et pénitentiaire : de très nombreuses personnes détenues et leurs familles ont ainsi répondu à un questionnaire, de même que des magistrats, avocats, personnels pénitentiaires, intervenants en milieu carcéral, structures en charge de l’accueil des sortants de prison. Près de 220.000 personnes ont ainsi été sollicitées pendant 3 mois. Cette démarche inédite a permis d’inscrire à l'ordre du jour de la campagne électorale la question carcérale.
8
Le 7 juin 2019, le Conseil d’État a estimé que les décisions de placement ou de maintien à l’isolement font naître une présomption d’urgence. De ce fait, le juge des référés doit systématiquement contrôler les motifs de sécurité invoqués par l’administration pour justifier une mesure d’isolement.
9
Consulter à ce sujet : Arrêt n°1400 du 8 juillet 2020 et le communiqué de l'OIP « Détention provisoire : des conditions de détention indignes justifient une libération » [en ligne].
10
« « Si le droit devait changer la prison, ça se saurait depuis longtemps ! » », Droit et société, 2014/2 (n° 87), p. 395-410. DOI : 10.3917/drs.087.0395. [en ligne]
11
Bernard Bolze est le fondateur, en 1990 à Lyon, de l’Observatoire international des prisons (OIP). Il en a été le délégué général jusqu’à la fin de l’année 1997.
12
Fanny Salane est maitresse de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Paris Nanterre. Elle a écrit : Être étudiant en prison. L'évasion par le haut, La Documentation française, coll. « Etudes & recherches », 2010.
13
Antoinette Chauvenet est sociologue, spécialiste reconnue du monde carcéral. Elle est notamment co-auteur des ouvrages de référence suivants : Chauvenet A., Rostaing C., Orlic F., La violence carcérale en question, Paris, PUF, 2008 ; Chauvenet A., Orlic F., Benguigui G., Le monde des surveillants de prison, Paris, PUF, 1994.
14
Isabelle Gorce a été directrice de l’administration pénitentiaire de 2013 à 2016.
15
Christiane Taubira a été Garde des Sceaux du 16 mai 2012 au 27 janvier 2016. Son action sur le champ des prisons a été particulièrement marquée par l’organisation de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive en février 2013 et par l’adoption de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
16
En 2019, l’OIP publie un rapport « Omerta, opacité, impunité : enquête sur les violences commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues ».