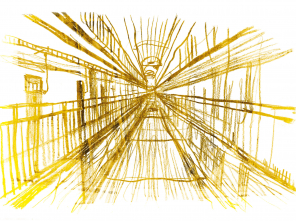Philippe Pottier est entré dans la pénitentiaire comme éducateur en 1974, en pleine période de révoltes carcérales. Il appartient alors à une profession « pionnière » et s’engage tant dans l’organisation de ce métier au niveau syndical, que dans les réflexions sur l’accompagnement des condamnés et la réinsertion. Critique de la vision classique du travail social, il s’est tout à la fois inspiré des recherches en criminologie anglo-saxonne sur la désistance, et de la découverte, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, d’autres approches culturelles centrées sur la restauration du lien dans la communauté. Initiateur de démarches controversées d’évaluation des risques de récidive, il a aussi toujours insufflé dans sa vision de la sanction pénale un profond humanisme, qu’il continue de porter, désormais, comme expert dans des programmes de coopération.
Yasmine Bouagga a d’abord rencontré Philippe Pottier au cours de sa thèse de sciences sociales, portant sur le traitement pénal en maison d’arrêt (Humaniser la peine ? Enquête en maison d’arrêt, PUR, 2015). Il était cité comme l’artisan de nombreuses transformations en cours ; certains en parlaient comme un progressiste convaincu, d’autres le dénonçaient comme l’importateur d’une criminologie anglo-saxonne centrée sur l’évaluation, abandonnant tout projet d’aide aux personnes condamnées. En poursuivant ses recherches sur le terrain des réformes pénitentiaires à l’étranger, Yasmine Bouagga a de nouveau croisé le chemin de Philippe Pottier, devenu expert d’un programme de l’Union européenne destiné notamment à développer les peines alternatives à l’incarcération en Tunisie. Il s’est toujours montré généreux, partageant ses réflexions et ses questionnements autour d’un café, acceptant volontiers les invitations aux colloques, séminaires ou encore au cours en ligne sur les « Prisons en Afrique »1.
Pour retracer tout son parcours, il fallait prendre le temps : l’entretien a lieu dans un restaurant à Mâcon, en avril 2018 et les échanges se sont poursuivis ensuite, par retours successifs sur l’entretien. Il y est question de diverses figures de la prison et de sa critique, mais aussi de différents horizons et cultures. L’entretien questionne le travail social, la possibilité même de résoudre les problèmes sociaux, le sens de l’intervention en prison auprès de personnes qui sont les plus précaires de la société, la rédemption trouvée dans un autre sens du lien et de l’accompagnement. Les expériences de dépaysement apportent, plutôt que l’exotisme, une déstabilisation des certitudes en même temps qu’une foi en l’humain, donnant une importance centrale au dialogue, à la parole qui circule et qui relie.
Yasmine Bouagga – Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la prison, par quelle porte d’entrée ?
Philippe Pottier – Je crois qu’il y a un effet générationnel. J’étais en seconde en mai 68, j’ai milité un peu au comité d’action de mon lycée, et la prison revenait dans nos discussions pour différentes raisons : il y avait des militants incarcérés, comme Geismar2, et il y a eu les révoltes. On a du mal à l’imaginer maintenant, mais c’était un événement médiatique considérable en 1972-1974. J’ai passé le concours pour entrer à l’administration pénitentiaire en 1974, en plein dedans : il y avait eu les révoltes de Toul dans l’Est, de Loos dans le Nord. J’habitais à Lille et c’est l’une des prisons où il y a eu les premières mutineries. La prison faisait partie des enjeux politiques du moment. Une des actions immédiates de Giscard a été de nommer une secrétaire d’État à la Condition pénitentiaire, Hélène Dorlhac. On dit parfois aujourd’hui « enfin on s’occupe de la prison ! », alors qu’on s’en est occupé à d’autres périodes, mais les regards sur le passé sont un peu oublieux. Je cherchais du boulot et il y avait de toute évidence un enjeu militant, au sens large du terme, même si je n’appartenais à aucune organisation politique. J’avais commencé des études de droit, je m’y ennuyais mais la justice pénale m’intéressait. Dans le même temps, j’étais animateur pour des centres de vacances à Lille, où j’étais directement confronté à la question de la délinquance.
– Connaissiez-vous ce métier d’éducateur pénitentiaire quand vous avez passé le concours ?
– Non, j’y suis arrivé totalement par hasard : des circonstances personnelles ont fait que j’ai arrêté mes études, je suis allé voir l’ONISEP3 qui faisait l’orientation. Il y avait une liste de concours possibles, j’y ai vu « éducateur des services de l’administration pénitentiaire » et, comme j’avais fait du droit, je me suis inscrit, sans savoir de quoi il retournait précisément. J’ai eu le concours, j’ai fait mon service militaire et je suis entré en formation, avec la promo de 1975, la plus importante recrutée jusqu’alors – quatre-vingt nouvelles recrues, un effet de la politique de Giscard. Le recrutement des éducateurs, ancêtres des CPIP [Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation], avait commencé en 1968. 1974, c’était encore un peu les débuts, il n’y avait pas des milliers de candidats.
– Ces éducateurs avaient-ils un profil militant ?
– Oui c’est clair, dont des gens qui étaient encartés, au PSU, au PS, à la LCR, au PCF4 : il y avait des gens de partout, mais c’était très majoritairement de gauche à l’époque.
– Vous aussi ?
– Non, je n’étais pas encarté, mais je militais dans des organismes comme le MRAP5 ; j’étais aussi engagé à Lille dans des associations locales d’éducation populaire. Par exemple, on avait monté une association qui organisait un festival des migrations chaque année. Une des premières choses à laquelle j’étais confronté comme animateur, c’était le racisme, c’était dur.
– Et dans votre famille y avait-il un intérêt pour l’administration pénitentiaire, ou pour le social ?
– Non, absolument pas. Personne ne travaillait dans la justice de près ou de loin. D’ailleurs il n’y avait aucun fonctionnaire.
– Et de leur point de vue c’était valorisant de rentrer dans la fonction publique ?
– Ah oui bien sûr, comme pour tous les gens d’origine rurale. En plus quand on rentrait comme éducateur, c’était le niveau de recrutement le plus élevé dans l’administration pénitentiaire – à l’époque il n’y avait pas de concours externe de directeur (c’était des promotions internes). Quand on rentrait comme éducateur, on vous disait « avec ça, vous aurez de la promotion », ça ne pouvait pas être dévalorisé : c’était le seul concours niveau bac de la pénitentiaire (et le bac, en 1970, quand je l’ai passé, seul 20 % d’une classe d’âge l’avait, il faut contextualiser). Ce n’est pas l’ENA, mais c’est déjà pas mal.
– Ça contraste avec cette image d’éducateur pénitentiaire un peu hippie…
– Oui, mais il ne faut pas oublier qu’à l’époque, pratiquement tous les instits n’avaient que le bac, de même qu’une grande partie des profs de collège. Les recrutements au niveau supérieur (au niveau licence), c’était le haut du panier. Pour les métiers du social (animateur, assistante sociale), la majorité n’avaient pas le bac jusqu’aux années 1970, alors que c’était exigé pour être recruté éducateur pénitentiaire depuis le début des années 1950.
– Quel regard portiez-vous alors sur la prison ?
– C’est difficile de parler de son regard d’il y a plus de quarante ans… La première prison où j’entre, pour mon stage de découverte, c’est Fleury-Mérogis. À l’époque, en 1975, elle paraît très moderne. Je crois que je pense immédiatement à Playtime de Jacques Tati où les bâtiments modernes se ressemblent tous. Un univers en apparence aseptisé, loin de l’image sombre qu’on a dans des films. Puis, je fais mon stage de surveillant à la maison d’arrêt de Versailles, qui n’existe plus (elle a été transformée en salle d’audience du tribunal). Elle correspond beaucoup plus à l’image qu’on peut avoir de l’extérieur : sombre, triste, insaisissable. Je me demande ce que je fais là.
– C’est un regard de révolte ?
– Non, je dirais une démarche critique plutôt qu’une révolte. Presque tous les gens de ma promotion étaient dans cet état d’esprit là : on rentre, on va faire un boulot intéressant et y vivre une part d’aventure. À ce moment-là, personne n’entrait dans une prison. On passait quand même dans un monde particulier, et on savait qu’il y avait tout à construire, qu’il fallait gagner notre place. Les syndicats pénitentiaires majoritaires étaient contre le recrutement d’éducateurs, soupçonnés d’être systématiquement complices des détenus, dangereux pour la sécurité, on se sentait donc un peu pionniers. Une partie des gens avec lesquels j’ai démarré étaient les éducateurs recrutés après-guerre, à partir de 1946, dans le « système progressif », ils étaient encore en poste…
Le régime progressif, c’est l’un des principaux axes de la réforme Amor [1945], du nom du directeur de l’administration pénitentiaire d’alors. Dans les maisons centrales réformées, pour appliquer ce principe, les détenus passaient progressivement d’une phase d’isolement à des phases de plus en plus collectives jusqu’à une phase de confiance avant la libération. Chaque groupe de détenus était accompagné par un éducateur – d’où les premiers recrutements à partir de la fin des années 1940. Notre génération était en revanche celle des premiers éducateurs au sein des maisons d’arrêt. Cette nouveauté ne manquait pas de susciter des oppositions. Plusieurs de mes collègues de promotion avaient été affectés à la maison d’arrêt de la Santé : son directeur, Hubert Bonaldi, avait refusé de les laisser entrer, ils ont dû passer plusieurs mois à Fresnes avant de rejoindre leur affectation – ça allait jusque là.
On était reliés aux premiers éducateurs des années 1950, et pendant la formation ça se sentait forcément : on avait une mentalité de pionniers, on se disait « on va agir pour faire évoluer tout ça », mais on était marginaux dans les établissements pénitentiaires. Quand je suis rentré, on devait être quatre-vingt-dix éducateurs dans tous les établissements pénitentiaires, et cent soixante dans les CPAL [Comité de probation et d’assistance aux libérés]. Alors évidemment, une promotion de quatre-vingts nouveaux, c’était énorme, créant des renouvellements importants, au niveau syndical aussi (surtout que 68 était passé par là). J’ai eu la chance d’appartenir à cette promotion qui a représenté, pour des éducateurs en nombre croissant, le début de la possibilité de sortir de la marginalité. Le recrutement s’est ensuite poursuivi d’année en année.
– Dans quelle mesure les figures intellectuelles qui ont marqué le débat sur la prison vous ont influencé à l’époque ?
– Il y avait Foucault : Surveiller et punir est sorti en 19756, et tout le monde l’a lu immédiatement – il n’y avait alors pas grand-chose d’autre. Il y avait quelques livres de criminologie et de science pénitentiaire, sur le régime pennsylvanien, auburnien7… Mais Foucault, c’était la découverte de l’architecture pénitentiaire, Bentham, etc. Comment on construit la prison pour qu’elle soit ceci ou cela ? Et puis la réflexion sur la peine : à quoi veut-on qu’elle serve ? On commençait à ne plus penser la prison comme une évidence.
Il y avait aussi tout le mythe de la réforme Amor et Cannat, encore très présent – on n’en était pas loin. On ne cite plus le nom de Cannat aujourd’hui, seulement celui de Amor, mais à l’époque on citait toujours les deux et c’était juste, car si Paul Amor fut l’initiateur c’est Pierre Cannat qui a concrètement défini et conduit les réformes d’après-guerre – pour qu’on cesse de l’oublier, j’ai d’ailleurs donné son nom à l’espace d’histoire pénitentiaire que nous avons créé à l’Enap [École nationale d’administration pénitentiaire]. Cette réforme est mythique pour deux raisons. D’abord parce qu’elle marque une étape essentielle de réforme pénitentiaire, et aussi parce qu’elle fut plus une intention forte et intelligente qu’une réalisation aboutie. Elle n’a été appliquée que dans quelques établissements. Je suis né en 1952, chez moi on parlait beaucoup de la guerre et de ses suites. La réforme Amor, c’est tout cet enjeu-là de reconstruction, et c’était une référence constante : est-ce qu’on la poursuit ? est-ce que des gens la sabotent ?…
Très vite, début 1976 sans doute, j’ai rejoint le GMP [Groupe multiprofessionnel des prisons] fondé par Antoine Lazarus. On y trouvait des personnalités, Claude Mauriac par exemple, et des gens plus proches de la question pénitentiaire, comme Claude Faugeron, qui était une amie, et Lazarus bien sûr, médecin à Fleury-Mérogis. À l’époque, aux réunions du GMP, on était cent-vingt, avec des gens qui représentaient différents mouvements, des syndicats, etc. Quand je faisais mon stage à Fleury, des instits de Fleury venaient. Il y avait des gens du Comité d’Action des Prisonniers…
– Et vous avez continué à y aller régulièrement ?
– Jusqu’à la fin des années 1980 ou début des années 1990. J’y ai été pendant toute la période où je résidais et travaillais en région parisienne, le GMP étant un groupe parisien. Cela permettait d’élargir la réflexion et les relations militantes au-delà de mes responsabilités syndicales. J’y suis retourné quelques fois depuis pour débattre de certains thèmes.
– C’était un lieu de formation politique et intellectuelle…
– Oui et j’ai très vite intégré le bureau national du SNEPAP [Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’Administration pénitentiaire], en 1977, dont je suis devenu secrétaire général en 1978.
– Le syndicat a été créé au cours cette période de recrutements importants de nouveaux éducateurs ?
– Le SNEPAP a été créé en 1958, par des éducateurs recrutés pour le régime progressif ne se retrouvant pas dans les syndicats pénitentiaires (FO et la CGT), lesquels avaient une vision avant tout sécuritaire de la prison. Ils ont créé leur propre syndicat et se sont affiliés à la FEN [Fédération de l’Éducation nationale]. Quand j’y suis entré, il y a eu un renouvellement profond, une deuxième naissance si on peut dire. Je suis resté dix ans secrétaire général. La base de notre conduite, c’était que le militantisme syndical devait s’inscrire entièrement dans le militantisme professionnel et vice-versa. Évidemment il y avait aussi des revendications catégorielles, mais, pour nous, elles étaient la conséquence de ce qu’on voulait amener comme réforme de l’institution. Que fait-on ? Quel est le boulot d’un éducateur en prison et en probation ? En quoi fait-on un boulot intelligent et pas seulement un coup de peinture sur le mur ?… Nous nous inspirions des principes de la réforme Amor, basée sur la réinsertion des détenus ; pour nous, l’éducateur ne devait pas être seulement un animateur de la vie interne de la prison mais quelqu’un qui s’attache principalement à la réintégration sociale.
– Dans les années 1970-1980, la prison change beaucoup : comment est-ce que vous appréhendiez ces évolutions ?
– Je vais citer les grandes étapes, positives ou négatives, mais importantes. Alors que sous Giscard, il y avait au début une période d’ouverture sur la condition pénitentiaire – des avancées mais finalement quelque chose de décevant dans les résultats –, le moment où Alain Peyrefitte est ministre de la Justice [1977-1981], avec le débat sur la loi sécurité et liberté est un moment de resserrement, marqué par la publication des décrets qui suppriment le régime progressif et le remplacent par la classification des établissements selon des critères sécuritaires. Une époque difficile… on pouvait se demander ce qu’on faisait là. On avait été recrutés dans le mouvement issu de la réforme Amor, et on avait l’impression, avec les QHS [Quartier haute sécurité] notamment, qu’il y avait un net coup d’arrêt, que la seule chose qui comptait, c’était d’éviter de nouvelles révoltes, des évasions – la réinsertion étant mise de coté. Cela nous a conduits à provoquer un regroupement syndical et associatif, la Coordination Syndicale Pénale [COSYPE], suite à différentes sanctions disciplinaires contre des éducateurs et des instituteurs, et qui a produit avant 1981 des propositions et des textes. On a proposé à un certain nombre d’organisations de se regrouper [le GMP, le Syndicat de la Magistrature, le Syndicat des Avocats de France, etc.] dans la perspective d’une alternance politique. Aux élections de 1978, la gauche est majoritaire mais perd en sièges.
Ensuite, évidemment, il y a 1981, la victoire de François Mitterrand et le contact qu’on établit avec le ministère de la Justice, Robert Badinter et ses conseillers. Lorsque Badinter devient ministre et abolit la peine de mort, un verrou saute : s’il n’y a plus de peine de mort, on va s’occuper de tout le monde, même de celui qui a fait le crime le plus abominable – ça fait réfléchir sur la vie quotidienne en détention. Au niveau de la COSYPE, on connaissait la pénitentiaire, on était dedans et on travaillait avec ses conseillers, en particulier pour renforcer la place des éducateurs en prison. Avec le Travail d’intérêt général en 1983, on développe des alternatives à l’incarcération. Malheureusement beaucoup de réformes n’ont pas eu lieu, notamment en matière de procédure pénale ; on aurait souhaité la judiciarisation de l’application des peines ainsi que la création d’un service départemental d’insertion et de probation. On voulait que l’éducateur ne soit plus le simple assistant du juge, et que le juge ne soit plus le chef administratif des éducateurs ; on avait un plan précis : des services départementaux, intervenant en milieu ouvert et en milieu fermé, avec un chef de service issu de l’administration pénitentiaire.
– Vous n’envisagiez pas que les éducateurs soient pleinement intégrés au tribunal ?
– L’idée a été proposée dans les années 1970, mais la position que j’ai défendue, avec d’autres, était de ne pas défendre nos petits avantages à nous en sortant de la pénitentiaire. Ce serait trop facile. On aurait pu dire les magistrats c’est noble, la pénitentiaire c’est mauvais, et on fait notre petit truc de milieu ouvert. Qu’est-ce que la société y gagne ? Si on est dedans, c’est pour être et agir dedans. On n’a pas voulu délier la question de la probation de la question de la prison, ce qui revenait à abandonner la question pénitentiaire à elle-même : pour faire quoi ? Créer le paradis d’un côté, l’enfer de l’autre ? Évidemment je résume, les discussions étaient plus complexes que ça. Toujours est-il que ce repositionnement ne nous intéressait pas – fallait voir comment fonctionnaient les CPAL8 ! Passer sa vie dans une soupente du tribunal à faire exécuter les obligations du juge, ce n’était pas très passionnant non plus.
L’option syndicale classique, catégorielle, aurait consisté à pousser vers une sortie de la pénitentiaire, pour être tranquilles dans les tribunaux. Mais ce qui prévalait pour nous était une option militante, plus orientée vers les droits de l’Homme, le sens de la peine primant sur notre situation personnelle. L’essentiel des revendications portait sur le développement des services et des pratiques professionnelles, pour donner plus d’emprise aux actions de réinsertion, pas sur notre confort.
– Dans les années 1980, j’ai le souvenir qu’il y a eu encore une nette augmentation de la population carcérale...
– Tout à fait, c’est la grande limite de la réforme Badinter. Conformément à l’engagement de Mitterrand, la peine de mort a été abolie. Une fois la chose faite, il y aurait pu y avoir un renouvellement profond de la politique pénale et pénitentiaire, mais il n’y a eu ni réforme pénale, ni réforme de procédure pénale d’ampleur. La satisfaction, c’est l’évolution de la condition pénitentiaire, le partenariat avec la culture, l’entrée des intervenants extérieurs. Les services socio-éducatifs ont de nouveaux moyens d’action ; on fait des conventions, on organise les premières actions culturelles dans les prisons. C’était important : on gagne petit à petit la possibilité de liens entre le milieu ouvert et le milieu fermé, on commence à travailler ensemble.
Arrive 1986. Les années 1986-1988 sont complètement polluées par le débat sur la privatisation des prisons. On se bat pour qu’elle n’ait pas lieu. À l’époque on avait un parc immobilier détestable, il y avait surtout des vieilles prisons du XIXe siècle, avec des chauffoirs [dortoirs] dénués de sanitaires… Albin Chalandon, en homme très pragmatique de droite, considère qu’il faut de toute façon construire des prisons – c’est la catastrophe –, qu’on n’y arrivera pas avec le budget de l’État, donc on privatise. Le raisonnement n’est pas absurde en termes budgétaires, on l’avait fait dans d’autres pays. Ce qui est inattendu, c’est qu’il ait proposé initialement, à la surprise générale, une privatisation totale. Il y a eu d’intenses actions de lobbying, une commission a été créée au niveau du ministère de la Justice, c’était assez compliqué, il y avait des contradictions internes. L’administration pénitentiaire, sa tradition c’était le service public. La loi de 1987, qui n’a finalement jamais été remise en cause, à quelques nuances près, ne privatisait ni la surveillance, ni le greffe ni la direction de la prison. Le programme de construction a été lancé. Depuis la place du privé s’est réduite. Le médical, par exemple, qui était un enjeu financier important, en est sorti : dans les nouvelles prisons, ça a duré jusqu’en 1994, même pas dix ans, mais économiquement ce n’est pas rien. Pareil pour la formation professionnelle qui a été transférée aux régions – les entreprises privées y ont beaucoup perdu. Bref, durant les années de cohabitation, la privatisation était le gros enjeu.
Pour ce qui me concerne, pendant que j’étais secrétaire général, je suis retourné travailler comme éducateur à Fleury, puis je suis passé chef de service éducatif à Fresnes, de 1986 à 1989, d’abord au CNO [Centre national d’observation] puis sur l’ensemble de l’établissement. Ensuite j’ai eu ma première période à l’administration centrale, où, en 1989, j’ai travaillé au bureau de la réinsertion. À l’époque on était très peu de socio-éducatifs à la centrale, j’étais le deuxième issu de la filière à occuper un poste dans ce bureau ; en gros, j’étais chargé des modes d’intervention des éducateurs, des services socio-éducatifs dans les prisons, de la gestion du personnel…
– Comment définissait-on les missions à l’époque ?
– C’était très tourné vers la réinsertion au sens classique : la préparation à la sortie.
– Le travail social, en somme ?
– Oui, on cherchait déjà à faire changer les choses. Je viens d’une génération où la critique du travail social était très forte, aussi forte que celle de la prison. Ça a été oublié : travail social = contrôle social. C’est une critique à laquelle je n’ai toujours pas renoncé. Dans les années 1970, y a eu un numéro d’Esprit, et des analyses d’historiens comme Jeanine Verdès-Leroux, qui ont théorisé le fait que – je vais simplifier un peu – le travail social n’existe que parce que le capitalisme existe9. Le travail social a commencé dans les usines parce qu’il fallait prendre en charge les ouvriers. Au début des années 1980, on disait au SNEPAP qu’il ne fallait pas limiter le travail social aux éducateurs, que le but était que le surveillant soit aussi un travailleur social. Mais, pour nous, il était absurde de penser que le travail social pouvait être révolutionnaire.
En 1990, je suis passé à l’inspection des services pénitentiaires et je me suis impliqué fortement dans deux mouvements. Le premier, c’est la création des métiers d’insertion et de probation, pour en faire un métier spécifique, distinct de celui d’« éducateur », et qui n’est pas un travailleur social généraliste. C’est un professionnel qui ne travaille qu’avec des personnes mises en cause par la justice, développant un accompagnement, une guidance, dont la finalité est d’aider les personnes à reprendre une vie libre, sans délinquance. Un métier qui s’appuie sur des connaissances spécifiques de criminologie pratique. L’autre réforme, c’est la première expérience de services unifiés milieu ouvert/milieu fermé, dix ans avant la création des SPIP [Services pénitentiaires d’insertion et de probation], qu’on a soutenue syndicalement – d’ailleurs, les responsables de ces services étaient des adhérents. À l’inspection, à côté des fonctions classiques, j’étais chargé de missions plus générales d’évaluation du fonctionnement des CPAL et des services socio-éducatifs en milieu fermé. Je devais aussi faire des propositions d’amélioration au directeur de l’administration pénitentiaire. Les inspections ont traditionnellement des rôles de conseil des directions (formels ou informels), j’ai développé à fond ce positionnement stratégique.
– Concrètement, c’est un travail en administration centrale : quel était le lien avec le terrain ?
– Un nombre important de collègues étaient en phase avec cette démarche, on avait donc mis en place un système expérimental, avec des services locaux – comité de probation, services socio-éducatifs, en accord avec le directeur régional, le chef d’établissement, et le JAP, qui acceptait de tenter l’expérience du service unifié. Un protocole était établi et, dans un premier temps, il y a eu une dizaine de services pilotes, validés par l’administration. On avait fait des textes de référence, pour que ça ne parte pas dans tous les sens.

– Et après cette période à l’inspection ?
– Je suis parti en Polynésie française. J’y avais été en mission en 1992 pour y développer la probation et pour expertiser la gestion des prisons, qui étaient de compétence territoriale depuis le statut d’autonomie de 1984. Pour Gaston Flosse10, la prison devait rester une compétence du territoire, ce qui ne l’empêchait pas de reconnaître qu’il n’en avait pas les moyens. À l’inverse, je défendais l’étatisation, seule solution à mes yeux pour améliorer le fonctionnement, ce qui a finalement été validé par le Gouvernement.
En 1994, j’y ai été nommé chef du service d’insertion et de probation, le premier service de ce genre à exister, en préfiguration des SPIP. J’y ai vécu six ans, jusqu’en 2000. Cette période a changé beaucoup de choses ; je suis sorti d’une vision très sociologique, pour une vision plus culturelle. C’est à ce moment-là que j’ai repris des études et fait un DEA d’anthropologie. Disons, pour simplifier, que j’avais une vision plus classique – je ne dirais pas déterministe, mais un peu quand même –, centrée sur la situation sociale des personnes. Et j’ai profondément évolué. J’y ai été amené parce qu’en Polynésie, je me suis fortement intégré : j’ai limité mon raisonnement occidental à ce qui était nécessaire, et je me suis beaucoup plus ouvert à d’autres formes de pensée. En Polynésie, quand on traite la question de la délinquance, on est forcément amené à se demander : qu’est-ce qui est crime ? Pourquoi est-ce considéré comme un crime grave ici et pas là-bas ? Comment on punit ? Comment on restaure les choses ? Mon positionnement actuel au sujet de la justice restaurative, sur le principe, est très directement lié à mon expérience là-bas.
– Votre DEA d’anthropologie portait sur ce sujet-là, la restauration ?
– Pas directement, on ne parlait pas encore de justice « restaurative » en France à ce moment là, ou très peu. Le DEA avait pour titre : « Loi, prison et inceste : choc des cultures et justice pénale en Polynésie française ». Je travaillais avec des profs de l’université de Polynésie. Ma principale référence, c’était Tobie Nathan11, que j’ai connu en Polynésie et avec lequel j’ai travaillé. Ça m’a fait aller plus dans ce sens là, l’ethnopsychiatrie, et l’étude de ce qui en criminologie permettait de travailler avec ça.
– Qu’est-ce que cela implique pour le travail d’un conseiller d’insertion et de probation ?
– Après être revenu en métropole et avoir été deux ans enseignant-chercheur à l’ENAP, je suis devenu directeur du SPIP de Charente, à Angoulême, au moment où on y expérimentait les groupes de parole pour la prévention de la récidive. C’était très lié à ce que j’avais fait en Polynésie : comment résoudre les questions, comment les travailler autrement que par le biais de l’approche individuelle ? J’ai fait un lien direct entre mon expérience et ces évolutions dans le travail de criminologie clinique. C’était difficile au début : quand on commencé, on était minoritaire dans la profession.
– Pourtant ces groupes de parole existent aussi dans le monde anglo-saxon, avec les communautés thérapeutiques…
– Justement, le monde anglo-saxon a une vision anthropologique qu’on a peu souvent en France. Il y a tous les débats sur le culturalisme, etc., certes, mais dans le monde anglo-saxon, il y a une reconnaissance des cultures différentes. On voit ce qui se passe au Canada avec les Inuits dans les prisons. Le travail de réintégration des détenus utilise les modes de vie autochtones, en installant dans les prisons des maisons communes traditionnelles et en faisant intervenir les anciens, les sages. Ce n’est pas dans les façons de faire en France. C’est même le contraire : on est sur l’universalité des représentations. Le principe français, depuis le XIXe siècle, depuis la Révolution et même avant, c’est il y aurait des droits fondamentaux, que nous avons définis, et qui seraient les meilleurs pour toute l’humanité entière. Vivre et travailler en Polynésie avec les esprits amène à modifier sa façon de concevoir les choses.
– En Polynésie, il était accepté que la pénitentiaire s’adapte ?
– C’était accepté… il faut dire qu’on n’était qu’avec des Polynésiens : on était deux à ne pas l’être en arrivant pour l’étatisation du service en 2014 (le chef d’établissement et moi, comme directeur du service d’insertion et de probation), ça immerge.
– Cette tradition de justice coutumière était très présente ?
– Bien sûr, quand je suis arrivé, on m’a dit qu’on ne pouvait rien faire dans les îles, trop lointaines, mais j’ai commencé à m’y balader et j’ai trouvé plein de relais. J’étais à 17 000 km de la métropole, je faisais ce que je voulais : j’ai fait venir dans la prison des personnes qui ont un statut de tahu’a, ce sont « ceux qui savent » – ici, on dirait de sorcier. Ailleurs, je n’aurais pas pu le faire. J’ai fait des déplacements aux Marquises, j’avais pour cela des raisons administratives, mais en réalité je voulais rencontrer telle personne pour qu’elle intervienne dans la prison à Tahiti afin de résoudre des questions graves qui se jouaient entre plusieurs détenus marquisiens. C’était quelqu’un qui avait une autorité rituelle, des pouvoirs coutumiers. Je me suis immergé là-dedans, je l’ai fait et ça a marché. Selon la logique de Tobie Nathan, il faut utiliser ce qui marche ; et ce qui marche, c’est ce qui est suffisamment inscrit dans la culture des gens pour avoir un effet.
– Cette approche peut-elle être institutionnalisée ?
– Plus facilement en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie qu’en métropole, parce qu’il y a les structures pour le faire. Mais cela peut irriguer la pensée en France, à condition de ne pas me demander seulement, quand je vais travailler avec quelqu’un, s’il est chômeur ou malade mental, mais aussi : qu’est-ce qui fait qu’il a été construit comme ça ? Qu’est-ce qui fait qu’il est ce qu’il est ? Et, à partir de là, quels vont être les leviers pour agir ? Donc en individualisant. Pas seulement en individualisant la peine, mais en personnalisant la démarche de soutien, d’accompagnement, en s’appuyant sur les ressources de la personne et sa communauté, sur sa façon d’être au monde. Ce qui rejoint les principes du R-B-R12, en particulier celui de « réceptivité ». Le système pénal occidental confine à la morale, et on peut être tenté de dire : « attention, ce que t’as fait c’est pas bien, maintenant faut que t’apprennes à faire bien ». Une autre démarche, ou une démarche complémentaire peut consister à laisser cette dimension de côté : le problème c’est comment on arrive à vivre ensemble, et comment on reconstruit des capacités pour toi de vivre avec les autres. Tes croyances, je n’ai rien à en dire, au contraire on va même les utiliser pour voir comment, dans ton système de pensée, on peut avancer vers quelque chose de positif. Voilà, c’est une approche plus anthropologique.
– Vous avez essayé de mettre en place à Angoulême cette philosophie, que vous avez développée en Polynésie ?
– Oui, notamment par la pratique des groupes de parole : intervenir en groupe, pour parler de soi avec les autres, et résoudre ainsi les difficultés, c’est quand même assez éloigné de l’individualisme occidental forgé depuis la Renaissance. Par contre chez les Inuits, chez les Indiens Navajo, chez les Polynésiens ou les Kanaks, c’est tout à fait naturel. En Nouvelle-Calédonie, ça ne se résout jamais en entretien individuel, jamais, parce qu’ils savent que ça marche très peu.
– Et il y a l’idée que c’est un groupe de pairs.
– Quand on fait un groupe de parole, on reproduit un peu l’espace du clan : dans le clan, on est tous issus du même ancêtre, on fait donc tous partie du même groupe, c’est indiscutable. Dans le groupe de parole, on est des pairs, parce que ce qui nous lie est repérable : soit on a fait le même type de délit, soit on partage des difficultés ou des caractéristiques communes – on peut construire cela de différentes manières. À l’intérieur, la circulation et l’échange des paroles vont agir sur chacun. Quand un Kanak naît, l’oncle maternel vient et respire avec lui : il lui donne le souffle de vie. La parole c’est le souffle de vie qui circule... Je ne l’ai jamais écrit dans une note administrative quand j’étais à la DAP, mais j’ai cette idée en arrière-fond.
– Nous sommes donc en 2002...
– Oui, Angoulême, les groupes de parole : au début on prêchait dans le désert, puis on s’est déplacé ; comme j’étais le chef du service je disais « on y va », même si personne ne le favorisait dans l’administration. Avec les collègues d’Angoulême, j’ai fait des présentations dans différents autres services, j’ai écrit des textes… J’ai bénéficié du fait que j’avais un certain statut, je n’étais pas totalement inconnu dans la pénitentiaire ; peut-être qu’à un autre ils auraient dit d’arrêter de jouer et de travailler sérieusement.
– Dans les références de ces groupes de parole, vous parliez des pratiques coutumières ou de ce qui se fait dans d’autres pays occidentaux ?
– La référence principale c’était effectivement les pays occidentaux, pour avoir une référence dite « scientifique », en particulier des pratiques au Canada, en Écosse… Pendant ces trois ans à Angoulême, je m’appuyais surtout sur le « What Works », développé dans ces pays dans les années 199013. Je suis ensuite revenu à l’administration centrale, en 2006. Le directeur, Claude d’Harcourt, cherchait quelqu’un pour travailler sur les SPIP, il m’a appelé.
– Quelle était votre feuille de route ?
– L’approfondissement de la réforme des SPIP, en particulier au niveau des méthodes d’intervention. La limite de la réforme de 1999, c’est qu’elle a été principalement structurelle, avec en plus des textes de référence compliqués. Or les gens ont besoin d’une ligne de conduite claire pour dire : quel est mon boulot avec le détenu, le probationnaire ?
– Sur quoi la mission devait-elle être recentrée, précisément ?
– La prévention de la récidive, autrement dit les bonnes pratiques qui ont une chance d’aider la personne suivie à sortir de la délinquance, ce qu’on nomme aujourd’hui la désistance. C’est ce qu’on cherchait à définir dans les années 1970-1980, mais on ne disposait pas alors des références scientifiques, intellectuelles qui se sont développées depuis, grâce à des recherches criminologiques14.
– Mais pas entendue comme travail social ?
– Non, le travail social en est une composante, mais pas la seule. C’est maintenant banal : un SPIP, son but ce n’est pas que les gens qui étaient chômeurs ne soient plus chômeurs ou que les gens qui étaient ceci ne le soient plus ; ils sont délinquants et on est mandatés pour les aider à sortir de ça, à trouver une place dans la société. Si le gars me dit qu’il n’a pas envie de travailler, je ne porte pas de jugement moral, ni de jugement social : je travaille dans la pénitentiaire, je suis mandaté pour l’aider à ne plus être délinquant. S’appuyer sur un mandat social clair, plus orienté vers un accompagnement individuel des personnes, et pas seulement vers l’orientation. « Ah bon, tu as un problème de boulot, je vais téléphoner au conseiller de Pôle Emploi, il va te recevoir » : je ne suis pas sûr qu’il y ait besoin de grands spécialistes pour faire ça. Par contre, travailler avec la personne dans une relation positive pour l’amener à penser autrement son rapport aux autres, sa vie dans la société, etc., demande du temps, des gens payés pour le faire ; c’est un boulot en soi.
– Ce qui a été retenu de ce moment, c’est plutôt la partie évaluation, non ?
– Oui, parce que c’est très lié et la première étape, indispensable, de la démarche. Pour faire fonctionner un groupe de parole correctement, il faut savoir qui on va y mettre, comment, et donc faire une évaluation individuelle la plus pertinente possible. Après, il y a des positionnements syndicaux, idéologiques, qui n’enrichissent pas le débat, en ne prenant qu’un aspect du problème – l’évaluation – et en l’interprétant en dehors du contexte. La réflexion est venue de professionnels, sans aucune injonction ministérielle. L’évaluation ce n’est pas un objectif en soi : c’est parce qu’on veut soutenir au mieux la personne individuellement qu’il y a de l’évaluation, pour savoir où on va. Contrairement à ce qui a pu être dit, il n’a jamais été question de faire des prédictions, mais d’évaluer ce qui, dans mes interventions de CPIP a une chance raisonnable d’agir positivement vers la désistance. Ce n’était pas lié à une quelconque situation politique.
– C’était une période de réécriture des statuts…
– Oui, notamment la circulaire de 2008, actualisant les missions des CPIP, dont je fus l’initiateur. Ça n’a pas été facile, mais les choses ont avancé intellectuellement. Des polémiques se sont développées entre syndicats, certains revendiquant de rester dans une définition du métier de CPIP limitée au travail social – avec d’ailleurs une sorte de fétichisation de ces mots polysémiques, qui peuvent désigner des quantités de professions et de fonctions différentes. Disons que c’était l’aboutissement d’un vrai changement et, comme tout vrai changement, cela fait débat.
– Cette réforme a parfois été comprise comme une rupture avec le travail social comme accompagnement, au profit d’un recentrement sur de l’évaluation-orientation…
– Alors que c’est l’inverse ! Le positionnement de la CGT était invraisemblable. D’ailleurs, il a créé des divisions chez eux. Quand, avec Claude d’Harcourt, nous avons présenté la nouvelle circulaire en comité technique paritaire, après de nombreuses réunions que j’avais animées avec les syndicats – le principal représentant CGT avait déclaré que si ça ne tenait qu’à lui, il voterait pour ce texte –, la CGT a demandé une suspension de séance : ils sont revenus pour voter contre… Le métier de CPIP doit être sérieusement valorisé et demande des compétences lourdes. Certains se plaignaient qu’on recrute surtout des diplômés de l’enseignement supérieur, mais il y a un niveau de réflexion à avoir… je ne dis pas que les diplômes font l’intelligence, mais le fait de travailler sur la prévention de la rechute dans la délinquance, c’est un boulot exigeant intellectuellement !
– Avec un modèle d’intervention davantage pensé comme une thérapie en psychologie, ainsi qu’y invite Tobie Nathan ?
– L’expertise et l’évaluation ne valent que si elles débouchent sur l’accompagnement individuel. Le problème, c’est que le débat s’est focalisé sur l’évaluation, au moment où je suis parti en Nouvelle-Calédonie, en octobre 2010. On avait des SPIP pilotes, on était au stade de la réflexion et il n’y avait pas encore de polémiques. Ensuite le dispositif a été élargi pour tout le monde d’un coup en disant dans une circulaire « le DAVC pour tout le monde »15 – un problème de méthode. Au lieu d’avoir une co-construction d’un instrument partagé, c’est devenu une injonction centrale, bureaucratique. Et ça a plombé le sujet. Mais la circulaire de 2008 existe toujours, elle n’a pas été remise en cause et personne ne demande son abrogation.
– Mais il y a eu ce débat sur la référence au travail social…
– Ce que je trouve fou, c’est la pauvreté idéologique de notre époque. Quand je repense au débat qu’on avait, dans les années 1970, sur le travail social… On se rendait compte que le travail social n’a rien de révolutionnaire en soi, qu’au contraire il joue un rôle totalement intégré à la société telle qu’elle est. On sait qu’il y a des failles et comme il faut faire quelque chose, les travailleurs sociaux sont là pour recevoir des gens, les aider ou faire comme si on les aidait. Le travail social n’a pas de capacité de transformation en lui-même : il ne l’a jamais fait. Des gens qui sont travailleurs sociaux peuvent avoir cette capacité, mais penser que le travail social ce serait « bien », voire « de gauche », alors que d’autres choses seraient « de droite », c’est une pensée médiocre. Ce débat sur le travail social est complètement à côté de la plaque. Après, savoir si les CPIP sont des travailleurs sociaux : tout dépend de ce qu’on met sous ces mots-là. Oui, ils ne sont pas des agriculteurs ou des boulangers, c’est sûr. Mais un directeur d’EHPAD, c’est aussi un travailleur social… Si on le restreint à la figure de l’assistante sociale, non, un CPIP n’est pas tout à fait dans la même catégorie. Cela ne veut pas dire que l’un est mieux que l’autre, mais que ce sont deux métiers différents.
– Ce n’est pas une figure de l’aide ?
– J’utilise peu ce mot « aide » renvoyant à des actions vers des personnes qui ont des insuffisances, des déficiences, comme les personnes handicapées. Non, je préfère dire que c’est un soutien, un accompagnement, ce qui inclut l’idée qu’il doit devenir inutile à terme – évidemment on aide aussi la personne, mais pour moi, tout le travail du CPIP c’est de l’amener à penser librement qu’elle peut se comporter autrement. La délinquance pose la question de l’interdit, qui est majeure car elle fonde toute société : il n’y a pas de société humaine sans interdit, c’est ce qui permet de vivre ensemble. C’est cette prise de conscience essentielle qu’il faut viser. Pour y arriver, le CPIP, plus qu’un aidant, doit être une référence positive pour la personne suivie, une guidance.
J’ai beaucoup travaillé avec les délinquants sexuels à Angoulême. À l’époque, on disait qu’on ne pouvait rien faire avec les délinquants sexuels. On ne peut rien faire ? C’est gênant, parce que, justement, on les a en charge. Alors, il est évident qu’avec un délinquant sexuel, la première question à se poser ce n’est pas s’il a ou non son bac. On va travailler sur les faits : la très grande majorité des délinquants sexuels présentent leur délinquance comme le résultat d’un déterminisme, ils n’ont pas pu faire autrement. Plein de délinquants se présentent de cette manière, c’est une façon de se défendre. Mais toute la question est de sortir d’un discours de pure défense, et de voir, à partir de là, ce que tu deviens, quelles ressources tu as en toi, comment tu gères ça, comment tu t’en sors – même si un certain nombre de problèmes ne sont pas résolus.
– Justement, dans les résistances au DAVC, il y avait le sentiment qu’on ne proposait pas grand-chose aux gens une fois qu’on les avait mis dans un segment….
– Il faut que les CPIP se persuadent qu’eux-mêmes peuvent agir. Que le fait d’être en relation avec quelqu’un, son environnement, ses proches, permet d’agir. Sinon, dans une vision classique du travailleur social, on se tape la tête contre les murs. Quand je suis arrivé au SPIP de l’Essonne, j’ai reçu individuellement les travailleurs sociaux. La situation était difficile pour l’hébergement des sortants de prison. Certains passaient beaucoup de temps à courir d’un lieu à un autre, alors qu’on savait qu’on n’y trouverait pas de solution ; c’est complètement déprimant de faire ça. Le travail permettant d’aider la personne à vivre par elle-même, dans l’ici et maintenant, passait au second plan. Il y a 3,5 millions de chômeurs selon les chiffres officiels, plus si on prend d’autres chiffres, et on a 70 000 détenus, ça fait un gap quand même : l’immense majorité des chômeurs n’est pas détenue. Il y a un travail d’accompagnement à faire, plus individuel et personnel qu’une simple orientation vers des dispositifs existants – mieux vaut passer une convention avec Pôle Emploi, que ses agents viennent parler en prison, rencontrer directement les détenus.
– Donc l’évaluation…
– L’idée, c’est que si le professionnel n’a pas une démarche ordonnée, structurée, il n’y a aucune raison que, par magie, il trouve les bonnes pistes. Un gars qui fait de l’action de lutte contre l’illettrisme, il ne va pas seulement discuter avec la personne : non, il a des moyens d’évaluer. En tant que CPIP, nous avons des moyens d’intervention, nous devons voir lesquels mobiliser en fonction de sa situation. Et l’évaluation va permettre d’inventer de nouveaux moyens d’intervention.
– Et là, il y a des références intellectuelles ?
– Beaucoup, elles sont quasiment toutes en anglais… Je suis rentré dans la littérature anglo-saxonne quand j’étais à Tahiti. 80 % de la littérature anthropologique sur Tahiti est en anglais, ce qui est surprenant pour un territoire français, mais ça en dit beaucoup. J’ai commencé par lire des choses sur Tahiti en anglais, et petit à petit, j’ai lu aussi la criminologie…
– Après, en 2010 vous êtes parti de nouveau…
– J’ai pris mon poste en Nouvelle-Calédonie en 2010, jusque fin janvier 2013. Ça m’intéressait de retourner en Océanie. C’était passionnant, l’occasion d’approfondir tout ce dont on vient de parler, et en particulier ma réflexion sur la justice restaurative (en travaillant avec les clans, pour comprendre leurs procédures de réintégration).
Puis, en 2012, au moment de l’élection de François Hollande, le poste de directeur de l’ENAP est devenu vacant : j’ai sauté sur l’opportunité, d’autant que le contexte politique me convenait (je ne l’aurais pas fait, je pense, après un autre résultat à l’élection présidentielle). J’étais très bien à Nouméa mais c’était une occasion unique. J’ai fait connaitre immédiatement mon désir de prendre ce poste au cabinet de la Garde des Sceaux. Personne ne pensait à moi au départ, mais ça a marché.
Un de mes axes de travail à l’ENAP a été de rénover profondément la formation des CPIP. On a introduit le nécessaire dans leur formation pour bien comprendre pourquoi on évalue, et comment le faire selon le mouvement du « What Works ». On a instauré l’entretien motivationnel, pour expliquer que ce qui va compter dans l’évolution d’une personne, c’est bien sûr la personne elle-même mais aussi le CPIP, sa manière d’interagir avec elle, de créer une situation positive permettant à l’autre de réfléchir.
– D’où vient votre inspiration sur l’entretien motivationnel ?
– C’est quelque chose qui a été théorisé initialement dans des professions de type médical, et c’est lié à tout le reste : dans l’entretien motivationnel, la base n’est pas d’apprendre quelque chose à quelqu’un, mais de l’aider à faire ses propres choix. Le but principal c’est que la personne se motive en se disant « je peux faire autre chose ». Le travail du CPIP est ici essentiel. Il a fallu sortir d’une espèce de complexe d’infériorité selon lequel certaines choses ne pourraient être faites que par un psy. Le boulot du CPIP, c’est bien-sûr de connaître la loi – il sait ce qui est interdit –, mais il est aussi sensé pouvoir aider la personne à se rendre compte que certaines de ses pensées sont des impasses. Sans lui dire comment il doit vivre, c’est une question de comportement et d’attitude. C’est essentiel ! Dans les services, on peut voir des collègues qui reçoivent les gens dix minutes maxi, et d’autres 1h 30 : il faut y réfléchir un peu, ça peut être terrible d’obliger quelqu’un à parler pendant 1h30, ou de ne lui consacrer que dix minutes… Dans l’entretien motivationnel, on travaille ces différents aspects : la posture, le fait de pouvoir être une référence, que le gars puisse se dire qu’il va lui être utile de dialoguer. Avec, au bout, la possibilité pour la personne suivie d’aller vers le changement. C’est la finalité principale pour ne pas dire unique du travail du CPIP : accompagner les personnes délinquantes afin qu’elles puissent penser un changement de vie et l’engager.
– Est-ce la même démarche de critique de la prison que vous aviez au début, ou cette position a-t-elle changé ?
– Je ne pense pas qu’elle ait fondamentalement changé ; je pense que la mesure elle-même, que ce soit la prison ou la probation, ne veut pas dire grand-chose. Quelle prison, quelle probation ? C’est mieux pour qui, pour quoi, comment ? Ce qui compte c’est le contenu qu’on donne, ce qui se passe pendant ce temps-là. Cet échange avec la personne, on peut l’avoir aussi bien en prison qu’en probation ; c’est plus une question de temps, de façon d’être, de manière de se positionner. Je ne vois pas comment on pourrait démontrer que la prison en soi, ou la probation en soi ont un effet positif.
Ce sur quoi j’ai changé, c’est qu’il y a quarante ans, je mythifiais beaucoup plus le milieu ouvert que je ne le fais maintenant. Pour moi, c’est plus l’action, la façon dont on va construire sa relation avec la personne dont on la charge qui compte. On dit beaucoup qu’il faut développer la probation pour qu’il y ait moins de détenus, or, historiquement, cela n’a pas été prouvé. Bien sûr, je pense qu’il faut réserver la prison aux cas les plus graves, pour lesquels on pense qu’il y aurait des troubles à l’ordre public. Mais l’intérêt, ce n’est pas d’être sévère ou pas. Certains disent que la probation aussi peut être dure : et alors ? On va faire de la probation « dure » juste pour montrer qu’on peut être aussi dur que la prison ? C’est complètement vain, ça ne veut rien dire ! Non, ce qu’il faut, c’est avoir des exigences dans le boulot : si je pense qu’il faut que je voie souvent cette personne, je vais la voir souvent et l’amener à comprendre pourquoi il faut que je la voie souvent, pas simplement pour être « dur ». Il y a des moments où il vaut mieux ne pas voir les personnes parce que ça ne sert à rien, ça braque, et des moments où on sent que ça accroche ; tout ça, c’est au cas par cas et on doit réévaluer de façon permanente.
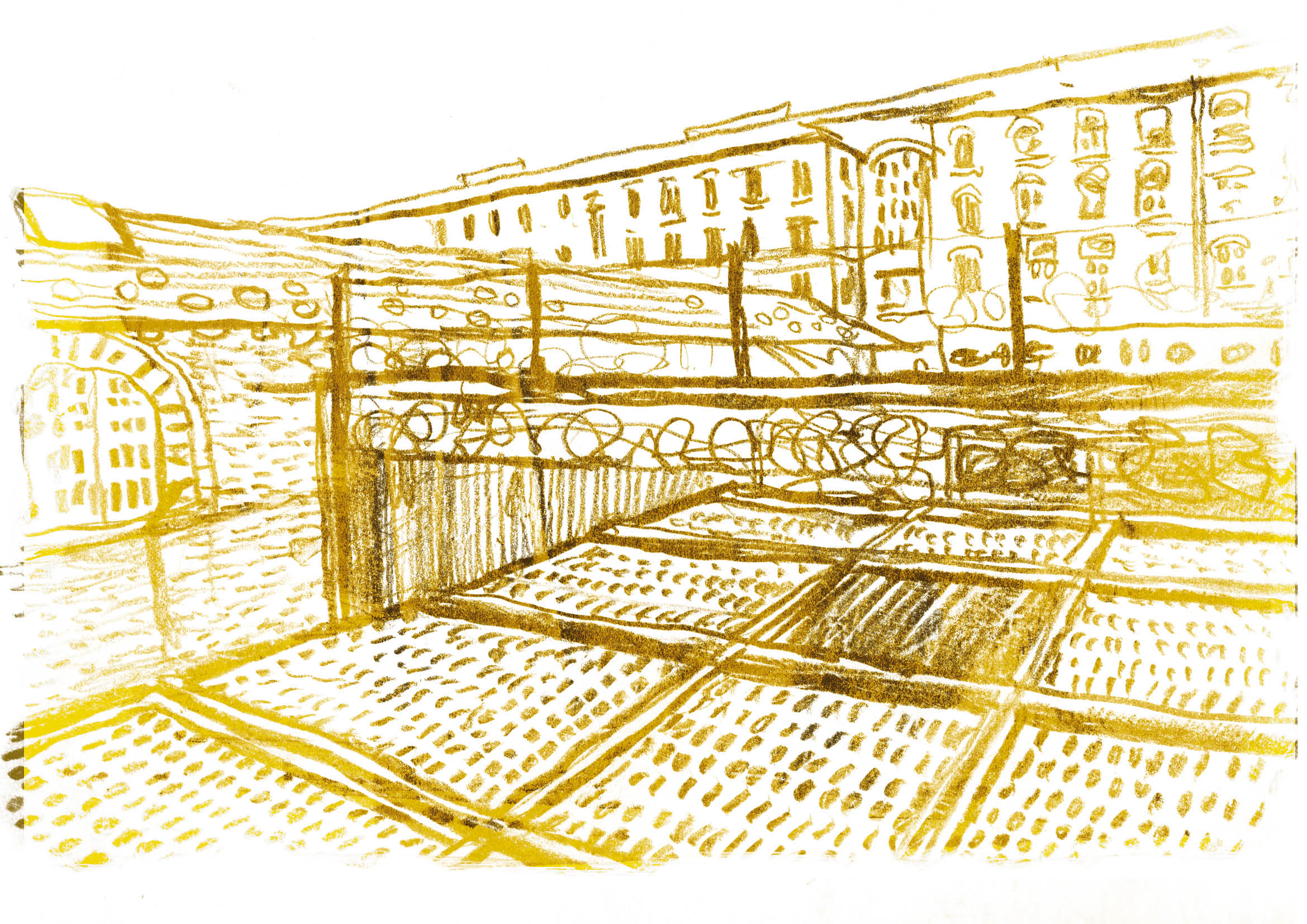
– Dans quelle mesure avez-vous pu parfois vous sentir enfermé dans le monde de la prison ?
– Il y a un principe auquel je me suis toujours tenu, dans les différents postes que j’ai occupés : le jour où tu passes pour la première fois le seuil d’une prison où tu n’as jamais été, et que ça ne te fait rien, tu arrêtes. Et ça m’a toujours fait quelque chose, ça ne m’a jamais laissé indifférent, ça s’est toujours accompagné d’une appréhension. Voilà. Je n’ai jamais abandonné cette idée ; et entrer dans une prison ne m’est jamais devenu naturel. C’est une façon un peu déviée de répondre à la question, mais je suis toujours dans cet état d’esprit, y compris dans mon travail actuel d’expertise pour des réformes des prisons dans d’autres pays. En Mauritanie, récemment, j’ai visité cinq prisons en deux semaines. J’ai toujours pensé que le jour où je rentrerai dans une prison comme au supermarché, j’arrêterai, ça ne m’est jamais arrivé donc je continue – même après la retraite.
– Et qu’est-ce que la prison vous a appris sur vous-même ?
– Tout est lié, si je n’avais pas travaillé dans la pénitentiaire je ne serais pas allé en Polynésie, où j’ai appris énormément de choses… et puis oui, toute cette évolution vers une vision anthropologique, presque psychologique au sens commun du terme (et non au sens médical), de prise en compte de la personne… La prison m’a fait relativiser beaucoup de façons de considérer les choses et les personnes… ce n’est jamais exactement comme on peut l’imaginer. En prison, j’ai connu des expériences exceptionnelles que je n’aurais jamais pu faire ailleurs (mais ce n’est pas pour cela qu’il faut qu’il y ait des prisons !). J’ai fait des ateliers de théâtre pour des gens incapables de parler à qui que ce soit, qui se sont mis à déclamer du Shakespeare devant tout le monde. Pour le premier concert que j’ai organisé à Fresnes, au milieu des années 1980, j’ai été en contact avec une bourse américaine – qui finançait de jeunes talents à condition qu’ils jouent dans des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Ils m’ont dit qu’ils voudraient faire un concert à Fresnes avec une jeune femme américaine jouant du violon alto en solo – du violon alto, pas de la guitare électrique ! J’ai tout de suite accepté. On avait une réunion hebdomadaire de tous les services de la prison, je dis « on va faire ce projet », on me dit « tu es dingue », je commence à théoriser le truc : « on peut avoir accès aux personnes par des choses comme ça, des chemins qu’on n’imagine pas ». Le jour vient, la jeune femme, d’une vingtaine d’années, arrive, on va dans la grande chapelle du fond. Les mecs s’entassent, elle commence, elle joue une première partie : il ne se passe pas grand-chose. Évidemment, le violon alto c’était de la musique du XIXe siècle... Elle fait un entracte et là, elle a un coup de génie : « je vais vous raconter comment j’en suis arrivée là ». Et elle explique comment, depuis toute petite, elle passe des heures à travailler sa musique, l’exigence personnelle constante, etc. Des centaines de mecs et cette petite femme au milieu qui raconte ça. J’ai vu des mecs pleurer. À la fin, elle est applaudie, longuement. Les gars debout. Elle me remercie devant eux pour avoir rendu cela possible, et ils m’ont tous applaudi ; alors, c’est bête, mais je ne vois pas d’autre endroit où j’aurais vécu ça aussi intensément. Ce n’est pas suffisant, mais peut être que quelques gars, rien qu’avec ça, leur cerveau s’est mis à réfléchir différemment ; je suis sûr que ça a agi sur certains, ça se sentait. Même par rapport aux surveillants : « Incroyable, ça a marché ». C’était la première fois qu’on faisait un tel concert à Fresnes. Quand j’y suis arrivé, on commençait les opérations « anti été chaud », on faisait les premiers partenariats avec les préfectures pour que les gens intervenant dans les maisons de quartier puissent aussi intervenir dans les prisons.
Quand on dit qu’il faut éviter la « désocialisation » que crée la prison, pour moi ce n’est pas le bon mot. Bien sûr, la prison pose des problèmes en termes d’insertion professionnelle et autres, mais il n’y a pas de lieu plus socialisé que la prison : ce n’est pas la nature, c’est totalement socialisé. C’est une socialisation particulière, sur laquelle on peut travailler – tel est l’enjeu des modules « Respect » par exemple16. Comprendre que la prison, à un moment donné, c’est la socialisation de certains individus, c’est là qu’ils vivent en société, parfois pour très longtemps. Comment fait-on pour que cette vie soit la moins négative possible ? Après, ce sont des humains entre eux. Pas besoin d’aller en prison pour trouver des comportements scandaleux, mais en prison on peut trouver aussi des comportements admirables, voilà.
Notes
1
Marie Morelle, Frédéric Le Marcis, Yasmine Bouagga, et Christine Deslaurier. « Des prisons en Afrique : expériences, modèles et circulations », 2019 [en ligne].
2
Alain Geismar, homme politique et physicien français né en 1939, fut l’un des meneurs des manifestations étudiantes de mai 1968, avec Jacques Sauvageot et Daniel Cohn-Bendit. Engagé dans le mouvement maoïste avec la Gauche Prolétarienne, il est condamné en 1970 à 18 mois de prison et est incarcéré à Fresnes.
3
L’ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions) est un établissement public d’information sur les formations et les métiers.
4
Parti Socialiste Unifié, Parti Socialiste, Ligue Communiste Révolutionnaire, Parti Communiste Français.
5
Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples.
6
Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975.
7
Ces deux régimes carcéraux proposent des modèles d’amendement moral des condamnés, l’un fondé sur la séparation, l’autre sur un isolement partiel et le travail collectif. Voir : Norval Morris, David J Rothman, The Oxford History of the Prison. The Practice of Punishment in Western Society, New York, Oxford University Press, 1995.
8
Les « Comités de Probation et d’Assistance aux Libérés », sous la tutelle du tribunal, avaient alors peu de moyens et fonctionnaient alors essentiellement avec des bénévoles.
9
Voir notamment : dossier « Pourquoi le travail social ? », Esprit, avril-mai 1972 (le numéro est republié en 1976 sous le titre « Contrôle social et normalisation ») ; Jeannine Verdès-Leroux, Le Travail social, Paris, Éditions de Minuit, 1978.
10
Président du gouvernement de la Polynésie française (1984-1987, 1991-2004).
11
Psychologue, il est l’un des fondateurs de l’ethnopsychiatrie en France.
12
Pour « Risque, Besoin, Réceptivité », un modèle classique d’évaluation et de réadaptation des délinquants.
13
Un article retentissant de Robert Martinson, publié en 1974, concluait à l’inefficacité des programmes de réhabilitation des condamnés, résumé en « nothing works » ; en réponse au recul des interventions thérapeutiques qui s’en est suivi, un mouvement contraire a entrepris, dans les années 1980-1990, de donner de meilleures assises théoriques et cliniques aux programmes de réinsertion. Voir : Bastien Quirion, « Traiter les délinquants ou contrôler les conduites : le dispositif thérapeutique à l’ère de la nouvelle pénologie », Criminologie, vol. 39, no 2, 2006, p. 137-164 [en ligne].
14
Le terme de « désistance » désigne le processus d’arrêt d’un parcours de délinquance ou de criminalité. Pour une synthèse récente, voir : Alice Gaïa, Xavier de Larminat, Valérian Benazeh (dir.), Comment sort-on de la délinquance ?, Genève, RMS Éditions, 2019 [en ligne].
15
Le « Diagnostic à visée criminologique » (DAVC) est un formulaire d’évaluation des facteurs de risque susceptibles d’entraîner une réitération d’actes délinquants, dont l’objectif est de rationaliser et d’harmoniser les prises en charge par les SPIP des condamnés répartis en différents « segments ». Le DAVC a été interprété comme l’importation en France de méthodes actuarielles de prévision des risques, standardisant la réponse pénale au lieu de l’individualiser. Voir : Xavier de Larminat, « La technologie de mise à distance des condamnés en France. La centralisation informatique des données socio-judiciaires », Déviance et Société, vol. 37, no 3, 2013, p. 359-373 [en ligne].
16
Il s’agit de modules pilotes de prévention de la violence en détention, inspirés d’expérimentations espagnoles.