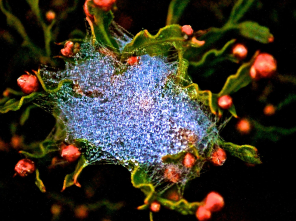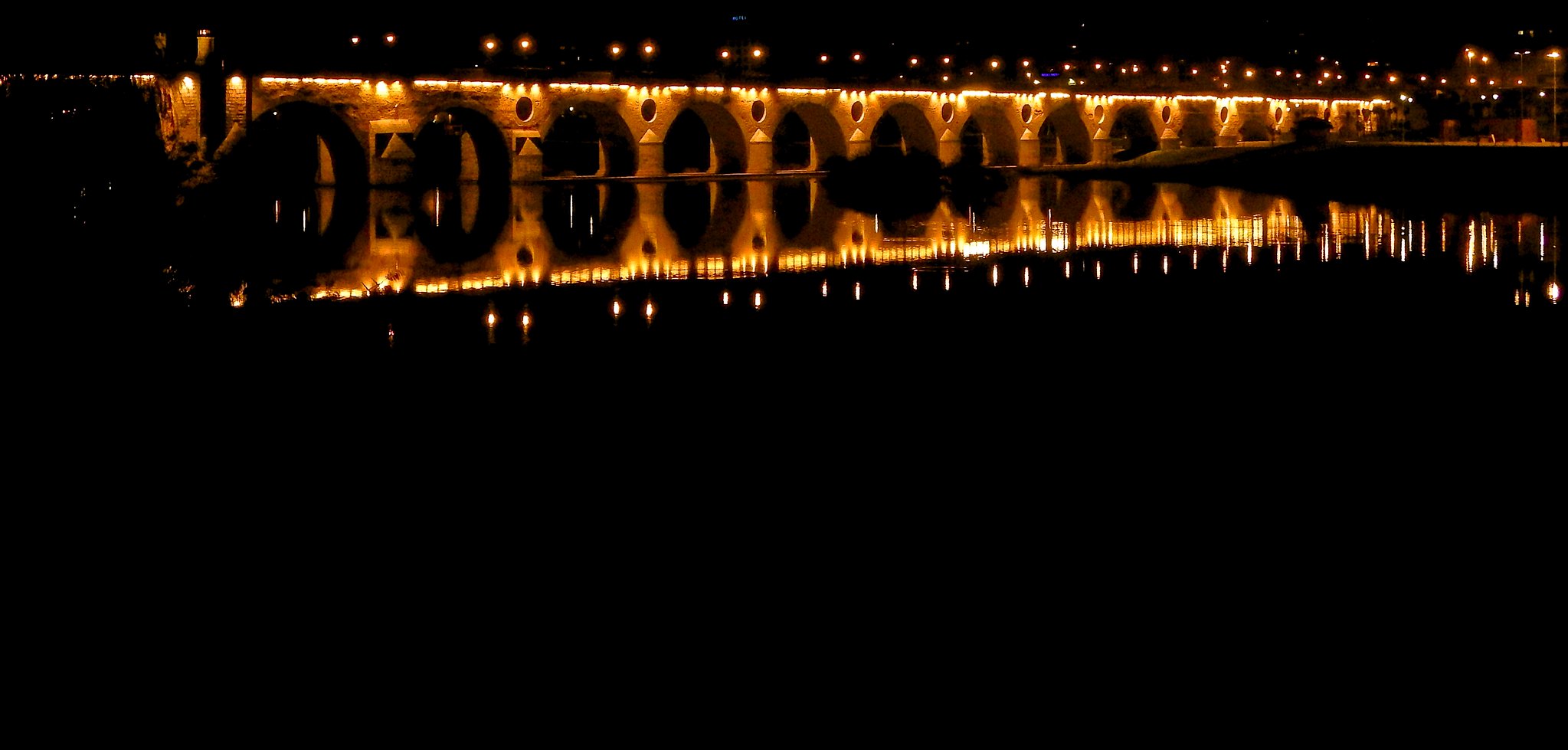
Guadiana.
Le 15 septembre 2022, le musée virtuel de la guerre d’Espagne (www.vscw.ca) a été inauguré à l’université de Trent, au Canada. La plupart des journaux espagnols et une partie de la presse internationale comme The Guardian ont fait un large écho à cet événement, émettant de nombreuses hypothèses sur sa signification et sur les raisons pour lesquelles il a été réalisé au Canada et non en Espagne1. Cet article se propose de traiter ces deux thèmes, tout en situant le musée dans le contexte européen. Pour ce faire, nous commencerons par les origines du projet et son développement.

Musée virtuel de la guerre d’Espagne.
Les origines du musée
Tout a commencé en 2014, par une conversation entre deux collègues et amis, Adrian Shubert et Antonio Cazorla. Le premier donnait alors un cours sur la guerre d’Espagne (1936-1939) et se posait la question de l’utilisation des ressources numériques, notamment celles que ses étudiants auraient à constituer dans l’optique du cours. La conversation a débouché sur l’interrogation suivante : pourquoi ne pas créer une ressource plus importante, comme un grand portail web, sur le conflit ? De là à conclure qu’un tel portail pouvait être un musée, il n’y avait qu’un pas. Nous avons commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs. De tous les musées virtuels que nous avons consultés, celui qui a le plus retenu notre attention était le Belgium World War II, musée virtuel belge sur la Seconde Guerre mondiale et l’Occupation. Nous tenions notre référence qui, en outre, était d’une qualité remarquable et d’une grande beauté !
Deux questions devaient être réglées avant de pouvoir commencer à construire notre musée. L’une était de savoir comment le financer ; l’autre, non moins importante, était de le situer dans le panorama de l’histoire publique en Espagne et en Europe, c’est-à-dire d’appréhender quelle pouvait être sa raison d’être, tout en sachant que ces deux aspects étaient étroitement liés. Pour commencer à concevoir notre projet, nous devions comprendre ce que signifiait, dans le nouveau millénaire, un musée numérique d’une guerre civile et ce qu’il pourrait représenter dans le contexte international. Nous devions donc prendre le temps de parler avec d’autres collègues, dans l’espoir que, de ces conversations, naissent des concepts nouveaux (du moins pour nous) et, si possible, un plan d’action. Il fallait donc commencer par trouver de l’argent pour financer des réunions avec ces collègues.
En 2014, l’université de York, où enseignait Adrian Shubert, nous a accordé une subvention de 3 500 euros. Grâce à la collaboration d’Alison Ribeiro de Menezes, professeure de cette université, ainsi que de fonds privés émanant de certains participants, nous avons pu organiser un séminaire, de deux jours, à l’université de Warwick, au Royaume-Uni, auquel ont participé Alfredo González Ruibal, du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC, pour son sigle en espagnol), et Joan Maria Thomàs, de l’Universitat Rovira i Virgili de Tarragone (Espagne), pour ne citer qu’eux. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre ce à quoi nous allions être confrontés ; mais il restait encore beaucoup à faire pour cerner toutes les implications théoriques et pratiques du projet. C’est pour cela qu’en 2016, nous avons demandé et obtenu une bourse du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), issue de son programme Connexion. Le projet, qui s’appelait alors « Histoire numérique de la guerre d’Espagne », fut doté de 10 000 euros. Avec cet argent, nous avons organisé un second séminaire, ouvert au public, au Memorial Democràtic de Barcelone (Espacio Memorial Democrático de Cataluña), qui nous a offert ses ressources de façon désintéressée. Cette réunion s’intitulait « International Seminar Communicating Contested Histories : Public Humanities and the Spanish Civil War » (Séminaire international. Transmettre les événements historiques controversés : les sciences humaines publiques et la guerre d’Espagne). Outre les collègues déjà mentionnés ainsi que certaines personnes extérieures au projet, dont la participation était capitale pour son avancement, le groupe de travail a été rejoint par Sofía Rodríguez López – qui travaillait alors à l’université de Cadix (Espagne), aujourd’hui à la Complutense de Madrid – et Jesús Espinosa Romero – alors membre du Centre documentaire de la mémoire historique de Salamanque (CDMH, pour son sigle en espagnol), ayant rejoint depuis les Archives générales de l’administration espagnole. Une publication collective2 est née de cette rencontre ainsi qu’un plan d’action plus réaliste quant à la poursuite du projet.
Investigations préalables
Dans cette publication, nous soutenons l’idée que l’Espagne souffre d’un déficit en histoire publique, et pas seulement en ce qui concerne la guerre civile. Par histoire publique, nous entendons celle destinée à l’éducation du grand public, par le biais de publications, de musées, d’expositions, de documentaires, etc.3 Le manque de musées d’histoire en Espagne est la preuve la plus évidente de cette pénurie. Si on la compare à la France, par exemple, il suffit de souligner que cette dernière compte plus d’une centaine de musées dédiés à la seule Seconde Guerre mondiale. Comme on le sait, le premier musée consacré à l’histoire de la guerre civile espagnole est en cours de construction à Teruel4. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il n’existe pas de musée sur le sujet en Espagne. Le réseau créé par le Consorcio Memorial de los Espacios de la Batalla del Ebro (« Association mémorielle des lieux de la bataille de l’Èbre » ; COMEBE, pour son signe en espagnol ; www.batallaebre.org) en est un exemple. Mais nous pensons que ces institutions dédiées à la diffusion de la connaissance – même si l’on ajoute le Centre documentaire de la mémoire historique de Salamanque, qui possède une minuscule exposition permanente sur la guerre civile, et le Memorial Democràtic de Barcelone lui-même, malgré son ambitieux programme d’expositions temporaires – ne suffisent pas à créer, dans l’ensemble de la société, une conscience fondée sur une connaissance – que d’autres appelleraient « mémoire » – de la guerre et de la dictature. Ce sont des centres de mémoire et de connaissance, mais qui ne bénéficient pas d’une reconnaissance nationale ; autrement dit, ils ne jouissent pas d’une autorité suffisante pour être considérés, par les médias et par le public, comme des arbitres décisifs dans les débats sur la guerre civile. À titre d’exemple, il n’existe pas de centre d’interprétation équivalent au musée berlinois Topographie de la terreur, sur la dictature nazie. L’Espagne dispose certes d’« îlots » de mémoire, aptes à toucher des groupes de population et des espaces géographiques limités, mais pas de véritable « continent » de mémoire, qu’un vaste réseau de musées sur la guerre et sur le franquisme pourrait créer, qui serait capable de faire naître une conscience, d’installer des connaissances solides, étendues et reconnues. En particulier, un grand centre de référence créé par l’État pourrait contribuer à mettre en place un récit du passé accepté par la majorité de la société. Le résultat est que la muséification du passé de l’Espagne est d’une grande pauvreté. Sans discours, il ne peut y avoir de représentation. Pour procéder à une autre comparaison, entre l’Espagne et la France cette fois, quiconque souhaite visiter le site de Belchite, à Saragosse, se trouvera face à un programme de diffusion a minima, fondé sur un site web dédié à la vente de billets (www.belchite.es) et une prestation certes méritoire, mais pauvre en ressources, notamment en termes de guides. Même l’accès aux ruines est loin d’être aisé. En revanche, quiconque se rend sur le site d’Oradour-sur-Glane passe en premier par un centre-musée commémoratif très bien réalisé (www.oradour.org), puis par les ruines du « village martyr ». L’accès routier bénéficie d’une excellente signalétique, des dizaines de kilomètres autour du site, celui-ci offrant en outre à ses visiteurs une multitude de services. Cependant, une autre chose est le contenu du discours présenté, qui souffre à notre avis de graves lacunes et de nombreux angles morts.
Alors ! Pourquoi un musée au Canada et pas en Espagne ? Parce que l’Espagne ne semble pas pressée de créer un centre national de référence sur la guerre civile. Les propositions en ce sens, qui émanaient toutes de gouvernements de gauche, ne se sont jamais concrétisées. Les gouvernements de droite ne les ont jamais traitées ou les ont rejetées, les accusant de vouloir rouvrir les plaies du passé. La connaissance historique est la première victime de ce comportement. Ce vide contraste d’ailleurs avec la cohérence du projet mémoriel franquiste, qui s’appuie sur des pôles d’interprétation à l’échelle nationale, ceux-ci venant compléter un réseau dense au niveau local. Si le « Valle de los Caídos » (« la vallée des morts ») représente le martyre subi par les troupes de Franco durant la guerre civile, l’Alcazar de Tolède porte le témoignage de leur sacrifice et de leur détermination à vaincre. Enfin, le défilé annuel de la Victoire était le point culminant de tous ces efforts, de ce martyre et de cette lutte, présentés au regard vigilant de celui qui représente l’axe véritable de tout ce discours : Francisco Franco. Pour leur part, les trames locales du projet mémoriel franquiste sont fortes de milliers de croix et de plaques en hommage aux combattants tués, disséminées sur tout le territoire espagnol et utilisées aux dates définies par le calendrier commémoratif du régime – notamment le 20 novembre et le 18 juillet – pour réaffirmer et rapprocher de la population le message officiel de l’État, c’est-à-dire son interprétation de l’origine et de la signification de la guerre civile. La démocratie espagnole a certes construit des monuments locaux et recréé des lieux de mémoire, mais elle ne dispose pas, sur le conflit ou la dictature, de centre de mémoire national ni de message majoritaire cohérent ou socialement accepté. Quel est donc le rôle du Canada dans un tel contexte ? Il est très simple. Les universités canadiennes ont accordé une priorité au développement des sciences humaines, dans leur version numérique. Profitant de cet élan, nous avons décidé, en tant que chercheurs experts, de faire chez nous et numériquement ce qui ne se fait pas en Espagne, ni matériellement ni numériquement. De plus, contrairement aux grandes institutions muséales, qui ont tendance à être influencées par les intérêts des États et des groupes qui les financent, notre projet est indépendant et coopératif, car tous les membres de l’équipe – des professionnels sans affiliation politique – disposent du même pouvoir de décision. Il ne s’agit donc ni d’une histoire publique d’« en bas » ni d’une histoire publique d’« en haut ».
Un aspect clé de notre projet de recherche a été l’adoption du terme « histoire controversée », apparu principalement aux États-Unis à propos de leur passé esclavagiste5. À l’instar de celui-ci, les guerres civiles sont des exemples indéniables de passés controversés ou « difficiles », dont les traces douloureuses s’étendent et perdurent, non pendant des décennies, mais pendant des siècles. Les histoires controversées sont complexes, elles s’accompagnent inévitablement de souffrances et de questions aussi actuelles que celle des réparations et de la justice, tant pour les victimes que pour les coupables. En ce sens, en tant que créateurs du musée virtuel, nous nous sommes vite rendu compte que, s’il est relativement facile d’établir des récits de conflits internationaux, les conflits intranationaux tels que les guerres civiles ou les épisodes terroristes – nous pensons à l’héritage des troubles en Irlande du Nord ou de l’ETA au Pays basque – présentent d’énormes difficultés. Notre position, qui s’inspire de celle adoptée par le musée de l’Ulster (www.ulstermuseum.org), consiste à faire la distinction entre histoire et mémoire. Cela signifie que, d’une part, en tant que professionnels, nous nous présentons comme des experts de l’histoire, qui doit être écrite avec rigueur, mais que, d’autre part, en tant que citoyens, nous admettons que les mémoires sont diverses et qu’elles doivent toujours être confrontées, dans un esprit respectueux, mais critique. En d’autres termes, l’histoire guérit la mémoire, notamment parce que, contrairement à celle-ci, elle prend en compte – ou devrait prendre en compte – le fait que le souvenir du passé change en fonction des intérêts du présent. La discipline historique ne peut être pratiquée que par des professionnels ou par ceux qui adoptent leurs méthodes, tandis que la mémoire est un domaine beaucoup plus interdisciplinaire, ouvert à la société, mais aussi moins structuré ou moins rigoureux.
Pourquoi les conflits intranationaux présentent-ils une difficulté supplémentaire ? La réponse est simple : la nation constitue le fondement de notre conception du corps politique, au sens collectif, et tout ce qui vient la remettre en question, voire la rompre, bouleverse profondément notre identité, y compris dans ses expressions les plus quotidiennes. Cette conception, fondée sur le sentiment national – au sens le plus souvent « nationaliste » –, apparaît clairement dans les musées d’histoire dans lesquels le récit, bien qu’adouci au cours des dernières décennies, suit un schéma identique. Tout en s’adaptant aux spécificités de chaque pays, il décrit ainsi : la grandeur originelle, une ou plusieurs chutes, suivies des rédemptions nécessaires, tout en minimisant les éléments perturbateurs. Pour prendre à nouveau l’exemple de la France, en regroupant les données des musées traitant de la violence en Europe au XXe siècle, nous avons constaté que ceux consacrés à la Seconde Guerre mondiale tendent à mettre l’accent bien davantage sur la défaite militaire, la résistance, la déportation, puis la libération du pays que sur la collaboration avec l’ennemi ou la persécution des minorités (digitalcollections.trentu.ca)6. C’est le cas du musée de l’Armée, situé à Paris, dans l’hôtel des Invalides (www.musee-armee.fr), où l’on constate que Vichy n’a guère sa place. La seule photo existante du maréchal Pétain le montre de dos. En outre, aucun espace n’est consacré aux crimes commis par la France durant la période coloniale. La conquête de l’Afrique, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, est qualifiée de « pacification ». Les guerres du Viêt Nam (1945-1954) et d’Algérie (1954-1962) n’apparaissent pas non plus. Les massacres de Guelma et de Sétif, en 1945, ou de Madagascar, en 1947-1948, sont bien sûr également passés sous silence. En fin de compte, seule la souffrance ou la gloire de la patrie méritent d’être racontées, mais pas l’expérience réelle du peuple.
Cette gêne ou ces aspects gênants inhérents aux récits des guerres internationales et coloniales deviennent encore plus aigus dans les cas de conflits internes. C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner que les musées consacrés aux guerres civiles soient si peu nombreux. Cela n’a rien à voir avec le nombre d’artefacts et d’éléments qui, dans les musées militaires, leur sont liés : nous parlons bien ici de l’absence de récit, pas de références ponctuelles. Ceux qui visitent le musée de l’Armée de Tolède (www.ejercito.defensa.gob.es) ou d’autres musées militaires verront effectivement des choses sur la guerre civile, mais ne comprendront ni les raisons du conflit ni son impact sur la population. Il ne s’agit pas d’un cas isolé et l’Espagne n’est pas une exception. En fait, sur le territoire européen, seule l’Irlande présente des musées – ou des sections importantes de ceux-ci (www.museum.ie) – qui se consacrent exclusivement à ce sujet et le traitent avec clarté. Mais la guerre civile irlandaise fut un conflit relativement mineur et limité dans le temps – de juin 1922 à mai 1923 – qui, bien que toutes sortes d’atrocités communes aux guerres civiles aient été commises, a occasionné un nombre assez faible de victimes – moins de 2 000 ; et, ce qui est peut-être encore plus important, un conflit dans lequel les deux camps poursuivaient, avec des méthodes et un rythme certes différents, le même objectif : l’indépendance de l’Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni. Les conflits internes finlandais, grec, espagnol et yougoslave ont été beaucoup plus meurtriers et fondés sur des projets sociopolitiques profondément antagonistes. Et que dire de la guerre civile russe, qui est à la fois le plus important conflit interne européen du XXe siècle et le plus absent des musées ?!
Outre la distinction susmentionnée entre histoire et mémoire, ayant pour objectif de bâtir un discours sur la guerre civile qui soit plus fédérateur, nous nous sommes appuyés sur deux principes : démocratie et humanisme. Pour être plus précis, en analysant et en expliquant le conflit, nous avons su dès le départ, et de façon certaine, qu’il y avait des antidémocrates dans les deux camps, mais des démocrates dans un seul d’entre eux. En d’autres termes, la légalité et la légitimité étaient représentées par la République, mais beaucoup de ceux qui ont combattu à ses côtés, commettant des crimes et des atrocités, n’aimaient pas le régime et envisageaient de le changer dès qu’ils le pourraient. D’autre part, nous affirmons clairement que le camp des rebelles était illégitime et que ceux qui le servirent ont soutenu, volontairement ou non, un modèle autoritaire et sanguinaire, qui a fini par prendre la forme de la dictature franquiste (1939-1975). Quant à l’humanisme, les auteurs-conservateurs de ce musée considèrent qu’il n’est pas possible d’établir des catégories entre les victimes, entre leurs douleurs ou entre celles de leurs proches. Une autre chose est d’expliquer comment ou pourquoi ces personnes sont mortes. Cette approche s’inscrit dans une tendance internationale montante, dans le monde de l’après-Guerre froide, consistant à accorder la plus grande attention à la victime, sans tenir compte de son idéologie ou de son statut social, celle-ci étant considérée comme un être humain à qui l’on a dénié le principe premier du droit : celui de pouvoir se maintenir en vie.
Enfin, il reste à souligner la nécessité, inévitable dans le monde post-colonial, de relier les phénomènes violents qui eurent lieu sur le sol européen à ceux dont se sont rendus coupables les pays de ce même continent dans leurs colonies respectives et dans le Sud global. Nous qui avons créé ce musée comprenons que la violence sociale, politique ou ethnique en Europe n’est qu’une manifestation de la violence mondiale. Lorsque nous voyons, par exemple, des images de la guerre d’Espagne, de la Seconde Guerre mondiale ou de l’Holocauste, il est nécessaire de se rappeler que cette violence a été pratiquée par les Européens avant et après ces conflits, dans d’autres lieux et contre d’autres personnes. L’Europe démocratique, honteuse des images des camps de concentration, était encore, en 1945, un continent colonial qui tentait de conserver ses possessions par la force, ayant souvent recours à des massacres à grande échelle, et qui, jusque longtemps après, continua à pratiquer des politiques néo-impérialistes aux conséquences souvent funestes pour les populations indigènes concernées. En d’autres termes, la violence de la guerre civile, au même titre que celle du reste de l’Europe, n’a pas été exceptionnelle, et les souffrances des Espagnols et des Européens n’ont été ni exclusives ni particulières. À la suite des études réalisées pour ce musée, un constat s’impose : celui d’une absence presque totale, en Espagne et dans d’autres pays, de récit concernant le passé colonial violent. Par exemple, il n’existe pas en Espagne d’histoire publique des colonies, de même qu’en France, de ses guerres coloniales, mais on pourrait en dire autant de l’Italie ou de la Hollande.
Pourquoi appelons-nous ce projet numérique un musée ? Le concept suivi lors du développement du projet ressemble davantage à celui d’un musée qu’à celui, par exemple, d’un site web ou d’un manuel virtuel. Ses différents thèmes, conçus tels des « salles » ou des « galeries », sont basés sur des objets et non sur des discours fermés – comme ils le seraient dans les deux autres cas mentionnés, le visiteur se voyant alors délivrer une vision achevée, prétendant épuiser la question. Au contraire, notre projet est en construction permanente, car des objets peuvent être ajoutés ou retirés en fonction de leur capacité à attirer, intéresser et informer le visiteur. Il est important pour nous que celui-ci puisse se déplacer entre les « salles » selon ses préférences, sans pour autant perdre un supposé fil narratif, qui exige une attention permanente et sans lequel il se sentirait perdu. Notre priorité est, plutôt que de lui faire acquérir une connaissance exhaustive du conflit, que le visiteur se sente attiré par le sujet et se surprenne à découvrir l’histoire qui se cache derrière chaque objet. C’est le grand public qui nous intéresse et nous sommes conscients que, pour qu’il visite et revisite notre musée, il est essentiel qu’il le trouve pratique, facile d’accès et intéressant.
Cela signifie-t-il que notre musée manque de narration ? Non, bien au contraire. Nous pensons que l’approche que nous avons de chaque objet guide le visiteur vers une série de conclusions qui dépassent l’aspect purement informatif ou anecdotique. Il s’agit de montrer le passé, mais aussi le pourquoi de ce passé et ses conséquences. De cette manière, et malgré un manque apparent de systématisation, le musée se prête très bien à une utilisation pédagogique, chaque objet pouvant être le point de départ de l’exploration d’un thème.
En tant qu’auteurs du musée virtuel de la guerre d’Espagne, nous considérons que notre modèle présente les inconvénients souvent signalés à propos de toute production en ligne, à commencer par son caractère éphémère et sa relative invisibilité dans un monde numérique surpeuplé, dans lequel il n’est pas toujours aisé de distinguer le bon grain de l’ivraie. Nous sommes également conscients qu’un musée numérique a un impact public plus réduit qu’un musée physique, surtout s’il s’agit d’un hypothétique grand musée d’État sur la guerre civile espagnole. Enfin, notre musée numérique n’aspire pas à devenir – car il ne le pourra jamais – ce centre de référence et d’autorité qui contribuerait à nourrir, voire à arbitrer des polémiques qui sont le plus souvent stériles et, de l’opinion de la plupart des historiens, inexactes, lancées régulièrement par des politiciens et des médias qui se caractérisent par leur manque de scrupules ou, tout simplement, de connaissances historiques7.
En même temps, nous pensons que ce musée numérique présente de nombreux avantages par rapport à un musée physique. Le premier, être accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, de n’importe où dans le monde et gratuitement. Le deuxième a une double conséquence : son faible coût de création lui permet d’éviter les influences et les interférences des acteurs politiques, des donateurs ainsi que des institutions et, par conséquent, de satisfaire aux seules intentions de ses créateurs – un groupe d’historiens, d’archéologues et de spécialistes des études culturelles, des archives ainsi que des musées –, dont l’unique objectif est de mettre à la disposition du grand public les connaissances les plus récentes sur le passé tel qu’ils le perçoivent, avec tous les doutes, les contradictions et les controverses que celui-ci génère. Le dernier avantage est que nous ne dépendons ni du pouvoir, ni des intérêts partisans, ni de la nation – ou de ceux qui disent la représenter. En ce sens, les musées numériques peuvent être – et nous pensons que cela s’applique au nôtre – un outil très utile pour échapper au paradigme national-nationaliste qui régit encore la plupart des musées d’histoire, dans le monde entier et, cela va de soi, en Europe. Nous expliquerons ce fait plus en détail ci-après.
Par paradigme national, nous entendons la tendance des musées physiques à limiter leur discours aux événements qui se sont produits à l’intérieur des frontières de l’État, en négligeant largement – voire, dans certains cas, complètement – les relations transnationales, les contextes élargis et même les actions perpétrées par le pays concerné contre d’autres nations et d’autres peuples. Ce faisant, l’expérience nationale devient unique et exceptionnelle, au sens flatteur du terme, ce qui embrasse ses réalisations supposées uniques jusqu’à sa victimisation de la part d’un ennemi extérieur. Cette limitation au national conduit presque automatiquement au nationalisme. Déconnectée du monde, du moins pour ce qui l’arrange, l’expérience nationale renforce l’idée d’une communauté distincte, la nation, dotée d’un caractère supérieur – ou, en tout cas, enviable –, si on le compare à celui des autres nations. Le discours devient une lecture à la fois déformée et uniformisante – effectuée à travers le prisme de la nation – d’une réalité sociale, politique et économique complexe. Le « nous » national remplace l’individu, les groupes subalternes, les positions dissidentes ou les projets plus ou moins ratés, qui n’ont pu être contrôlés par les structures de l’État. Ce « nous » intègre les gloires supposées de la nation dans le passé – même avant qu’elle existe en tant que telle – comme une source de fierté et, par la même occasion, exclut ou sous-évalue les aspects négatifs de ce passé. Aucun État – à l’exception notable de l’Allemagne, ces dernières années, à propos de la période nazie – ne s’est distingué en finançant des projets d’histoire publique – et encore moins des musées – qui rompent avec ce paradigme national-nationaliste, poursuivant ainsi le travail d’exaltation sélective de ce qui est supposé être le meilleur de l’histoire nationale. L’absence quasi générale du colonialisme dans les musées d’histoire européens, évoquée plus haut, en constitue le meilleur exemple.
Les quelques musées d’histoire espagnols souffrent de ce problème qui, dans le cas de la guerre civile, est exacerbé par la difficulté de présenter un conflit interne, c’est-à-dire antinational – comme cela a déjà été décrit. En d’autres termes, les musées espagnols qui, d’une manière ou d’une autre, parfois à contrecœur, doivent traiter de la guerre civile, comme cela semble être le cas des musées d’histoire militaire, le font par le biais du non-discours, c’est-à-dire en empilant des objets sans leur donner une interprétation contextualisée. Ils manquent d’une narration claire. Le point culminant de ce non-discours est probablement atteint par le musée de l’Armée, situé dans l’Alcazar de Tolède, ancien site de mémoire franquiste. Là, le bureau du colonel Moscardó – qui était au centre du discours narratif de la dictature sur les souffrances vécues lors du siège de l’Alcazar et la victoire sur l’ennemi républicain – est resté intact, plein des dégâts causés par les éclats d’obus, mais sans explication, et ce, à côté des salles du musée moderne dans lesquelles il n’y a évidemment aucune référence aux atrocités coloniales commises par l’Espagne au Maroc ni à l’utilisation de gaz contre les indigènes rifains. Pour ce qui est des musées civils comme l’Association mémorielle des lieux de la bataille de l’Èbre (COMEBE, pour son sigle en espagnol) ou le Centre documentaire de la mémoire historique de Salamanque (CDMH, d’après son sigle en espagnol), soit le discours est absent – c’est le cas dans le dernier nommé –, soit il est centré sur la souffrance des soldats et sur la promotion de la paix, comme dans la quasi-totalité de ce type de lieux. Ces deux thèmes sont certes très louables, mais ils simplifient grandement la réalité de la guerre et évacuent les aspects les moins réconfortants, tels que les causes du conflit ou la répression dans les territoires occupés.
Notre musée virtuel a l’intention de présenter un discours clair sur la guerre, qui n’exclut pas les questions controversées ou, comme nous le disions, « difficiles » ; cet aspect n’a pu, jusqu’à présent, être réalisé que de façon limitée dans les « salles » déjà ouvertes au public, dont nous parlerons plus tard. Il s’agit, outre sa fonction didactique, de l’un de ses objectifs fondamentaux. Nous pensons qu’il est important que le grand public ait accès à toutes les conclusions auxquelles les historiens sont parvenus ces dernières années, qu’elles plaisent ou non. C’est l’avantage de ne pas dépendre de l’argent public ou de grands donateurs privés. En même temps, et comme nous l’expliquerons plus loin, nous voulons rassembler dans notre exposition permanente les expériences des gens, avec la plus grande diversité possible, relatées via des témoignages oraux. C’est une chose qu’un musée conventionnel ne peut pas faire aisément, et certainement pas avec l’« immédiateté » que nous serons en mesure d’offrir. De cette manière, nous tenterons de présenter au visiteur du musée, de la façon la plus directe possible, la complexité et les contradictions révélées par les témoignages de ceux qui ont souffert du conflit. Tel est, en fin de compte, le message de notre musée virtuel : raconter le passé tel que les gens l’ont vécu en situant leurs expériences au sein d’un récit général, conçu par des professionnels. Il n’y a pas de meilleure approche du passé que de dire la vérité avec honnêteté, en incluant dans cette narration la vision des différents protagonistes.
Parlons maintenant de la manière dont nous pensons agrandir et approfondir notre musée virtuel, tout en rendant son discours plus intelligible.
Le musée aujourd’hui et demain
Une fois les défis techniques cernés et les principes théoriques du projet définis, l’étape suivante consistait à rechercher les moyens de le financer. Cela n’a pas été facile. Il s’agissait notamment d’obtenir que le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) soutienne un projet numérique concernant un pays étranger. La formule choisie a été de solliciter les dénommés Partnership Development Grants (subventions pour le développement de partenariats), qui est un canal de financement extraordinairement complexe. Au prix de nombreux efforts, nous avons quand même réussi à poser notre candidature à deux reprises, qui a été à chaque fois refusée, une fois pour un dixième de point seulement. Nos efforts n’ont cependant pas été vains. L’une des conditions pour participer à ce programme était d’avoir des partenaires s’engageant à fournir une contribution en nature d’un montant équivalent à celui que le CRSH apporte en espèces. Bien que nous n’ayons pas remporté les projets, nous avons néanmoins réussi à signer des accords avec plusieurs institutions, qui se révélèrent par la suite très utiles pour demander d’autres subventions ainsi que pour obtenir gratuitement du matériel qui, plus tard, fut incorporé au musée virtuel. Notre équipe a ainsi établi des relations formelles avec l’Université York, les universités de Trent, au Canada, et de Warwick, au Royaume-Uni, avec le Memorial Democràtic de Barcelone, les Archives générales de l’administration espagnole et le Centre documentaire de la mémoire historique de Salamanque. Mais le principal obstacle restait l’argent.
En 2020, nous avons finalement obtenu, pour commencer la construction du musée, une bourse d’un montant de 25 000 euros émanant du CRSH, dans sa modalité « Connexion Grant », le titre du projet étant : « La confrontation avec un passé controversé : la guerre civile espagnole virtuelle ». À ce moment-là, nous avions inclus dans le projet deux autres personnes, clés sur le plan technique : Andrea Davis, de l’université d’État de l’Arkansas, experte en sciences humaines numériques, et Dwayne Collins, bibliothécaire à l’université de Trent, également spécialiste de ce domaine. Rappelons que le financement est intervenu quelques jours avant la déclaration du Covid en tant que pandémie. Au cours des deux années qui suivirent, nous avons souvent travaillé avec nos universités fermées, c’est-à-dire – et c’était pour nous tout à fait approprié – sous forme numérique. Un autre membre de l’équipe ayant joué un rôle essentiel est Sofía Rodríguez, qui fut chargée de trouver les images et d’obtenir les autorisations pour les reproduire dans notre musée. Ce fut sans aucun doute l’aspect le plus difficile, bien que la collaboration du Centre documentaire de la mémoire historique de Salamanque, des Archives générales de l’administration espagnole et de la Bibliothèque nationale espagnole ait été fondamentale pour l’obtention gratuite de nombreux documents visuels. Les autres membres de l’équipe ont été impliqués non seulement dans la coordination (rôle principalement joué par Adrian Shubert et Antonio Cazorla), mais aussi dans la recherche d’images, ayant souvent recours à celles que nous possédions déjà, et, bien sûr, dans la rédaction des textes des quelque 130 entrées. La dernière étape a été la conception graphique du musée. Pour cela, nous avons sollicité une société privée, dont les honoraires ont été payés grâce à une contribution de 1 500 euros émanant de l’ambassade d’Espagne à Ottawa. Après quelques moments de panique de dernière minute, comme cela a été dit au début de cet article, nous avons pu inaugurer le musée le 15 septembre 2022. L’université de Trent a organisé une réception à laquelle ont assisté, outre la majorité des membres de l’équipe, l’ambassadeur d’Espagne et le recteur de l’université. Enfin, les descendants du bataillon canadien des Brigades internationales, les Mackenzie-Papineau (« Mac-Pap »), nous ont offert des fonds pour poursuivre le projet.
Le résultat de cette première phase du musée est maintenant disponible pour les visiteurs. Elle se compose de cinq galeries ou « salles », dédiées aux thèmes suivants : le début du conflit et son évolution, le contexte international, derrière le front, la vie quotidienne au front et, enfin, la mémoire historique. Tous les textes sont bilingues, anglais et espagnol, et nous travaillons actuellement sur les versions française et catalane. L’accueil de la part du public et des collègues a été franchement bon, mais il a été accompagné de critiques que nous approuvons dans leur majorité, car elles correspondent à des aspects que nous souhaitons développer et qui, par manque de temps et de ressources, n’ont pu l’être. On nous a fait remarquer que nous ne parlions ni des causes ni des origines du conflit. Ce point n’est pas seulement justifié, il est en contradiction flagrante avec les postulats théoriques du projet. Pour combler cette lacune importante, nous avons chargé une équipe de trois historiens espagnols – beaucoup plus jeunes que la plupart de ceux qui ont collaboré jusque-là – de développer cette « salle », qui devrait être ouverte lors de la deuxième phase du projet. Il a également été souligné que le musée se termine pratiquement avec la victoire de Franco, le 1er avril 1939. Là encore, nous avons chargé un groupe de jeunes historiens d’élaborer le contenu d’une nouvelle galerie, dédiée aux conséquences du conflit. D’autres collègues ont fait remarquer que la section « Mémoire historique » était trop succincte ; nous travaillons déjà à son ampliation et il en va de même pour la galerie consacrée aux aspects internationaux. Enfin, un professeur a pointé le manque de documents audiovisuels. Il s’agit là d’une question très compliquée, pour des raisons de droits d’auteur, de lieux de dépôt et de conditions de reproduction. En tout état de cause, un spécialiste reconnu créera cette ressource.
Outre les thèmes susmentionnés, nous travaillons à la conception de nouvelles galeries et ressources. Pour comprendre ce dont il s’agit, il faut expliquer que nous concevons le musée comme un projet à trois niveaux. Le premier, le plus important, que nous avons développé jusqu’à présent, est la diffusion. Les galeries déjà réalisées et celles en cours d’élaboration en font partie. Il comprendra également une série de cartes, dont certaines interactives, une galerie sur l’expérience des combattants, une sur l’impact qu’eut la guerre d’Espagne sur les différents pays du monde – avec 23 pays déjà abordés –, une sur l’art sous la guerre civile et, enfin, une que nous avons nommée « galerie ouverte » et dont nous reparlerons un peu plus tard. Le deuxième niveau du projet est celui de la pédagogie : nous avons déjà demandé à un collègue de créer une galerie ou une section de ressources destinée aux écoles et aux universités. Le troisième et dernier niveau, enfin, concerne les moyens consacrés à la recherche. En principe, Jesús Espinosa sera responsable de cette section. L’idée est d’établir des liens avec d’autres musées et groupes d’investigations, ainsi qu’avec les bases de données les plus importantes, tant en Espagne qu’à l’étranger, afin que les chercheurs et le public plus spécialisé ou intéressé par ces sujets puissent accéder aux sources primaires d’information. Dans cette dernière section, nous signalons que nous allons inclure l’accès à des centaines d’entretiens oraux, pour la plupart enregistrés sur vidéo et sous-titrés en plusieurs langues, comprenant des témoignages sur la guerre et l’après-guerre. Enfin, notre intention est que l’ensemble du musée soit disponible dans les langues parlées dans l’État espagnol. Nous recherchons en ce moment le financement pour réaliser ce souhait.
Il reste à parler de la « galerie ouverte ». L’idée nous été donnée par une initiative du gouvernement français, datant de 2014, prise dans le cadre des commémorations la Première Guerre mondiale, appelée « La grande collecte de la Grande Guerre » (www.culture.gouv.fr). Il s’agissait d’un appel lancé aux Français pour qu’ils partagent leurs archives familiales et les rendent publiques. Avec cette « galerie ouverte », notre dessein est similaire : solliciter les individus afin que, par l’intermédiaire du musée numérique, ils mettent à disposition leur histoire ainsi que les artefacts de la guerre civile en leur possession. Pour tout dire, cette galerie a démarré spontanément. Lorsque les médias et les réseaux sociaux ont parlé de notre musée, plusieurs personnes nous ont contactés pour nous proposer des objets, des documents et des histoires qu’elles souhaitaient partager. La même chose s’est produite lors de nos visites sur le terrain, au cours des mois précédents, ou lors de la présentation de notre dernier livre8 – qui est pourtant un projet indépendant du musée. Il est surprenant de constater le nombre d’objets que les Espagnols – et certains étrangers – conservent chez eux et dont, jusqu’à présent, ils ne savaient pas quoi faire !
L’équipe, actuellement élargie à plusieurs nouveaux collaborateurs, est en train de préparer la deuxième phase du musée. Il nous reste encore un peu d’argent de l’étape précédente. L’association des descendants des Canadiens ayant combattu dans les Brigades internationales, par le biais du Fonds commémoratif du bataillon Mackenzie-Papineau, nous a offert tout le soutien dont nous avions besoin. L’université de Trent s’est également engagée à mettre davantage de ressources à notre disposition. L’aventure continue.
Notes
1
Adrian Shubert, Antonio Cazorla Sánchez et Joan Maria Thomàs, “Un nuevo museo virtual para todos sobre la Guerra Civil” (« Un nouveau musée virtuel sur la guerre d’Espagne, qui s’adresse à tous »), El País, 11 octobre 2022 (consulté le 28 novembre 2023) ; Sam Jones, “Virtual Spanish civil war museum aims to cut through political divide” (« Le nouveau musée virtuel sur la guerre civile espagnole entend surmonter les clivages politiques »), The Guardian, 10 octobre 2022 (consulté le 28 novembre 2023).
2
Antonio Cazorla Sánchez, Alison Ribeiro de Menezes y Adrian Shubert (dir.), Public Humanities and the Spanish Civil War: Memory and the Digital in Contested Histories (« Les sciences humaines publiques et la guerre civile espagnole : la mémoire et le numérique dans l’histoire controversée », non traduit), Londres, Royaume-Uni, Palgrave Macmillan, 2018.
3
Selon le Conseil national de l’histoire publique des États-Unis (NCPH, d’après son sigle en anglais), l’histoire publique est « un mouvement, une méthodologie et une approche qui promeuvent une recherche historique collaborative et pratique ; ses acteurs endossent la mission de rendre leurs connaissances spécifiques accessibles et utiles au public », in Robert Weible, “Defining Public History: Is it Possible? Is it Necessary?” (« Définir l’histoire publique, est-ce possible ? C’est nécessaire »), Perspectives on History, 1er mars 2008. Voir également : Paula Hamilton et James Gardner (dir.), The Oxford Handbook of Public History (« Le Manuel oxfordien de l’histoire publique », non traduit), New York, États-Unis, Oxford University Press, 2017 ; Paul Ashton et Alex Trapeznik (dir.), What Is Public History Globally? Working with the Past in the Present (« Qu’est-ce que l’histoire publique mondiale ? Travailler dans le présent avec le passé », non traduit), Londres, Royaume-Uni, Bloomsbury, 2019.
4
Cette construction ne se fait pas sans controverses. Voir : Peio H. Riaño, “Un memorial en el Museo de la Guerra Civil que no distingue entre víctimas: ‘La fuerza es no ahondar en las diferencias’” (« Au sein du musée de la guerre d’Espagne, un mémorial qui ne fait pas de distinction entre les victimes : “Le courage consiste à ne pas creuser les clivages” »), El Diario.es, 3 février 2023 ; Andrés Bartolomé, “La licencia y el debate de ideas retrasan el primer museo de la Guerra Civil con vocación nacional” (« Les autorisations administratives et le débat d’idées retardent le projet de premier musée de la guerre d’Espagne à vocation nationale »), La Razón, 16 avril 2023. Le gouvernement de droite, élu en mai dernier, annonce qu’il va abolir la loi de Mémoire démocratique, ce qui a provoqué une réaction collective de la part des professeurs de l’université de Saragosse (El Diario.es/Aragón) : “Los profesores de Historia de la Universidad de Zaragoza solicitan que no se derogue la Ley de memoria democrática de Aragón” (« Les professeurs d’histoire de l’université de Saragosse demandent que ne soit pas abolie la loi de Mémoire démocratique en Aragon »), El Diario.es, 20 septembre 2023 (consulté le 28 novembre 2023).
5
Voir, à ce propos : Julia Rose, Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites (« L’Interprétation de l’histoire controversée dans les musées et les sites historiques », non traduit), Lanham, États-Unis, Rowman & Littlefield, 2016.
6
C’est cette constatation qui a motivé la création du musée virtuel Belgium World War II.
7
Entre le 15 septembre 2022 et le 26 septembre 2023, quasi 58 000 personnes, originaires de plus de 100 pays, ont visité le musée virtuel. Parmi elles, 35 000 l’ont fait depuis l’Espagne. Pour le seul mois de septembre 2023, les 2 010 personnes qui ont accédé au site se répartissent, en fonction de leur lieu de consultation, de la façon suivante : 956 d’Espagne, 280 des États-Unis, 214 du Royaume-Uni, 109 du Canada, 38 de France, 36 d’Allemagne, 35 d’Argentine, 24 d’Irlande et 22 d’Australie.
8
Antonio Cazorla Sánchez y Adrian Shubert (dir.), La Guerra Civil española en 100 objetos, imágenes y lugares (« La guerre civile espagnole en 100 objets, images et lieux », non traduit), Madrid, Espagne, Galaxia Gutenberg, 2022.
Bibliographie
Paul Ashton et Alex Trapeznik (dir.), What Is Public History Globally ? Working with the Past in the Present (« Qu’est-ce que l’histoire publique mondiale ? Travailler dans le présent avec le passé », non traduit), Londres, Bloomsbury, 2019.
Antonio Cazorla-Sánchez, Alison Ribeiro de Menezes et Adrian Shubert (dir.), Public Humanities and the Spanish Civil War : Memory and the Digital in Contested Histories (« Les sciences humaines publiques et la guerre civile espagnole : la mémoire et le numérique dans l’histoire controversée », non traduit), Londres, Palgrave Macmillan, 2018.
Antonio Cazorla Sánchez et Adrian Shubert (dir.), La Guerra Civil española en 100 objetos, imágenes y lugares (« La guerre civile espagnole en 100 objets, images et lieux », non traduit), Madrid, Galaxia Gutenberg, 2022.
Paula Hamilton et James Gardner (dir.), The Oxford Handbook of Public History (« Le Manuel oxfordien de l’histoire publique », non traduit), New York, Oxford University Press, 2017.
Julia Rose, Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites (« L’Interprétation de l’histoire controversée dans les musées et les sites historiques », non traduit), Lanham, Rowman & Littlefield, 2016.
Robert Weible, “Defining Public History : Is it Possible ? Is it Necessary ?” (« Définir l’histoire publique, est-ce possible ? C’est nécessaire »), Perspectives on History, 1er mars 2008. URL :