(Emory University - Atlanta)
L’ouvrage collectif New World Orderings : China and the Global South, publié sous la direction du sinologue Carlos Rojas et de l’anthropologue Lisa Rofel, éclaire, à travers douze chapitres multidisciplinaires, un processus central de notre époque : les « nouveaux ordres mondiaux » – également appelés worldmaking, selon une métaphore en vogue dans les études littéraires et l’histoire des idées –, produits par l’interaction entre la « Chine », acteur de plus en plus décisif, et le « Sud global ». Les guillemets sont intentionnels, pour souligner que le livre aborde trois sujets importants, dont deux sont explicites : la pluralité des acteurs et des pouvoirs cachée sous le mot Chine ainsi que la pluralité des mondes créés par son influence, et un troisième, implicite : la notion de Sud global. Mais donnons d’abord quelques clés pour la lecture de cet ouvrage riche et stimulant.
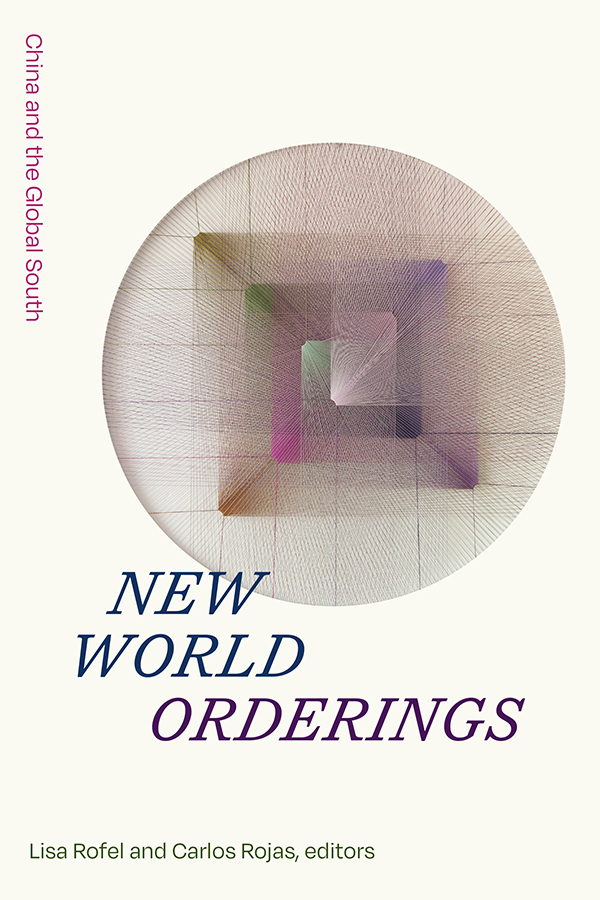
Lisa Rofel y Carlos Rojas (dir.), New World Orderings: China and the Global South, Sinotheory, Durham, Duke University Press, 2023.
En premier lieu, précisons qu’un sujet aussi vaste – la Chine et la transformation de la majeure partie du monde – requiert un large éventail de disciplines et d’approches. Le livre fait principalement appel à la littérature et à l’anthropologie, mais également à la sociologie, aux relations internationales et au cinéma, avec des références permanentes à l’histoire, aux migrations et à l’économie. Ses douze chapitres se divisent en trois parties : géopolitique et discours, travail et échanges, mobilité et déplacements, qui s’interpénètrent constamment pour produire un dialogue riche en perspectives. La diversité des approches est autant thématique – histoire et langue, relations internationales et littérature, migrations et économie, genre et politique, racisme, « racialisation » et cinéma – que géographique – Afrique, Amérique latine et Asie du Sud-Est –, de la part d’auteurs travaillant dans des espaces académiques divers : États-Unis, Chine, Taïwan et Argentine. Cette ambition multidisciplinaire, qui rend compte de l’interaction matérielle, spatiale et culturelle de la Chine avec le reste du monde, est un exemple précieux pour tout travail d’enquête sur la mondialisation, qu’elle soit passée ou présente.
Quant au nouvel « ordre » international, étudié ici sous l’influence économique, diplomatique, démographique et culturelle d’une Chine en devenir, il convient de préciser qu’il n’apparaît ni comme une symphonie ni comme un chaos. L’impression générale est celle d’une transformation à l’issue incertaine, portée par une multiplicité d’acteurs et de marchés sur des échelles très variées ; comme l’indique l’éditeur dans son introduction, cette transformation est le fruit de trois temporalités successives et sédimentées. La première, depuis plusieurs siècles, est celle de l’interaction de la Chine avec ses voisins ainsi qu’avec d’autres régions du monde dans les domaines du commerce et des migrations – et, corollairement, des identités et des littératures. La deuxième temporalité est celle de l’internationalisme communiste chinois – celui de la base, puis celui de l’État – qui, depuis la moitié du XXe siècle, a façonné les relations internationales, l’économie, la politique éditoriale, la politique de la langue et les imaginaires idéologiques. La troisième, enfin, est celle de la mondialisation économique, culturelle et géopolitique qui, depuis les réformes entamées en 1978, fait à nouveau évoluer les liens entre la Chine et le reste du monde, notamment au cours du XXIe siècle. Ces trois temporalités nous invitent à reconsidérer le vertige créé par les changements actuels à partir d’histoires plus longues qui, d’une part, expliquent ces changements et, d’autre part, puisent en eux une nouvelle signification.
L’ouvrage s’intéresse aux relations qu’entretient la Chine autant avec l’Amérique latine qu’avec l’Asie et l’Afrique. Mais, contrairement à ces deux derniers, le continent latino-américain fait l’objet d’un chapitre spécifique, traitant de ses relations économiques et géopolitiques avec la Chine et ce, à travers l’étude du « Consensus de Pékin » qui, au XXIe siècle, s’est édifié sur les vestiges de celui, autrefois hégémonique, établi avec Washington. Parmi les nombreux arguments et observations formulés par Luciano Bolinaga dans ce chapitre, il convient de noter que, contrairement à l’Asie du Sud-Est, région avec laquelle la Chine entretient des relations plurilatérales, la stratégie régionale de celle-ci à l’égard de l’Amérique latine est basée sur le bilatéralisme : elle interagit et négocie de manière indépendante avec chaque pays du continent. Ces relations, aussi pacifiques – elles ne sont accompagnées d’aucune alliance militaire – qu’asymétriques – dans chaque cas, la Chine est en position dominante –, reposent sur trois piliers : reconnaissance de ses aspirations sur Taïwan, investissements dans les infrastructures et importations de produits agricoles. D’autre part, les pays latino-américains ont, à l’égard de la Chine, des stratégies individuelles et non collectives, phénomène qui met en évidence la nécessité d’une cohérence au niveau du continent, non pas en tant que simple slogan, mais comme une réponse résolument pratique aux « nouveaux ordres » mondiaux.
Le seul pays latino-américain traité à part – deux chapitres lui sont consacrés – est l’Argentine, qui est ici producteur-exportateur de soja vers la Chine et cible d’investissements chinois dans les infrastructures, en particulier Buenos Aires. La capitale argentine, destination migratoire, est en même temps productrice d’un discours littéraire et cinématographique sur la Chine, vue comme un autre imaginaire. Partant de la situation paradoxale d’une influence économique chinoise en Argentine bien plus puissante que ne le sont les interactions entre les deux peuples, Rachel Cypher et Lisa Rofel font état d’une série de rencontres, réelles et imaginées, entre Chinois et Argentins, et ce, dans des contextes variés tels que les plantations de soja de la pampa, les négociations syndicales dans l’industrie pétrolière, les organisations commerciales, le commerce de quartier à Buenos Aires et, enfin, le cinéma (voir, à ce propos, Un cuento chino, un film de Sebastián Borenzstein de 2011). Le chapitre d’Andrea Bachner traite des romans d’Ariel Magnus et de César Aira ainsi que de certains films : celui susmentionné et Happy Together, du réalisateur taïwanais Wong Kar-wai, également tourné à Buenos Aires, qui traite d’un élément fondamental des relations – réelles et imaginaires – entre l’Argentine et la Chine : le travail. Andrea Bachner suggère que cette production littéraire et cinématographique considère – d’une façon fantasmatique et, souvent, ethnocentrique – le travail comme un « pivot » des relations entre la Chine et l’Argentine. Le travail qui se cache derrière les biens de consommation et la production agricole reste invisible. Ainsi, la critique culturelle soulève une question qui touche à la politique et aux relations internationales, de même qu’elle invite les futures études sur les relations entre Chine et Amérique latine à articuler ces dimensions entre elles : travail, économie, géopolitique, migration et culture.
En ce sens, le livre s’inscrit dans la lignée de travaux traitant de l’influence de la Chine sur le reste du monde. Parmi tous ceux qui existent, je n’en mentionnerai que trois, parce qu’ils sont importants pour mon travail d’historien de l’Amérique latine. Dans le domaine de l’histoire des idées, Martín Bergel avait déjà signalé la Chine, au sein de l’Orient en général, comme déterminante dans l’imaginaire tiers-mondiste argentin et latino-américain. Pour ce qui est de la critique littéraire et culturelle, Laura Torres-Rodríguez a étudié la façon dont le « spectre » de la Chine – et de l’Asie en général – vient corriger l’orientation transatlantique traditionnelle des études sur la modernité mexicaine. Quant à la sociologie culturelle, Claudio Benzecry a récemment produit une ethnographie générale du dessin et de la création au sein de l’industrie de la chaussure, dans laquelle la Chine constitue un élément d’un vaste réseau – comprenant Seattle, New York, Milan et la ville de Novo Hamburgo, dans le sud du Brésil – au sein duquel circulent les employés, les investisseurs, les capitaux, les conceptions et, bien sûr, les chaussures elles-mêmes1.
L’argumentaire atour duquel s’organise New World Orderings est précisément que seules des approches analytiques diversifiées peuvent permettre de comprendre les « nouveaux ordonnancements » que créent ces multiples « Chines » par leurs interactions avec le Sud global, dans toutes leurs dimensions : de la géopolitique au marché du travail et des migrations aux productions artistiques. Abordons donc ces trois idées clés.
La Chine apparaît dans ce livre sous de nombreuses formes. Elle est à la fois un acteur géopolitique (Bolinaga), un générateur de migrations (vers la Malaisie, l’Afrique du Sud, la Tanzanie ou l’Argentine) et, à l’inverse, une destination migratoire pour des petits commerçants venant d’Afrique, dont beaucoup sont des femmes (cf. l’excellent chapitre de T. Tu Huynh) ; elle est enfin un « archipel » de circulation romanesque (voir l’étude de Ng Kim Chew) et une communauté linguistique transnationale, ancrée dans une tradition commune d’écriture idéographique et marquée par des exils ainsi que des migrations qui inversent parfois les concepts d’« origine » (homeland) et de « diaspora » (consulter, à ce titre, le chapitre éclairant de Carlos Rojas). Ces multiples Chines sont à l’origine de la « création de nouveaux mondes », dans des domaines divers : littéraire, en premier lieu, via un « écosystème » de publications et d’auteurs en langue chinoise qui intègre de nombreux pays – remettant en question la vision euro/anglo-centrée de la littérature mondiale et du marché planétaire du livre ; de « nouveaux mondes » dans le domaine commercial, tels que les boutiques chinoises de quartier à Buenos Aires et les zones commerciales d’Afrique du Sud ; de « nouveaux mondes » géopolitiques, qui offrent des opportunités inédites d’intégration dans l’économie mondiale, dérivées des accord passés entre Washington et Pékin ; de « nouveaux mondes » économico-spirituels pour les migrants ouest-africains de Canton, qui mettent en pratique les doctrines chrétiennes de la prospérité ; et, enfin, de « nouveaux mondes » linguistico-identitaires parmi les populations de langue chinoise, en Malaisie et à Singapour.
L’introduction définit brièvement et de manière ambiguë l’expression « Sud global » utilisée dans le titre de l’ouvrage, qui « renvoie à une configuration qui ne serait pas géographiquement déterminée, mais plutôt contextuellement située et collectivement imaginée » (p. 4). Cette représentation est à nouveau traitée dans le magnifique chapitre de Nicolai Volland consacré à la diplomatie culturelle chinoise dans les années 1950 et 1960, mais dans une réflexion portant davantage sur la bureaucratie éducative et éditoriale « tiers-mondiste » chinoise, et sur sa subsidiarité à celle de l’Union soviétique. Cette politique de solidarité culturelle était en outre spécifiquement afro-asiatique, car, hormis quelques traductions, il n’y eut pas de politique forte concernant l’Amérique latine. Dans l’ensemble de l’ouvrage, plutôt qu’un seul « Sud global », ce sont trois « Suds » spécifiques qui sont présentés : l’Asie du Sud-Est, avec laquelle la Chine entretient depuis longtemps des relations de contiguïté, de langue, d’exils, de commerce et de littérature ; l’Afrique, continent sur lequel la Chine mène des projets d’extraction tout en bâtissant un imaginaire raciste ; l’Amérique latine, enfin, terrain d’investissements étatiques et source d’importations agricoles.
Ces trois Suds sont présentés comme « les échelons les plus humbles des ordres capitalistes mondiaux » (Mingwei Huang, p. 174). Les migrants économiques chinois y arrivent depuis la fin des années 1970, motivés par un désir d’ascension sociale et animés d’un esprit entrepreneurial, dans l’objectif de vendre aux classes moyennes et populaires sud-africaines, tanzaniennes ou de Buenos Aires les produits fabriqués en Chine. Qui sont ces migrants ? Mingwei Huang énumère avec une précision sociologique leurs occupations en Chine, avant leur départ pour Johannesburg : ouvriers du bâtiment du Fujian travaillant à la construction de maisons financées par les transferts de fonds d’autres migrants, agriculteurs d’une campagne de plus en plus dépeuplée, anciennes ouvrières (factory girls) de l’industrie d’exportation des années 1990 et, enfin, les plus jeunes, des salariés du secteur des services, sans emploi stable. « La plupart de mes informateurs étaient les travailleurs précaires les moins bien payés, issus du secteur des services, [et] ayant une scolarité incomplète » (p. 175). Leur stratégie repose sur la mobilité : ils sont disposés à migrer, entre villes et régions, à la recherche d’opportunités. Une mondialisation « par le bas » et, par conséquent, indirectement liée à la mondialisation « par le haut », celle des accords géopolitiques interétatiques et des investissements, à base de milliards de dollars, dans le secteur des infrastructures et de l’alimentaire.
Cette migration est un flux mondial, au sens littéral du terme, qui comprend, cela va de soi, des destinations privilégiées : l’Europe, les États-Unis et l’Australie, avec qui la Chine a aussi noué des liens économiques et géopolitiques étroits et vers lesquelles migrent ces travailleurs « entrepreneuriaux ». Mais, ici, les questions se compliquent nécessairement : qu’est-ce qui, au sein de ce flux migratoire et commercial mondial, caractérise le Sud global ? Les migrants chinois de Seattle ont-ils la même origine sociale que ceux de Tanzanie ? Et, rétrospectivement : qu’est-ce qui distinguait les migrants – quasi esclaves – travaillant à la construction du chemin de fer californien de ceux qui faisaient le même travail à Cuba ? Hier comme aujourd’hui, pourquoi présupposer qu’une migration ayant pour destination une ville européenne ou américaine présente des avantages objectifs par rapport à celle visant São Paulo ou Buenos Aires ? La Tanzanie est-elle plus dangereuse que Baltimore ou Dallas, notamment si l’on prend en considération les chiffres de la violence et du racisme à l’égard des Noirs et des Asiatiques ? Il ne s’agit pas là de questions rhétoriques. Leurs réponses contiennent certainement des clés permettant de différencier le Sud global de pays comme les États-Unis, l’Australie ou ceux de l’Union européenne pour ce qui est des migrations chinoises, ainsi que des « nouveaux mondes » qu’elles ont contribué à créer. Mais il s’agit là de questions empiriques qui devront être formulées via une délimitation des domaines spatiaux et conceptuels de la recherche.
L’idée d’une hiérarchie entre Nord global et Sud global, dans laquelle la Chine serait un « pivot » ou un « support » (l’éditeur utilise le mot fulcrum, p. 4) est à la fois éclairante et problématique. D’un côté, elle donne le monde à voir en tant qu’entité conflictuelle et, d’un autre côté, elle risque de reproduire deux lieux communs idéologiques qui accompagnent souvent les recherches « globales » : un lieu commun concernant la race, qui met dos à dos le monde des Blancs et celui des Noirs ou des « Bruns », et un lieu commun d’ordre économique, qui oppose le monde « développé » au « sous-développé ». Ces abstractions manichéennes trouvent bien sûr un ancrage dans la réalité ainsi que dans la perception des différents acteurs. Mais elles cessent de fonctionner dès que l’analyse révèle, d’une part, que la notion de race ainsi que les contradictions liées au développement existent tout autant au Nord qu’au Sud, voire en Chine elle-même et, d’autre part, que les concepts de race et de développement ne sont ni universels ni objectifs, mais contextuels et résultant d’une perception, défiant ainsi les hypothèses de la recherche. On constate ainsi, en y regardant de plus près, que le Sud global ne se trouve pas seulement dans le sud et qu’il n’est pas « global ». L’influence de la Chine dans le monde révèle des relations sociales qui mettent en place de multiples marchés capitalistes (pour les romans aussi bien que pour le soja et les bibelots), en réarticulant d’anciennes géographies et en en créant de nouvelles sur tout le globe terrestre, dans un processus au cours duquel les acteurs modifient leurs positions de classe, leur identité, leur culture ainsi que leurs perceptions ethniques. Le défi, pour une critique du racisme et des inégalités mondiales, est donc d’éviter les tropes idéologiques d’ordre racial et positiviste, en étudiant plutôt – comme le propose l’éditeur de l’ouvrage et ainsi que le pratiquent ses auteurs – les « racialisations » et les hiérarchisations réelles, « contextuellement situées et collectivement imaginées ».
Un exemple de la finesse requise pour avancer selon cette perspective nous est fourni par la discussion sur l’« archipel » littéraire et culturel que constitue l’Asie du Sud-Est, qui entretient des liens très variés avec l’écriture et l’oralité chinoises (voir, à ce titre, les chapitres de Ng Kim Chew, Carlos Rojas et Shuang Shen). Les pays de la mer de Chine méridionale font à la fois partie de l’univers textuel chinois et du « Sud » (nanyang). Les modernismes culturels et littéraires des années 1920 et 1930 dans cette région sont contemporains du criollismo2 universaliste de Jorge Luis Borges ou des traductions des œuvres de la littérature mondiale réalisées par les écoliers mexicains, sous l’égide de José Vasconcelos. Nanyang était aussi la « couleur locale », méridionale et tropicale, d’une nouvelle littérature chinoise. Enfin, la région a été un espace de traduction entre les langues – chinoise, anglaise, malaise et autres – à l’époque de la colonisation britannique et de la construction des nations à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, à Taïwan, Hong Kong et dans d’autres pays (l’ouvrage ne traite pas spécifiquement du Vietnam ni des Philippines). S’appuyant sur certains de ces éléments, Shuang Shen, dans le dernier chapitre du livre, propose de considérer les relations de la Chine avec ce Sud proche comme une clé pour analyser les liens avec le Sud global au sens large. D’une part, les modernismes, les interprétations soviétiques, les diasporas, les conflits anticoloniaux (contre la Chine elle-même et contre les empires européens), les relations interétatiques, le commerce et les migrations qui ont lié la Chine à ses voisins du Sud proche ont été menés de façon plus intense, linguistiquement et démographiquement parlant, qu’avec le reste du monde. En effet, les relations avec l’Afrique, le reste de l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique latine – ainsi qu’avec l’Europe et les États-Unis –, plus distanciées, ont généré des interprétations différentes. Mais ce sont précisément l’ampleur et l’intensité croissantes des liens actuels que la Chine entretient avec toutes ces régions lointaines qui la rapprochent de ce Sud, à la fois différent et contigu, dont la diversité institutionnelle, géopolitique, économique et linguistique préfigure de « nouveaux ordres » tout aussi diversifiés.
Notes
1
Martín Bergel, El Oriente desplazado. Los intelectuales y los orígenes del tercermundismo en la Argentina (« L’Orient déplacé. Les intellectuels et les origines du tiers-mondisme en Argentine », non traduit), Bernal, Argentine, Université nationale de Quilmes, 2015 ; Laura J. Torres-Rodríguez, Orientaciones Transpacíficas. La modernidad mexicana y el espectro de Asia (« Orientations transpacifiques. La modernité mexicaine et le spectre de l’Asie », non traduit), Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, États-Unis, 2019 ; Claudio E. Benzecry, The Perfect Fit: Creative Work in the Global Shoe Industry (« La Taille parfaite. Le travail de création dans l’industrie mondiale de la chaussure », non traduit), University of Chicago Press, Chicago, États-Unis, 2022.
2
Mouvement littéraire sud-américain inspiré des traditions « créoles », soit celles des descendants – nés sur place – d’Européens ayant émigré vers l’Amérique du Sud. (N.d.T.)









