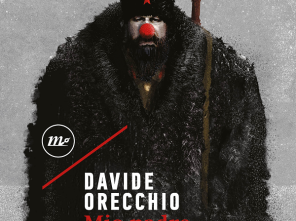(Université de Cergy-Pontoise)
En novembre 2017, Carlos M. Herrera et Eugénia Palieraki ont organisé, à l’université de Cergy-Pontoise, un colloque international sur La Révolution russe et l’Amérique latine : 1917 et au-delà, auquel ont pris part des historiens venus de France, de Russie, d’Israël, d’Argentine et du Chili. À l’occasion de la prochaine parution des actes du colloque, Omar Acha qui avait participé aux travaux, dialogue ici avec Carlos M. Herrera sur les perspectives qu’ouvre la célébration du centenaire de 1917, vu depuis l’Amérique latine.
Omar Acha – Il est peut-être nécessaire d’expliquer aux lecteurs que cette discussion avait été pensée, à l’origine, comme un article sur les travaux générés par le centenaire de la Révolution russe dans des publications latino-américaines. L’idée générale était d’offrir des informations et des analyses qui puissent faciliter des comparaisons avec des études similaires concernant d’autres continents ou d’autres pays.
Pour ma part, j’avais pensé au départ distinguer trois aspects des commémorations de la Révolution russe en Amérique latine, en prenant en considération quelques cas (peut-être l’Argentine, le Brésil et le Mexique). Par « commémoration », j’entendais un concept qui embrassait différents niveaux de la représentation historique. En premier lieu, la présence ou non de 1917 dans la production historiographique récente, c’est-à-dire d’études permettant d’interroger la pertinence de cet événement pour la recherche scientifique. La question que j’avais en tête était la suivante : quels « effets » ou quelles « réceptions » a eu un phénomène mondial comme la Révolution russe sur un continent en apparence aussi éloigné du terrain où se sont produits les faits ? Ensuite, il s’agissait de ressaisir quelle était la place de ce phénomène dans les politiques mémorielles des gauches latino-américaines, car c’est dans ce contexte qu’a été représentée et évaluée la Révolution russe, surtout en 2017. Autrement dit, quels centenaires de la Révolution au sein de la gauche latino-américaine ? Je trouvais enfin qu’il serait intéressant de reconstruire les possibles répercussions publiques des événements de 1917 au-delà du contexte historiographique et des gauches politiques, même d’une façon impressionniste. Mais j’ai vite abandonné cette idée car elle aurait excédé les limites imposées.
En l’absence de livres consacrés à ce thème, comme celui publié en Espagne et composé majoritairement d’études locales1, mener mes recherches dans des revues académiques qui ont pris l’initiative de publier des dossiers sur la Révolution russe m’avait semblé une bonne alternative. J’ai trouvé trois revues argentines (Prismas. Revista de Historia Intelectual, Avances del CESOR et Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados), une publication uruguayenne (Claves. Revista de Historia), deux colombiennes (Historia Crítica et Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura), et enfin deux revues brésiliennes (Tensões Mundiais et Estudos Históricos)2.
Je ne suis pas sûr que cette façon de procéder ait pu apporter des données permettant une analyse détaillée. Pourquoi une évaluation d’ensemble me semble-t-elle problématique ? Non pas, bien sûr, parce que les études inclues dans les dossiers seraient sans intérêt, mais à cause de leur format et de leur perspective. Peut-être aussi à cause des appels à contribution ou bien parce que dans le monde académique nous avons un habitus bien ancré qui nous pousse à écrire des papers même sur des lieux communs qui devraient, pense-t-on, susciter d’autres types d’interrogations. Les travaux qui forment les dossiers peuvent être appelés « monographies » car ils ont pour objectif de proposer une connaissance spécifique du passé associée aux répercussions de la Révolution russe dans certains pays et, plus exactement, dans une ville, dans quelques publications périodiques, au sein d’un groupe politique ou chez un penseur. J’insiste sur le fait qu’en appelant ces dossiers « monographies » je ne souhaite aucunement les déprécier mais insister sur la difficulté de les incorporer au sein d’une réflexion historico-culturelle plus générale à partir de leurs propres arguments. Je me réfère à la tâche que Hans Georg Gadamer a appelée « le travail de l’histoire » ou Wirkungsgeschichte, c’est-à-dire un dialogue entre l’« horizon » du passé et notre réalité contemporaine susceptible d’établir une relation dynamique, « anachronique » de manière productive.
En parcourant ces dossiers, j’ai relevé trois types de sujets de recherche. Un premier ensemble regroupe les travaux retraçant des réceptions politiques de 1917 à partir de répercussions locales et, en particulier, de la formation des partis communistes en Amérique latine. Certains articles intègrent l’analyse d’autres courants politiques : socialistes, anarchistes, syndicalistes révolutionnaires. Des études ont ensuite été menées sur la réception intellectuelle. La figure du Péruvien José Carlos Mariátegui a été le cas le plus étudié, bien qu’il ne soit pas le seul. Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours en présence de recherches visant à ressaisir la réception d’un phénomène extérieur. Enfin, on a reconstruit l’influence de la Révolution russe sur d’autres acteurs de l’histoire locale, tels que les droites contre-révolutionnaires, l’émergence du nationalisme agressif et du catholicisme intégriste, ou la formation des premières expériences que l’on pourrait appeler très généralement « populistes » au sens latino-américain.
Je conclurai en disant que cette idée initiale d’une révision des commémorations et des réflexions historiques sur la Révolution russe en Amérique latine m’a semblé peu prometteuse. En revanche, on pourrait débattre à propos des questions ou des approches qui seraient productives pour penser cet événement historique, sans aucun doute central dans l’histoire globale du XXe siècle, à partir de nos situations actuelles. Je pense aux conditions politiques et intellectuelles : le centenaire de la Révolution russe pourrait être l’occasion de penser historiquement et théoriquement – et pas seulement de manière « monographique » – des questions telles que la révolution, les phénomènes mondiaux, l’historicité du référent « communisme », etc.
Carlos M. Herrera – Tu distingues trois aspects de la commémoration : historiographique, mémoriel et public. Même si je ne suis pas certain de savoir ce que recouvre exactement cette troisième dimension, je serais tenté d’ajouter un quatrième aspect : celui de la « célébration », qui, comme le disait Jordi Canal à propos de la Catalogne, nous place dans une autre temporalité, où l’historique connecte avec le présent et le futur, plutôt que de se situer uniquement dans le passé – en ce sens, le titre du célèbre essai de François Furet n’était nullement hasardeux3.
Revenons à l’aspect historiographique, sur lequel je partage l’essentiel de ton jugement. Peut-être à l’analyse d’études récentes, du moins si nous prenons comme base notre livre avec Eugénia Palieraki4, pourra-t-on déceler une orientation que je voudrais souligner aujourd’hui qui, par-delà le caractère monographique de ces travaux, va dans le sens d’une histoire plus générale que tu réclames à juste titre. En effet, faire une histoire latino-américaine de la Révolution russe veut dire aussi tenter de repenser l’histoire du XXe latino-américain à la lumière de cet événement. Ou, ce qui revient au même : à affirmer que l’histoire de l’Amérique latine du XXe siècle ne peut pas se comprendre sans ce que cette Révolution produit, y compris sur d’autres expériences révolutionnaires qui l’avaient devancée dans le sous-continent, comme la Révolution mexicaine de 1910-1917. Cette lecture peut être facilitée par le fait que l’événement russe de 1917 met à l’œuvre, et comme concentré, dans cette temporalité serrée propre à l’événement révolutionnaire, l’universel et le national, l’exceptionnel et le normal, le central et le périphérique... Cette vision a d’emblée plusieurs conséquences sur le plan historiographique, en commençant par le fait que cette histoire n’est pas celle des partis communistes, pas même celle des partis politiques de gauche.
Cela suppose, surtout, une opération complexe du point de vue historiographique : en partant des répercussions spécifiquement latino-américaines de la Révolution russe, on pourrait capter la portée mondiale de l’événement, qui n’est pas synonyme d’européen, dans une histoire intégrale du XXe siècle. Le passage par l’Amérique latine permet justement de sortir la Révolution russe des projections européennes qui ont alimenté jusqu’à présent l’essentiel de l’historiographie. Une historiographie qui, si je ne me trompe pas trop, est restée dans l’état du débat des années 1990 où il s’agissait, en gros, de lire la Révolution russe à la lumière des droits de l’homme comme horizon d’une politique progressiste. D’une certaine manière, ce passage par l’Amérique latine lui enlève son « universalité », en tant que modèle de révolution ou de construction de société, ne serait-ce qu’en rappelant les incrustations du « Sud », ou plus exactement du non-européen – même si la Révolution russe peut sembler à certains égards clôturer cette modernité ouverte au milieu du XVIIIe et que la sémantique historique a nommé Sattelzeit.
Cela pourrait nous conduire à des débats, comme tu le dis très bien, sur ce que recouvre dorénavant l’idée de révolution. Nous sommes là dans l’une des dimensions que nous offre la commémoration comme telle... Peut-on toujours utiliser la catégorie moderne de « révolution » aujourd’hui ? À quelles conditions ? Il y a une dimension moderne de la notion qui servait à nommer des expériences très diverses, et surtout indépendamment de leur « triomphe » ou non – on parlait de la « Révolution mexicaine » mais aussi de révolutions qui échouent comme la « Révolution allemande », ce qui explique aussi sa permanence dans le vocabulaire politique (on parle bien de « Révolution bolivarienne »…).
Peut-être que cette remise en cause d’une universalité (européenne) ne touche qu’à l’aspect normatif, téléologique du récit, qui peut devenir global sur d’autres bases. Et présenter même d’autres aspects intégraux, par-delà la connexion transnationale. Par exemple, je dirais que l’histoire de la Révolution russe, au-delà de l’histoire des partis communistes, nous permettra de retrouver la dimension de Vita activa qui incarnait le fait d’être communiste au XXe siècle. Ici on va au-delà, je crois, de la perspective que tu signalais plus haut, car il ne s’agit pas uniquement d’histoire politique ou d’histoire des idées, même si l’on n’est qu’aux premières ébauches. Seulement, ces études ne sont compréhensibles que sous l’horizon qu’ouvre le centenaire, i.e. la commémoration. Notre travail d'historien est peut-être facilité du fait que ce centenaire n'a pas éveillé de célébrations importantes – même en Russie – il semble intégré dans d'autres dimensions, plus « nationales » après tout.
Je reviens sur un autre aspect que tu évoquais, l’efficacité en creux de la Révolution russe, bien au-delà des frontières communistes. En gros, ce qu’elle a produit sur d’autres formes politiques que celles issues spécifiquement du fait révolutionnaire, mais qui touchent toujours le social comme problème, et plus exactement, l’émancipation. Je distinguerai donc, entre la dimension de « rejet » des droites nationalistes et l’aspect productif, où je ferais rentrer le populisme latino-américain et le Welfare State européen post-1945. Certes, ces dernières dimensions gardent toujours un élément instrumental – détourner les masses ouvrières nationales d’un communisme qui s’incarnait matériellement comme expérience quelque part –, ou du moins un même point de départ négatif (le non-communisme). Mais la propre logique de son déploiement le conduit à s’autonomiser, produisant ce que l’on pourra appeler un changement par intégration sociale. Bien entendu, on reste toujours au XXe siècle…
Pour revenir un instant sur la portée épistémologique de la commémoration dans l’écriture de l’histoire, je soulignerai que cette scansion temporelle qu’est le centenaire de la Révolution russe rend possible (facilite ?) de se placer dans un autre temps par rapport aux récits précédents. Tout simplement, la commémoration est l’occasion de revenir de manière critique sur l’histoire faite sous l’actualité de ce projet, notamment en temps de guerre froide. Notre idée, en organisant le colloque à partir de son lien avec l’Amérique latine était de renforcer cette nouvelle perspective, comme pour mettre une double distance…
Si l’historien doit se montrer alerte sur toute célébration, cela n’ouvre pas moins à d’autres interrogations qui ne se rapportent pas uniquement au passé mais à la possibilité de penser l’idée d’une autre société. Ce que je crois lire dans ces conditions auxquelles tu te réfères. Peut-on toujours utiliser le nom « communisme » – comme question, comme disait Lefort, ou comme hypothèse, ce dont parlait Badiou – pour se référer à d’autres perspectives de changement radical au XXIe siècle ? Ces travaux historiographiques, en déconnectant l’histoire des partis communistes, de l’expérience soviétique, etc., et même du modèle de révolution 1789‑1989 peuvent sans doute éclairer cette dimension. Non pas pour permettre de retrouver une pureté perdue. Mais il se peut que « communisme » reste encore la forme de nommer l’autre de l’individualisme. Quel type de tension pourra naître, en outre, du fait que communisme est aussi, au XXIe siècle, le nom dont se revendique la deuxième puissance économique mondiale ?
O. A. – Il est intéressant de suivre ce fil dans le cas de la spécificité latino-américaine (une spécificité que nous devons naturellement interroger et non pas considérer comme établie une fois pour toutes) des façons de se rappeler – de commémorer –, de penser la signification historique de la Révolution russe et l’apparente universalité des langages que nous utilisons. Par chance, les meilleures formulations du point de vue postcolonial, comme chez Dipesh Chakrabarty, soulignent bien l’impossibilité de faire fi des concepts forgés au cours de l’histoire européenne : démocratie, justice, égalité, révolution, contre-révolution, entre autres5.
Si on revient à l’analyse de la production récente, je voudrais insister sur le déséquilibre entre les travaux particuliers et l’absence de réflexions plus larges. J’ai dit que les travaux qui font partie de ces dossiers sont en général de bonne qualité, intéressants. D’ailleurs, nous avons rencontré de nombreux collaborateurs de ces dossiers parmi les collègues qui ont assisté au colloque de Cergy…
On trouve l’idée générale que j’ai énoncée plus haut, exprimée d’une autre façon, dans l’introduction du dossier de la revue Claves. Ses responsables, l’historienne uruguayenne Magdalena Broquetas et l’historien, uruguayen aussi mais actuellement en poste à l’Université de Tel Aviv, Gerardo Leibner, y reconnaissent à juste titre la valeur des travaux publiés dans ce numéro de la revue. Ils ajoutent cependant deux paragraphes qui, à mon avis, méritent d’être reproduits in extenso car ils peuvent s’appliquer aux autres dossiers que j’ai lus. Broquetas et Leibner affirment, qu’en plus de leurs qualités, ces travaux :
reflètent aussi ce que nous-mêmes, coordinateurs, nous considérons comme l’une des principales limites de l’historiographie existante : la déconnexion entre deux champs qui sont en général étudiés séparément bien qu’ils soient, comme nous l’avons indiqué au début, historiquement liés et rapprochés. La lutte politique et idéologique les a clairement reliés et bien qu’ils aient des sources d’inspiration externes à leurs rivaux locaux et immédiats, les partis communistes et les forces anti-communistes nationaux ont eu un impact les uns sur les autres et vice-versa, en reproduisant parfois des attitudes, des arguments, des sujets d’intérêt, des formes de propagande et en s’influençant mutuellement dans une relation dialectique. Ce fait que nous mentionnons n’est pas la conclusion de recherches qui ne se sont pas encore développées suffisamment mais une hypothèse qui devrait être mise à l’épreuve de façon empirique dans de futures recherches et qui, en même temps, pourrait aider à repenser des thèmes et des problèmes qui ont été développés chacun de leur côté, sans connexion évidente.
Une autre limite qui apparaît dans les contributions que nous présentons est la tendance encore prédominante dans les pays latino-américains à étudier le communisme et l’anticommunisme dans une perspective nationale, en ne faisant pas assez appel aux dimensions internationales et latino-américaines. Cet intérêt récent pour la réception et la traduction d’idées globales à l’échelle nationale ou régionale gagnerait beaucoup à recourir à des perspectives qui considéreraient des espaces plus larges, qui permettraient d’apprécier des simultanéités, des régularités et des singularités, en offrant dans le même geste un terrain plus complet et complexe pour reconstruire les réseaux et les circuits transnationaux. Une orientation de la recherche avec ces caractéristiques suppose sans aucun doute un effort collectif et un défi heuristique et interprétatif que nous espérons avoir contribuer à rendre plus visible6.
Je m’excuse pour la longueur de la citation mais je trouve ces considérations utiles : il faudrait dépasser le cadre national et même, si l’on veut rendre la question plus intéressante, insérer des jeux d’échelles. C’est pourquoi, et sur ce point certains travaux qui font partie des dossiers latino-américains sont très utiles, le cadre national ne va pas non plus de soi. Par exemple, la « réception » de l’événement révolutionnaire russe est différente dans une ville cosmopolite comme Buenos Aires et dans une autre ville argentine aux traditions différentes, comme Córdoba, de même entre Río de Janeiro et Belo Horizonte. En effet, nous pourrions envisager les manières dont a eu lieu la production de textes portant sur le centenaire de la Révolution russe comme un indice des problèmes posés par l’expansion latino-américaine des propositions liées à cet ensemble complexe qui caractérisent l’histoire globale, mondiale, entrecroisée, etc.
C. M. H. – Outre les pesanteurs actuelles du champ académique, je crois qu’une partie de ce déséquilibre vient du fait que cette nouvelle histoire doit affronter l’obstacle qu’ont pendant longtemps représenté les récits officiels des partis communistes. Peut-être l’accent sur des figures intellectuelles « créatives » vient aussi en partie du fait que les pratiques des partis communistes stalinisés condamnaient ce type d’ouverture. Je pense qu’on n’a pas encore comparé le type de dirigeant communiste qui a prévalu pendant un certain temps en Amérique latine – du moins en Argentine –, avec le modèle de leader qu’on trouve en Europe au même moment, des hommes comme Ernst Thälmann en Allemagne ou Maurice Thorez ici. L’éternel retour de Mariátegui (ou à une autre échelle d’Anibal Ponce) participe en tout cas de cette donnée.
Pour cette spécificité, en effet, on pourrait se contenter de l’envisager comme un point de départ empirique, tout au plus, comme une hypothèse de recherche. Il est clair, comme disait Chakrabarty, qu’il s’agit de perturber un récit, dont nous ne pouvons plus nous séparer… Mais j’insisterai sur l’intérêt de ce regard latino-américain, dans la mesure où les travaux qu’on a déjà pu mener à l’occasion de notre rencontre mettent au jour certains aspects de la Révolution russe que l’historiographie existante avait eu plus de mal à saisir. Ce n’est pas un hasard si ce récit insistant sur la criminalité de l’expérience communiste provient de l’aire européenne, et ce par-delà les partis pris idéologiques qui l’ont souvent accompagnés. Pour être un peu provocateur : je serais tenté d’y voir une pente naturelle en ce qu’il enchaîne, et par certains biais peut prolonger, avec une histoire européenne où le génocide, le crime de masse, le racisme, la criminalisation de l’ennemi, etc. sont décisifs pour comprendre l’histoire politique de l’Europe au XIXe-XXe siècle.
En Amérique latine, notamment après 1917, ces actions ont été forcément placées du côté de la droite ou de l’extrême-droite, en bonne partie en réaction à l’expérience soviétique qui s’intègre dans la Doctrine de la sécurité nationale, et qui recevra encore un tournant spécifique avec Cuba au début des années 1960. Mais bien avant déjà, la première grande répression d’une grève ouvrière en Argentine après la « normalisation démocratique » de 1912, avec des assassinats commis par des forces para-policières, des pogroms, etc. est marquée par la peur maximaliste.
Lié à cet aspect, comme dans un jeu de miroirs, il y a peut-être un risque latino-américain homologue, qui pointe dans certaines recherches actuelles, de s’enfermer trop dans la paire communisme-anticommunisme.
Dans tous les cas, il y a au moins deux manières de dépasser le cadre national de l’écriture de cette histoire que je voudrais pointer : par comparaison ou par articulation des expériences. Je crois que tu penches sur la seconde perspective ? Ici, on voit en tout cas que le signifiant « Amérique latine » ne peut pas être pris comme une évidence. Les expériences, les temporalités sont diverses entre les différents pays, parfois voisins. Prenons le Cône Sud, que nous connaissons un peu mieux. Entre l’Uruguay et l’Argentine on pourra trouver des ressemblances à propos de l’expérience communiste, mais dès qu’on ajoute le Chili dans ce jeu, cela change la perspective de manière assez décisive. Et n’en parlons pas si l’on inclut le Brésil… ou encore la Bolivie... Ici, le concept de « culture politique » peut s’avérer productif pour examiner des expériences assez différentes. En es-tu d’accord ? Ou bien cela rentre-t-il aussi dans la critique que tu adresses à une certaine reconstruction en termes d’histoire intellectuelle ?
O. A – Je partage ton avis à propos de l’échelle nationale, ou soi-disant nationale car, en général, les travaux ont porté sur les capitales, sur l’histoire des partis communistes (de nombreux travaux en cours cherchent à mettre en lumière d’autres espaces qui aideraient à dépasser le caractère central des grandes villes, une particularité qui n’est pas propre à l’histoire des gauches). C’est en effet un problème si l’on revient aux différents effets de la postérité de la Révolution russe. Il s’agit d’une vraie difficulté car une construction téléologique perd de vue que la voie ouverte par l’événement de 1917 a été l’objet de débats au moins jusqu’à ce que l’Armée rouge entre dans Berlin en 1945. On peut même dire qu’elle a été l’objet de débats après 1945, mais le « prestige » de l’Union Soviétique a été identifié avec les partis communistes.
L’exemple le plus parlant de la complexité des débats pour l’héritage de 1917 est celui du trotskisme, mais on la retrouve aussi chez les anarchistes, ou dans les courants marxistes hétérodoxes comme le conseillisme ou le luxemburgisme, de même que dans les gauches les plus libérales ou social-démocrates, pour lesquelles le triomphe bolchevique (ou staliniste selon les cas) a gâché une révolution émancipatrice. Les études récentes, que j’ai sans aucun doute appelées injustement « monographiques », sont très instructives à propos de la diversité des manières de lire le phénomène russe selon différentes traditions idéologiques.
Or, la centralité « nationale » est historiquement problématique car, s’il n’est jamais facile d’être d’accord avec des approches excessivement dichotomiques, cela a été un vieux débat – je pense aux thèses d’Annie Kriegel et à la discussion qu’elles ont suscitée – de savoir si le mouvement communiste était un « parti mondial » contrôlé depuis Moscou ou si, au-delà des identités imaginaires, les pratiques concrètes étaient définies au sein des contextes locaux. Il me semble qu’en Amérique latine c’est cette dernière option qui prévaut.
Sans aucun doute, la notion d’ « or de Moscou », créée par les courants nationalistes et anti-communistes pour lesquels la révolution anti-capitaliste était un phénomène exogène et étranger aux vertus nationales, est insuffisante pour expliquer l’influence de ce qui a été pensé comme la « patrie de la révolution », et pas seulement par les partis communistes. Comme tu l’as dit, les expériences historiques du cône sud varient de manière significative. La Révolution russe et ses dérivés en Union Soviétique n’étaient pas les mêmes pour Luis Emilio Recabarren au Chili que pour Victorio Codovilla en Argentine ou Luis Carlos Prestes au Brésil. C’est pourquoi la Troisième Internationale n’a pas pu définir de « stratégie » valide pour toute l’Amérique latine jusqu’en 1929 (laissons de côté le fait de savoir si une décision adoptée lors du conclave de Buenos Aires a été ensuite effective au niveau des pratiques).
Le fait est que ces définitions étaient très générales et ne rendaient pas compte des conditions nationales et continentales. Cela ne devrait pas trop nous surprendre car les États nationaux latino-américains avaient aussi des connaissances partielles, par exemple concernant l’urbanisation et l’industrialisation, la structure et la composition des classes sociales, la transformation des relations entre la campagne et la ville, etc. Il y a en outre les pratiques concrètes qui intéressent directement l’historiographie. Par exemple, avec son regard ethnographique subtil, le chercheur péruviano-mexicain Ricardo Melgar Bao a donné un certain relief à l’expérience de quelques échanges de la Fédération des Communautés Indigènes de Bolivie, du Pérou et d’Argentine, organisation dont l’orientation était avant tout anarchiste dans les années 1920, avec la Troisième Internationale7. On peut penser que c’est un fait anodin, mais il peut malgré tout être incorporé à une trame plus importante où le cas de Mariátegui (et celui de Tristán Maroff) perd de son étrangeté, et il permet de resituer certaines suppositions concernant l’extériorité ou le cosmopolitisme du communisme, sa perte d’influence limitée aux appareils bolcheviques, et bien sûr le plan national dont nous sommes en train de parler.
Malgré tout, le fait que les gauches mondiales, et même les latino-américaines, aient dû revoir leurs agendas et leurs défis à partir de 1917 semble indiscutable. Toi, tu connais bien le cas des partis socialistes. Bref, je refuse de choisir entre les deux manières de dénaturaliser le cadre national que tu mentionnes : via des comparaisons ou des articulations (je parlerais peut-être davantage ici de réseaux, de contacts, de transmissions, de flux). En Amérique latine, on est en train de fournir des efforts pour établir des réseaux de recherche au niveau continental. J’espère que ces efforts vont prospérer et vont nous aider à élaborer des problématiques plus complexes, capables de dialoguer avec les recherches en cours dans d’autres domaines. Par exemple, une histoire des effets différentiels sur ce que tu appelles « les cultures politiques » des gauches en Amérique latine et en Asie serait très suggestive.
Je voudrais prendre le concept de « cultures politiques » dans toute son ampleur, en le différentiant de lignes idéologiques compactes et d’un empirisme des différences informes. Je sais bien que la notion de « culture politique » entend conceptualiser la complexité historique des transformations produites à différents niveaux et identifiables dans l’action pratique des acteurs, groupes et organisations. Pour se mettre d’accord sur une définition, je pense que l’on devrait l’inscrire dans un double mouvement qui permette de reconstruire le terrain dont on parle : celui des mutations politico-intellectuelles en cours dans les sciences sociales et humaines en Amérique latine, puis la fin du cycle des dictatures (grosso modo 1964-1990). Je parle des façons dont a eu lieu la « fin de l’histoire », comme signe de la défaite et du déclin du langage et de la pratique « révolutionnaires » qui avaient joui d’une certaine renommée dans la vie intellectuelle occidentale pendant les années 1960 et une partie des année 1970.
Il me semble que les caractéristiques des voies latino-américaines ont été différentes des voies européennes. D’une part, bien qu’après les dictatures la notion de révolution ait été amplement discréditée ou, tout au moins, ait persisté dans le langage conceptuel d’une infime partie des intellectuels, en même temps, l’idée révolutionnaire a été chaque fois moins identifiée à la Terreur propre au mouvement transformateur. L’exception est peut-être le cas du Sentier Lumineux au Pérou, considéré comme un groupe plongé dans le délire et la violence aveugle. Mais s’il y a eu des débats, par exemple, pour savoir à quel point la guerrilla guevariste avait contribué à la justification des dictatures contre-révolutionnaires (je pense à l’Argentine et à l’Uruguay), cela n’a pas été le cas du Chili d’Allende ni du Brésil de João Goulart. La terreur en Amérique latine a plutôt été identifiée avec la répression d’État. De là la connexion entre gauches et « droits de l’homme » qui caractérise l’Amérique latine depuis quarante ans au moins. D’autre part, l’historiographie des gauches, bien qu’elle ait entretenu une relation ambivalente avec le marxisme, continue de maintenir des liens plus ou moins étroits avec ce même marxisme, sans doute utilisé de différentes façons.
Bref, il me semble que l’on peut incorporer à bon escient la notion de cultures politiques pour désagréger les expériences latino-américaines, non seulement du communisme ou des partis communistes, mais aussi des façons dont on s’est remémoré la Révolution russe. Il y a certes des différences, mais des catégories universalistes persistent aussi, parmi lesquelles la révolution ne renvoie pas nécessairement au domaine de la folie ou du messianisme. On ne trouve pas dans les dossiers, ni dans les publications académiques dispersées dans de nombreuses autres revues latino-américaines récentes, d’articles comme celui qui a été publié dans la revue d’une fondation libéral-conservatrice chilienne, le Centre d’Études Publiques, de l’auteure russe Evguenia Fediakova, où l’on rencontre une adhésion complète et explicite au point de vue de Furet sur le caractère caduc de l’ « idée communiste8».
Je sens un certain malaise, cependant, concernant l’intérêt de considérations très générales. Je voudrais donc te poser la question suivante, car en tant que co-organisateur du colloque de Cergy tu as certainement une vision à la fois plus précise et plus large. Comment vois-tu le panorama à la lumière du colloque et d’autres informations que nous avons mentionnées dans cette conversation ? Les commémorations académiques de la Révolution russe de la part de chercheurs latino-américains, et de certains autres qui connaissent bien l’Amérique latine, ont-elles produit des résultats prometteurs ?
C. M. H. – Si résultats prometteurs il y a – et l’on veut bien le croire avec Eugénia –, ils sont bien entendu de l’ordre du provisoire... Justement, nous partions dans notre introduction du constat qu’il y a déjà non pas un paradigme nouveau qui viendrait remplacer les vieilles interprétations libérales ou soviétiques caractéristiques de l’historiographie du XXe siècle, mais plutôt une convergence de préoccupations et d’interrogations. Elles sont liées à cette nouvelle temporalité que le centenaire de la Révolution de 1917 nous permet peut-être d’ouvrir, comme un point de départ donc, ou tout au plus comme une première cristallisation des recherches qui commencèrent dans la seconde moitié des années 1990, marquées par la fin de l’expérience soviétique, non seulement sur le plan politique mais aussi sur des plans plus techniques (comme l’accès aux archives moscovites).
D’une certaine manière, le livre explicite deux temporalités différentes (avant et après 1945, mais aussi avant et après 1962), très nettement observables en Amérique latine, et que l’on ne peut présenter comme un tout qu’aux prix de simplifications.
L’approche par l’Amérique latine, et peut-être par le Global South en général, est intéressante aussi dans la mesure où elle va à l’encontre – « perturbe », a-t-on dit –, la cartographie Est/Ouest, ou Orient/Occident qui a tellement marquée les perspectives métahistoriques de l’histoire de la Révolution russe… Nous présentons un ensemble des travaux qui alimente donc un regard transnational à distance des visions centre/périphérie, permettant de préciser la part de l’Amérique latine dans une histoire globale du communisme.
Et puisqu’il s’agit de faire de l’histoire de l’Amérique latine à partir de ce qu’ouvre Octobre 1917, le premier apport est de bouleverser les continuités habituelles entre l’histoire de la Révolution russe et l’histoire des partis communistes, ne serait-ce parce que les effets traversent toute la gauche (et toute la droite…) de l’époque : ils ne s’arrêtent point avec la constitution des partis communistes et d’une nouvelle internationale. Le pays des soviets est une donnée avec laquelle les partis de gauche (à droite ou à gauche du PC) doivent désormais compter. Quand on l’aborde par ce biais, et tout en restant si tu veux dans une histoire politique, apparaît l’importance de moments considérés comme moins significatifs par le passé ou complètement absorbés dans les discussions communistes proprement dites.
Pour ce qui relève de la réception communiste en tant que telle, nous avons essayé de rompre tout récit linéaire, et notamment la logique d’une emprise massive de la Russie puis du PCUS, en insistant sur les failles, les marches et contremarches, les difficultés et les résistances, la présence d’éléments composites dans la construction d’une culture – du moins dans ses premiers moments.
La référence soviétique au sens propre a sans doute un statut différent, et introduit un temps différent dans notre réflexion. En particulier sa signification politique change, très nettement, par exemple, avec la Révolution cubaine. C’est ici que l’anticommunisme puise sinon ses racines du moins sa logique, toujours à l’œuvre aujourd’hui – une sorte d’anticommunisme sans communisme, comme le dit joliment Maud Chirio dans son chapitre sur le Brésil actuel. En tout cas, dans notre livre nous essayons d’explorer d’autres dimensions du communisme, comme la vie familiale, la vie quotidienne, la masculinité, des expériences qui ne sont pas directement liées à la stratégie politique des PC.
Moins qu’une célébration, on pourrait penser qu’on prend la commémoration comme un nouvel espace, une ouverture. On pourrait dire même qu’elle comporte une double inscription chronologique : les cent ans de la révolution d’Octobre certes, mais aussi les trente ans de la chute du mur de Berlin... En ce sens, il s’agirait peut-être d’aller à l’encontre du présentisme, qui a laissé entendre, parmi d’autres choses, que cette histoire avait perdu de sa pertinence après l’échec du projet soviétique ou qu’elle ne pouvait être envisagée que sous le signe de la catastrophe...
O. A – Je vois bien que l’on revient aux mêmes problèmes par différents chemins. Plus haut, tu faisais référence à la fin de l’Union Soviétique et à celle du Sattelzeit de Kosselleck. Je pense que, bien que l’on n’aborde pas le sujet explicitement, nous étions d’une certaine manière en train de nous demander si la chronologie et l’explication de la Begriffsgeschichte (c’est-à-dire, l’« époque de la modernité ») étaient transférable à un domaine plus large que celui des sources utilisées par Koselleck, qui sont surtout françaises, anglaises et allemandes. Je suis sceptique sur ce point. Je crois que, par sa façon de poser les problèmes et de tenter de les résoudre, Koselleck a été un penseur européen. C’est évident sur le papier, toutefois cela ne l’est pas forcément en Amérique latine où l’on trouve des applications directes de ses thèses. Or il suffit de reconstruire la façon dont les « Lumières » sont apparues dans l’Amérique coloniale pour observer un panorama assez différent. C’est pour cela que j’ai fait référence plus haut au « tournant décolonial » : non pas pour assumer ses prémisses, ou ses versions les plus essentialistes, mais pour mettre l’accent sur le geste nécessaire consistant à repenser les chronologies trop rapidement universalisées.
On a vu ensuite, dans ce cadre, que l’« histoire » de la révolution est loin de se réduire, comme le souhaitaient les deux camps de la guerre froide, à la Révolution russe et à son dérivé « soviétique ». La portée de cette « histoire » dépasse les usages polémiques du terme « communisme ».
Les histoires latino-américaines se prêtent tout à fait à cette réflexion. On peut penser à l’importance d’autres révolutions, comme les révolutions indépendantistes du début du XIXe siècle, ou encore les révolutions « populistes » et la singularité de la Révolution cubaine. C’est pourquoi l’exercice réalisé il y a quelque temps par Friedrich Katz sur le rôle de la Terreur dans la Révolution russe et la Révolution mexicaine est très parlant. Les résultats ont été peu éclairants car Katz a trop souvent été amené à déclarer que le concept était très différent pour chaque cas9. Je mentionne le texte de Katz pour incorporer une référence à la Révolution mexicaine qui, selon moi, a suscité les débats intellectuels et historiographiques les plus profonds. Il est possible qu’on ne puisse pas développer un débat similaire pour le cas cubain.
Quoi qu’il en soit, une première inférence que je voudrais proposer est l’importance de placer l’efficience de la Révolution russe dans une trajectoire latino-américaine où les phénomènes révolutionnaires ont été à la fois généraux et spécifiques. Les révolutions indépendantistes ont été placées au sein d’un cycle « atlantique » de la révolution. La Révolution cubaine n’est pas séparable d’une entrée de ce que l’on a appelé il y a plusieurs décennies, après la réunion de Bandung en 1955, le « Tiers Monde » sur le terrain global de la guerre froide. Ce sont des conditions de réception singulières, complexes. Concernant le centenaire de l’événement de 1917 qui nous occupe ici, je crois que nous devons dépasser la dichotomie entre une « histoire externe » d’une révolution qui affecte de l’extérieur une réalité lointaine et une « histoire interne » des réceptions latino-américaines.
Pour ce faire, les matériaux ne manquent pas. Je me souviens, pour en revenir au colloque de Cergy, de l’intervention de Rafael Pedemonte, lequel affirmait l’insuffisance des analyses réduisant les débats des gauches latino-américaines à la dichotomie de la guerre froide. Rafael montrait l’interaction complexe entre différents acteurs, orientations et conceptions, en se basant sur la consultation d’archives de plusieurs pays, sur la reconstruction de débats multilatéraux des gauches. Il a raison car le « foquisme », irréductible au « castrisme », cadre mal avec l’idée simplifiée selon laquelle la politique soviétique de la « coexistence pacifique » aurait régi le destin d’un secteur de la gauche latino-américaine. Par ailleurs, la stratégie « foquiste » n’a pas empêché les dirigeants cubains de découvrir dans le gouvernement socialiste de Salvador Allende une voie alternative vers une même fin révolutionnaire. Défendre l’Union Soviétique comme résultat de la Révolution russe et être liée au Kremlin ne signifiait pas se soumettre une fois pour toutes à ses exigences.
C’est un exemple parmi beaucoup d’autres que nous n’avons pas pu explorer de façon adéquate ici, mais qui, pris ensemble, suggèrent l’éventualité d’une révision prometteuse d’une relation plus active avec le monde historique de cette Révolution russe qui sans aucun doute « est passé » mais qui d’une certaine façon continue de vivre en nous avec son caractère caduc. En d’autres termes, quelles sont les « ruines » de la Révolution russe ?
Je pourrais synthétiser une possible tâche, collective, dans les termes suivants : penser quel est l’après-coup, au sens freudien de nachträglich (qui suppose la multiplicité de vecteurs temporels, dont les relations ne sont pas toujours pacifiques), de la Révolution russe en Amérique latine. Mais je ne suis pas sûr que cette tâche nuance suffisamment le diagnostic du présentisme. Peut-être ne peut-on pas toujours penser ce que l’on veut penser.
C. M. H. – Je ne sais pas si j’irai aussi loin aujourd’hui pour ce qui est de la discussion sur la portée de la Begriffsgeschichte et de ses incompatibilités avec un tournant décolonial… C’est un vrai débat ! Ce qui me semblait intéressant de souligner plus haut c’était la dimension moderne du concept de « révolution » que la sémantique historique avait pointé, y compris dans cette idée de répétition, notamment dans sa signification de « similitudes structurales ». À mon sens, penser la Révolution russe dans une trajectoire latino-américaine qui s’ouvrirait au XIXe siècle ou même au XVIIIe n’implique pas de rupture avec le concept moderne… En contrepartie, il exige l’effort d’intégrer dans le concept de révolution des significations irréductibles à l’expérience européenne. Il se peut, après tout, que cette spécificité latino-américaine dont je parlais plus haut tienne au fait de cette historicité propre de la révolution dans le continent – et que tu sembles pointer dans le chapitre que tu as écrit pour notre ouvrage –, rend la notion moderne plus complexe. Mais, à vrai dire, je placerais cette irréductibilité plutôt au XXe siècle notamment avec les expériences populistes, et donc plus près de l’évènement de 1917.
Après, si par « histoire interne » tu veux dire latino-américaine, je crois qu’on a tout de même commencé à avancer dans cette direction. Mais elle suppose de prendre quelques distances avec une autre dimension tout aussi interne, la communiste, telle qu’elle a pu être pratiquée. Pour garder l’exemple que tu donnes, à propos du chapitre de Rafael dans notre livre, il y a là une rupture avec ce type de récit si typique de la guerre froide.
Est-ce que cette temporalité en termes de nachträglich que tu revendiques n’est pas encore teintée de mélancolie, comme dans tout après-coup ? Non pas celle que donne la fin du rêve (communiste) mais celle, si diurne, de ne pas pouvoir penser ce qu’on aimerait penser…
Notes
1
Juan Andrade, Fernando Hernández Sánchez (dir.), 1917. La Revolución Rusa cien años después, Madrid, Akal, 2017.
2
Prismas. Revista de Historia Intelectual, n° 21, 2017 ;
Avances del CESOR, vol. 14, n° 17, 2017 ;
Estudios. Revista del Centro de Estudios Avanzados, n° 37, 2017 ;
Claves. Revista de Historia, vol. 3, n° 5, 2017 ;
Historia Crítica, n° 64, 2017 ;
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, vol. 44, n° 2, 2017 ;
Tensões Mundiais (Edição Temática): 100 anos da Revolução Russa, vol. 13, n° 24, 2017 ;
Estudos Históricos, vol. 30, n° 61, 2017.
3
Jordi Canal, Historia mínima de Cataluña, Madrid, Turner, 2015 ;
François Furet, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XXe siècle, Paris, Robert Laffont/Calmann-Lévy, 1995.
4
C. M. Herrera, E. Paliéraki (dir.), La Revolución Rusa y América latina: 1917 y más allá, (à paraître, 2019).
5
Dipesh Chakrabarty, Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton, Princeton University Press, 2000.
6
M. Broquetas, G. Leibner, « Presentación », Claves. Revista de Historia, vol. 3, n° 5, 2017, p. 4-5.
7
R. Melgar Bao, Historia del movimiento obrero latinoamericano. Historia de una clase subalterna, México, Alianza Editorial Mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1990, p. 224.
8
Evguenia Fediakova, « Revolución Rusa y América Latina: una promesa incumplida », Estudios Públicos, n° 149, 2018.
9
Frederich Katz, « El papel del terror en la revolución rusa y en la revolución mexicana », Istor, vol. 4, n° 13, 2003, p. 80-98.