La lecture du récent ouvrage d’Adam Crymble, depuis un pays quelconque du Sud global, est une invitation à prendre une position politique – si ce n’est déjà fait – sur nos pratiques académiques à l’ère numérique et dans nos propres contextes. Dès lors qu’elle fait naître en nous, ou renforce, la conscience des grandes différences entre une réalité et une autre – dues à des facteurs qui vont des écarts économiques et technologiques à la pluriculturalité propre à notre époque postcoloniale –, nous mesurons la nécessité de générer des histoires d’expériences locales dans un contexte mondial marqué par l’interconnexion des relations entre nos pratiques académiques – en l’occurrence historiographiques –, l’accès et l’utilisation de la technologie et l’exaspération inévitable ainsi que la perte de direction que le « désordre numérique » – pour paraphraser Anaclet Pons – provoque dans nos communautés.
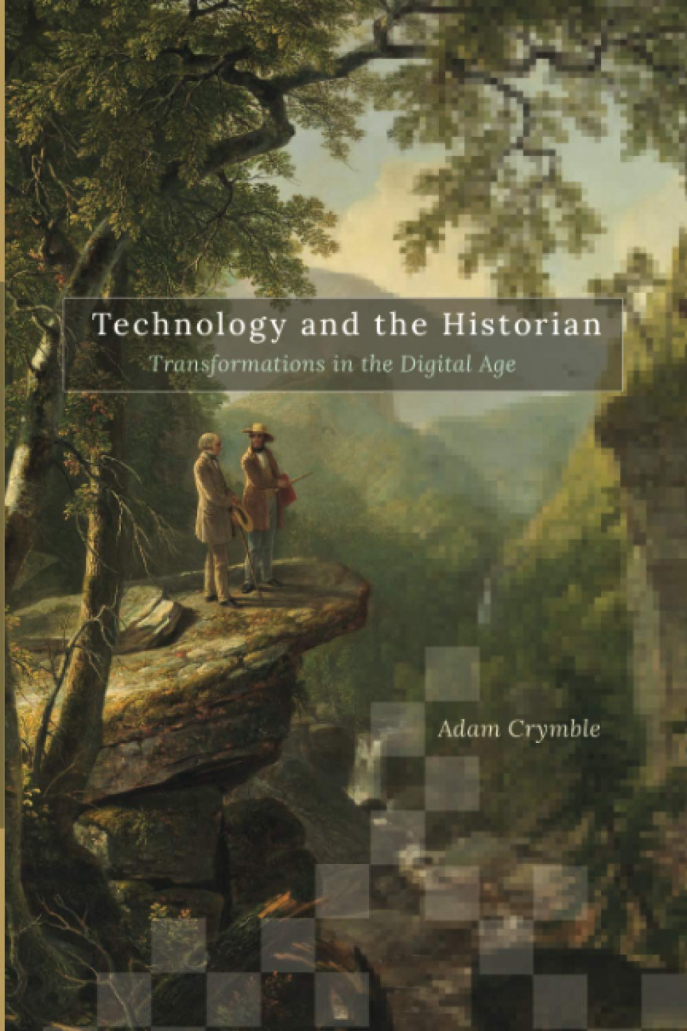
Adam Crymble, Technology and the historian: transformations in the digital age. Topics in the digital humanities, Urbana, University of Illinois Press, 2021.
Sur le modèle des « humanités numériques » dont il est question depuis longtemps dans des contextes disciplinaires assez larges, aux contours peu clairs, au sein des communautés historiennes de trois pays anglo-saxons – les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada –, des personnes influentes dans ces académies ont commencé, depuis la fin du XXe siècle et la première décennie des années 2000, à utiliser le terme d’« histoire numérique » pour désigner les activités menées par des « historiens numériques » tels que Roy Rosenzweig ou Dan Cohen. Cependant, l’expression d’« histoire numérique » se retrouve logée à la même enseigne que celle d’« humanités numériques » et frappée de la même diversité hétérogène de pratiques et d’approches, en l’occurrence pour les questions liées à la pratique historiographique dans le contexte du tournant numérique ; mais, une fois soumise à une critique épistémologique, elle s’avère être un terme contingent. L’idée d’histoire numérique s’est faite jour dans le contexte historique particulier de la numérisation intense de la vie quotidienne, et donc de la recherche universitaire, avec la popularisation des ordinateurs personnels (années 1980), l’utilisation publique de plus en plus répandue de l’internet (années 1990) et le processus continu de développement technologique qui permet l’accès, l’interaction (web 2.0) et la quasi-omniprésence des données numériques grâce aux appareils mobiles.
L’ouvrage de Crymble poursuit l’objectif de questionner la validité d’un terme – celui d’« histoire numérique » – dont il montre qu’il est abondamment utilisé dans un contexte historique et local spécifique mais qu’il ne tient pas la route faute de fondements conceptuels solides. Ainsi envisage-t-il l’histoire des relations entre la pratique académique de la communauté historienne et l’usage des technologies dans trois domaines très bien situés, où le concept d’histoire numérique est perçu comme un phénomène particulier et parallèle à l’émergence des humanités digitales. Cette approche critique est d’autant plus intéressante qu’elle est le fait d’un universitaire qui, malgré son jeune âge, est l’une des références importantes pour qui s’intéresse à l’élan donné au développement de la diffusion et de l’apprentissage des compétences numériques chez les historiens et les autres communautés académiques dans la dernière décennie à partir de la plateforme The Programming Historian.
Il n’est donc pas surprenant que la perspective de Technology and the Historian soit très différente de celle des livres sur l’histoire numérique qui ont été publiés en anglais ces dernières années, car il ne s’interroge pas sur la nature de l’histoire numérique, sur ce qu’elle fait, et ne s’emploie pas davantage à nous montrer comment elle le fait. Le livre de Crymble scrute les multiples processus de validation, par la pratique historiographique, de la technologie en général et de la technologie numérique en particulier, entre la seconde moitié du XXe siècle et le début du XXIe. En d’autres termes, il s’agit d’historiciser la relation entre technologie et historiographie pour comprendre comment on en est venu à parler d’« histoire numérique » dans la première décennie du XXIe siècle. Un des arguments centraux du livre résulte précisément de cela : il n’existe pas une seule histoire de la technologie et de l’historiographie, mais plusieurs, toutes étant situées. Et c’est en cela que réside une bonne part de l’intérêt du livre, dans la mesure où l’on finit par s’interroger sur l’histoire de sa communauté de savoirs locale eu égard à la technologie et à la manière dont elle gouverne tout à l’ère numérique.
Le simple énoncé de cet argument clé offre déjà de nombreuses pistes de réflexion. L’effort d’historiciser les différentes relations entre le développement de la technologie et la façon dont des espaces académiques situés dans les pays anglo-saxons ont vu certains aspects de leur pratique historiographique se transformer, par le seul fait qu’ils l’aient appliquée, a pour effet que la lecture de l’ouvrage de Crymble nous fait réfléchir à partir du Sud global. Qu’en est-il de l’utilisation de la technologie dans nos milieux académiques – et dans nos sociétés – et dans nos pays ? Car le livre de Crymble dresse un bilan de la façon dont les communautés académiques des pays anglophones (États-Unis, Canada et Royaume-Uni) en sont venues à adopter l’histoire numérique et nous donne ainsi une orientation qui, plus qu’un biais critiquable dans un monde globalisé, vu d’Amérique latine, d’Afrique ou d’une bonne partie de l’Asie, aboutit à ce que, j’insiste, nous en fassions une lecture politique. En réalité, s’il y a des différences notables dans la façon dont la technologie dans la pratique historiographique a été développée et utilisée dans les milieux académiques d’un pays anglo-saxons à l’autre – comme le démontre Crymble –, il y en a aussi entre ces pays et les réalités d’autres latitudes. Et il ne s’agit pas seulement d’une question de traditions et d’intérêts historiographiques, que l’analyse de Crymble documente très bien pour les académies américaines, canadiennes et britanniques, mais d’une multiplicité de situations qui vont de la dépendance technologique de pays ou de sociétés qui sont des consommateurs passifs de technologie, à la planification et au développement de politiques publiques culturelles qui ont trait à des problèmes si variés qu’ils vont d’une éducation à l’utilisation technologique depuis les niveaux de l’éducation de base jusqu’à la conservation du patrimoine et de la mémoire historique. Ce qui a souvent été défini comme la fracture numérique (digital divide) est, quand on l’envisage à partir de ce champ particulier qu’est la pratique historiographique, une réalité beaucoup plus complexe qu’on ne le pense et qu’on ne le perçoit à première vue.
Pour construire une histoire de la relation entre la technologie et l’historiographie, et de l’action transformatrice de la première sur la seconde, Crymble abandonne la voie facile de la narration linéaire. Les arguments qu’il déploie visent tous à caractériser les différentes manières dont la technologie a été insérée dans divers champs ou domaines de l’activité historiographique ; les chapitres qui composent le livre ont donc été conçus de manière indépendante l’un de l’autre et peuvent être lus séparément. Et c’est un parti pris judicieux en faveur d’une stratégie narrative qui empêche le lecteur de concevoir les étapes de l’émergence de l’histoire numérique comme un phénomène dont tous les aspects seraient parfaitement ou naturellement articulés. Au contraire, en optant pour cette stratégie argumentative fragmentée, Crymble montre à son tour à quel point les processus d’appropriation, dans la pratique historiographique, des différentes méthodologies, techniques et outils technologiques ont été fragmentaires et aléatoires. Ainsi, plutôt qu’un processus rationnel fondamental, la naissance de l’histoire numérique est-elle décrite ici comme contingente et dépendant d’une série de sites différenciés. Ces espaces de la pratique historiographique qui a été touchée par la technologie sont divisés en rubriques qui traitent de la recherche historique elle-même, de l’état des archives, de l’environnement de la salle de classe et de l’enseignement, de l’écosystème d’auto-apprentissage et des canaux de communication savante, et ces rubriques forment respectivement le cœur de chaque chapitre.
Dans le premier chapitre, Crymble aborde le mythe des origines de l’histoire numérique, ce démon qui hante tous ceux qui cherchent à rendre compte de la naissance d’un phénomène historique économique, social et culturel. Pour ceux qui ont écrit à partir d’une position proche du discours des humanités numériques, le projet linguistique de lemmatisation de l’œuvre de saint Thomas par le père Robert Busa JS à la fin des années 1940 est le travail pionnier qui a préfiguré le développement de l’histoire numérique. Cependant, ce chapitre sert à Crymble à relater la manière dont les historiens ont mis, au fil des décennies, la technologie informatique au service de la recherche. En prenant comme exemple central le Plain Flok of the South (1949) de Frank Owsley, il retrace l’histoire de la manière dont les ordinateurs – parfois utilisés comme de simples calculatrices – ont soutenu le développement de l’histoire quantitative sérielle dans les pays anglo-saxons. Connue sous le nom de nouvelle histoire économique, économétrie, cliométrie, histoire des sciences sociales ou histoire et informatique, l’histoire quantitative a connu une vie très productive entre les années 1940 et le début du XXIe siècle. Ainsi, si l’on veut retracer l’histoire de l’utilisation de l’ordinateur par les historiens, faut-il se tourner vers l’histoire quantitative plutôt que vers les origines de la linguistique informatique.
Cependant, si l’histoire numérique a vu le jour, ce n’est pas comme un moyen d’apporter de nouvelles réponses aux questions de recherche classiques de l’historiographie, mais comme une réaction au développement vertigineux de la technologie numérique à la fin du XXe et au début du XXIe siècle, et à tout ce qui s’est ensuivi, depuis l’utilisation massive d’ordinateurs personnels à la numérisation des sources d’information, en passant par la connectivité grâce à l’internet et à l’interaction à distance avec le Web 2.0. « Que faire d’un million de livres numérisés ? » – se demandait Gregory Crane en 2006 –, une quantité d’informations que nul ne pourrait lire au cours d’une vie, mais susceptible d’être « lue » et traitée par des machines. En d’autres termes, la numérisation de l’information a mis entre les mains des historiens et du public des données sur le passé qui étaient des représentations numériques non seulement de textes, mais aussi d’images, de vidéos et de sons. Les historiens numériques se sont alors attelés à la tâche d’essayer de comprendre comment ce type d’information pouvait être traité avec, par exemple, des outils d’analyse du langage naturel. C’est l’essor du macroscope, du big data et de la modélisation thématique. Mais la numérisation des informations portant sur le passé a rapidement montré ses limites et ses lacunes, ce qui fait l’objet du deuxième chapitre. Selon les procédés utilisés pour obtenir des représentations numériques de livres et documents historiques, ceux-ci peuvent contenir jusqu’à 145 erreurs par paragraphe de texte, ce qui rend impossible une analyse informatique fiable. La question qui se pose alors n’est pas de savoir ce qu’il faut faire d’un million de livres, mais comment s’assurer que les représentations numériques des collections historiques sont exactes et reflètent autant que possible la nature matérielle du document original auquel nous n’aurons probablement plus accès après le processus de numérisation. Considérant le fait que, dans les pays qui ont connu une numérisation massive précoce, on voit se constituer des mouvements en faveur de la révision des archives créées, il est nécessaire que, dans nos pays, où la numérisation des archives historiques ne fait que commencer, nous nous impliquions activement en faisant des propositions visant à garantir que ces nouvelles « archives intentionnelles » répondent aux exigences d’être des objets numériques qui représentent de manière fiable les objets matériels et conservent la mémoire à la fois des archives originales et des processus de numérisation.
Il me semble que cette approche critique des deux premiers chapitres est plus que suffisante pour vous inciter à lire le livre de Crymble. Même s’il ne reflète qu’une partie de l’histoire – l’expérience des pays anglophones –, il invite à la découvrir, à la décrire et à l’analyser depuis d’autres contextes. Mais il ne s’agit pas seulement de réfléchir aux effets de la numérisation de l’information et l’utilisation de la technologie sur notre manière d’accéder aux données de recherche, de les gérer et de les conserver, mais aussi de s’engager dans des projets collaboratifs et multidisciplinaires pour résoudre les problèmes d’accès aussi bien à l’information qu’à la technologie numérique. Un bon exemple est la manière dont nous avons utilisé la technologie numérique à l’école, en cherchant des moyens plus attrayants et novateurs de mettre à disposition non seulement des étudiants les données et le contenu dans des formats multimédias, mais aussi du grand public par la création de collections et d’expositions en ligne. Toutefois, il faut tenir compte des différences entre les systèmes éducatifs d’un pays à l’autre, ainsi que de l’accès aux ressources.
Un autre aspect important est de savoir comment nous pouvons faire accéder les collègues et les étudiants à un apprentissage qui leur permette de tirer parti des ressources numériques pour qu’elles bénéficient à la recherche, à l’enseignement et à la diffusion des connaissances historiques, étant donné qu’il existe peu d’espaces formels pour l’éducation aux compétences numériques dans les programmes universitaires et que ceux d’entre nous qui se sont aventurés dans les outils et les méthodologies numériques l’ont fait dans le cadre d’un apprentissage autodidacte. La nécessité de nous former au numérique en tant qu’historiens et humanistes a donné jour à ce phénomène que Crymble appelle « l’école invisible », rendue possible grâce à des initiatives personnelles d’universitaires qui produisent des tutoriels sur leur blog personnel – comme William Turkell – ou à la création d’équipes de travail sur des plates-formes collaboratives telles que The Programming Historian. Cette dernière a permis de relever des défis très intéressants, comme l’obligation d’accompagner d’une adaptation multiculturelle la traduction des contenus destinés à des publics autres qu’anglophones et dans des contextes autres que ceux de l’Europe occidentale.
Enfin, le livre de Crymble nous invite à abandonner l’utilisation de ce fourre-tout incohérent qu’est le terme « histoire numérique » et à définir plus précisément chacune des pratiques liées à la technologie qui interviennent dans la manière de raconter l’Histoire à l’ère numérique.









