Qu’est ce qui fait que des hommes, des femmes, de tous âges, parfois de très jeunes, sous toutes les latitudes, issus de milieux sociaux et culturels extrêmement variés, des riches comme des pauvres, des nantis comme des opprimés, « basculent » brutalement dans une violence inouïe, jusqu’alors insoupçonnable où la mise à mort du voisin devient une tâche quotidienne. Les exemples récents ne manquent pas. La violence génocidaire qui s’est abattue sur le Rwanda entre avril et juillet 1994 a causé la mort de plus de 800 000 Tutsis. Méthodiquement traqués, regroupés, séquestrés et assassinés par centaines par des hommes et des femmes hutus, armés de machettes ou de fusils. Des anciens voisins, pour la plupart, voire des membres de familles alliées, tuèrent sans hésiter ceux qu’ils saluaient encore quelques temps auparavant, ou considéraient comme du même sang lorsqu’il s’agissait de couples mixtes. Pourtant, malgré cette proximité antérieure, rien ne semble avoir pu arrêter cette fureur assassine1. Dans le principal hôpital psychiatrique du Rwanda, dans la banlieue de Kigali, où jusqu’alors soignants hutus et tutsis partageaient un même dévouement à l’égard de l’ensemble des patients, la sélection fut tout aussi impitoyable, et ce dès les premières heures du génocide. Les Tutsis, patients et soignants, furent pourchassés, regroupés puis assassinés par des médecins, des infirmiers et des aides-soignants soudainement convertis en tueurs2. Cette violence meurtrière s’est déployée pendant plus de cent jours, sans répit, du lever au coucher du soleil, et tout au long des nuits, se déchainant indistinctement sur les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être tutsis. Tous, jusqu'aux derniers, devaient mourir. Aucun sanctuaire ne pouvait les protéger. Les églises, les hôpitaux, les écoles se transformèrent en lieu d'abattage systématique. Certaines femmes tutsies furent épargnées, mais ce ne fut que dans une volonté de laisser survivre celles qui, mutilées après d’atroces violences sexuelles, conserveraient à jamais l’empreinte de leurs bourreaux3.
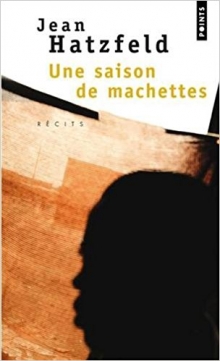
Jean Hatzfeld, Une saison de machettes, Paris, Le Seuil, 2003.
Ces tueurs et ces tueuses, car de très nombreuses femmes furent impliquées dans les massacres4, n'étaient pas des assassins avant les faits, ni même des idéologues, encore moins des combattants ou des combattantes. Aucun n'eut a bénéficier d'une formation théorique ou pratique : tuer en masse ne s'enseigne pas, cela s'apprend sur le tas. C'est tout au moins ce que rapportent la plupart de ces bourreaux, qui s'étonnent eux-mêmes du nombre de victimes qu'ils ont personnellement « traitées », autrement dit tuées, et fait disparaître5.
Deux décennies plus tôt, au Cambodge, entre avril 1975 et décembre 1979, près de deux millions d'individus ont été assassinés par le régime des Khmers Rouges. Méthodiquement, sans état d'âme, de jeunes Khmers, souvent paysans, et pas forcément des brutes, tuèrent à la chaîne d'autres Khmers sans défense, par dizaines, par centaines, parfois jusqu'à l'épuisement. L'élimination de plus du tiers de la population en quatre ans reste une prouesse macabre dont se flattent encore les anciens dirigeants. À l'instar de Duch, le directeur du tristement célèbre S-21, le centre de détention de Phnom Penh où plus de 15 000 cambodgiens furent torturés avant d'être exécutés, qui, lors de son procès en 2010, affirmait fièrement que si les Khmers rouges avaient gagné, il serait un héros aujourd'hui et non un prévenu contraint de comparaître devant ses juges6.

Photo portraits arrivants à S-21, Musée du génocide de Tuol Sleng.

Rithy Panh, Œuvres.
Malgré les acquis d'une justice internationale de plus en plus réactive et les condamnations parfois sévères des principaux responsables politiques de ces massacres, la liste des crimes génocidaires ne cesse de s'allonger. Aujourd'hui, les troupes de l'Organisation État Islamique pratiquent une épuration sans précédent de leurs supposés opposants et de leurs proches à l'intérieur des territoires qu'ils ont conquis, comme l'atteste les témoignages des survivants dans les villes récemment libérées comme Mossoul et Palmyre. La violence génocidaire déborde largement les frontières de ces territoires, et tente de s'étendre partout, dans l'ensemble du Moyen Orient, en Afrique, en Asie et bien sûr en Europe et aux États-Unis. En Syrie, le régime du président Bachar El Assad ne cherche même plus à dissimuler les preuves de ses exactions : gazages des populations, meurtres de masse de civils, transformation de centres de détention en centre d'extermination constituent les armes quotidiennes d'un régime déliquescent mais prêt à tout pour garantir sa survie7.
À la différence des guerres et des autres conflits armés, il s'agit ici de tuer en très grand nombre, sans procès et à la chaîne, des civils désarmés, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, jusqu'aux bébés, non pas pour ce qu’ils pensent ou ont fait, mais simplement pour ce qu'ils sont. Ou plus exactement, pour ce que leurs bourreaux disent qu'ils sont. Et c'est précisément cette spécificité qui caractérise au mieux la nature de la violence génocidaire. Sur cette question, la littérature scientifique – juridique, historique, sociologique, politiste, anthropologique, psychanalytique et philosophique – abonde depuis la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis d'abord, et désormais dans de très nombreuses universités de par le monde, les Genocide Studies sont devenues des disciplines à part entière, réunissant des chercheurs d'horizons très différents avec une approche nécessairement pluri-disciplinaire. Il est impossible de citer ici, tant leur nombre devient conséquent, les auteurs et les courants de pensée les plus importants qui aujourd'hui nous permettent d'avoir une connaissance plus fine des processus socio-politiques et historiques qui concourent à la mise en œuvre de politiques d'extermination. Ces recherches se sont pour la plupart progressivement extraites du carcan juridique qui, sous la plume de Raphael Lemkin8, avait donné naissance à la notion de génocide au décours de la seconde guerre mondiale, pour envisager les massacres de masse sous un angle comparatiste. En France, on doit à Jacques Semelin d'avoir le premier posé les bases d'une analyse rigoureuse des massacres de masse fondée sur une distinction précise entre les massacres qui visent la domination d'une population – où l'on tue en masse pour soumettre – et ceux qui visent son éradication complète et définitive – où l'on tue pour anéantir9.
Toutefois, l'analyse des conditions historiques et politiques, la mise en évidence du rôle joué par l'endoctrinement et l'idéologie, la force des antagonismes et des racismes antérieurs, tout comme l'étude minutieuse des chaînes de commandement qui enchevêtrent les actes et les décisions de l'ensemble des protagonistes impliqués, du donneur d'ordre à l'exécutant final, laissent souvent en suspens la question cruciale de la motivation et de la conscience du tueur de masse. Qui sont ces hommes et ces femmes qui deviennent des tueurs de masse ? Comment bascule-t-on dans l'horreur, au point d'en faire son quotidien ? N'y-a-t-il pas en chacun de nous une force intérieure qui empêcherait tout être réputé « normalement constitué » de tuer des innocents sans défense ?
L’on pourrait évoquer longuement les différentes conceptions théoriques qui ont cherché à expliquer de quelle(s) manière(s) des hommes ordinaires pouvaient devenir selon les circonstances des tueurs de masse10. La notion de banalité du mal introduite par Hannah Arendt11 pour souligner le caractère odieusement ordinaire de ces tueurs et de leurs commanditaires a été maintes fois reprise et développée dans les recherches ultérieures sur les tueurs de masse. Qu'il s'agisse de la description minutieuse des membres du 101e bataillon de réserve de la police allemande impliqués dans l'assasinat direct de plus de 35 000 juifs12, hommes, femmes, enfants, vieillards, ou des théorisations psycho-sociologiques sur les exécuteurs du troisième Reich13, ces travaux renforcent l'effroyable constat de la philosophe allemande et confirment la stupéfiante complicité d'hommes banalement ordinaires glissant progressivement vers le meurtre de masse. Toutefois, aucune de ces approches ne parvient à résoudre l'insondable énigme de la conscience des meurtriers.

Adolf Eichmann en avril 1961 lors de son procès à Jérusalem.
Or, plus encore que les travaux scientifiques, souvent ignorés du grand public, se sont sans doute les représentations théâtrales et cinématographiques qui ont le plus contribué à donner un visage à cette banalité du mal et une intériorité psychique à ces tueurs anonymes. C'est à travers ces mises en scène, notamment celles qui cherchent à pénétrer l'intimité de ceux qui vont tuer, ou qui, déjà, ont tué, que nous parvenons parfois à les imaginer, voire à nous interroger sur ce que nous aurions fait à leur place14. Le théâtre, comme le cinéma, nous offre cette incroyable performance de nous laisser, impuissant, assister à la transformation d'un homme ordinaire en tueur. Or, la figure la plus fréquente, et souvent la plus effrayante, celle que l'on croise le plus souvent dans l'histoire du théâtre classique ou du cinéma contemporain, n'est sans doute pas la plus fidèle. Le puissant ressort dramatique qui fait du tueur de masse un homme livrant un combat intérieur plus ou moins douloureux avant de s'abandonner dans une défaite de la conscience à ses plus bas instincts, me paraît bien trompeur. Les choses sont souvent bien plus simples. Le règne de la perversion n'est pas toujours nécessaire. C'est pourtant ce que certaines oeuvres ont essayer de faire en installant dans l'imaginaire contemporain la figure du pervers comme archétype du bourreau sanguinaire.
Sorti en 1969, le célèbre film Les Damnés de Luchino Visconti a connu un succès retentissant. Point d'orgue d'une introspection occidentale sur le retour de la barbarie au cœur du processus de civilisation, le film offrait une effrayante métaphore de la montée du nazisme à travers la décadence d'une famille de la haute bourgeoisie allemande. Le thème central articulait l'accession au pouvoir des nazis avec la libération progressive des instincts les plus pervers de tous les protagonistes, jusqu'à corrompre chaque membre de cette famille. Pour l'édition 2016 du Festival d'Avignon, le metteur en scène Belge Ivo Van Hove a repris le scénario de Visconti et monté dans la Cour d'honneur du Palais des papes une version encore plus dérangeante où, derrière la mise en cause du nazisme, se sont toutes les barbaries contemporaines qui sont dénoncées. La résonance avec l'actualité terrifiante de cette année même année 2016, ponctuée d'attentats meurtriers et de changement politiques majeurs, est immédiate. On y retrouve la montée des extrémismes de tous bords, où la glorification de la haine de l'autre s'apprête à régner sans partage sur des terres autrefois démocratiques. On éprouve dans sa propre chair le poison de la perversion, on le sent s'infiltrer lentement en chacun, jusqu'à la scène finale où les spectateurs se trouvent à leur tour dans le viseur des tueurs.

Les damnés, Luchino Visconti, affiche du film, 1969.
La presse ne s'y est pas trompée. Les critiques ont unanimement salué l'événement : « un choc » pour Télérama, « une pièce monstre », « hallucinante et dérangeante » pour Le Figaro, « dément et démoniaque » le dévoilement de « l'atroce aptitude humaine à la barbarie » pour Le Monde. Tous s'accordent sur la performance du metteur en scène et des acteurs de la Comédie française, y compris ceux qui réprouvent habituellement l'exhibition théâtrale et cette sorte de brutalité. Nombreux font part du malaise ressenti devant le voyeurisme que le metteur en scène impose aux spectateurs, mais Ivo Van Hove est partout crédité d'avoir su faire vivre devant un public stupéfait cette terrifiante plongée dans la barbarie. Rien n'est épargné, la perversion, l'inceste, la décadence, l'ignominie, la cupidité, la bassesse jusqu'au meurtre le plus sanguinaire, pour ne pas dire le plus sanglant. Les corps se vautrent avec la même passion morbide dans la luxure et dans le sang. Plus rien ne semble pouvoir arrêter cette descente infernale dans laquelle la mort, pourtant inéluctable, n'apparaît plus comme le pire, tant le pire semble déjà là, bien avant, depuis la première transgression.

Les Damnés, pièce d'Ivo Van Hove, présentée au festival d'Avignon en 2016.
Dans la mise en scène d’Ivo Van Hove, comme dans le film de Visconti, le point de bascule est atteint très tôt, dès la première transgression pourrait-on dire. Qu'il s'agisse de la mort du patriarche ou du désir incestueux à peine réprimé, la théâtralisation de cette transgression inaugurale préfigure une suite infernale où tout, vraiment tout, dans l'horreur devient possible, puisque désormais, tout est permis. L'équation proposée est à la fois simple et glaçante. La première transgression libère les passions les plus violentes et malsaines et ouvre la voie à une jouissance sans limite faisant de l'autre à la fois l'instrument et l'objet d'une haine dévastatrice. Une haine glaçante, qui fait de la jouissance perverse le moteur d'une abomination d'autant plus effrayante qu'elle serait autorisée. « Qui donc renoncerait à une telle jouissance en l'absence de toute sanction et de toutes représailles ? », nous laisse entendre ici chaque protagoniste. Pour autant, si cette mise en abîme des pires passions humaines nous terrifie jusqu'à la sidération, si encore l'horreur nous devient effroyablement palpable, c'est avant tout parce que le cinéaste, comme le metteur en scène, ont tous deux su, à leur manière, offrir au spectateur une représentation de l'irreprésentable de la destruction génocidaire. L'un comme l'autre ont transposé l'avènement d'un ordre totalitaire et génocidaire dans le double registre de la décadence de la civilisation et de la psyché des passions humaines les plus viles. Mais si la transposition est effectivement saisissante, elle n'en demeure pas moins fondamentalement étrangère à la réalité et à l'organisation des crimes de masse.
Car l'univers génocidaire n'est justement pas un monde où tout est possible. Au contraire même. Tout y est ordre et méthode, recherche de productivité, amélioration des conditions de travail afin que les tueurs continuent de tuer et accélèrent leur cadence. L'ensemble du processus répond à un séquençage parfaitement rodé. De la sélection des victimes à leur regroupement et à leur exécution, jusqu'à la gestion méthodique des restes, c’est-à-dire de leurs dépouilles, de leurs objets, récupérés, ou encore des valeurs qui leur ont été dérobées. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé à l'arbitraire de chacun et encore moins à la satisfaction de quelconques pulsions sadiques qui ne manqueraient d'ailleurs pas de s'émousser à force de répétition au risque de freiner la productivité. Seul l'ordre prévaut. Toutes les sociétés génocidaires procèdent ainsi, compartimentant les populations, désignant ceux qui mourront nécessairement et ceux qu'il faut au contraire protéger15. Chaque compartiment à ses propres règles, et tout n'y est justement pas possible : dans celui .de la mort, la sélection est impitoyable, mais ce qui se passe à l’entrée importe moins tant seul compte la destruction finale. Dans l'autre, tuer est interdit et passible de lourdes peines. Seul le transfert d'un compartiment à l'autre au motif d'une trahison autorise la mise à mort d'un individu jusqu'alors épargné.
Les récits des bourreaux ordinaires témoignent tous de cette même réalité : tuer en grand nombre exige une organisation complexe qui ne saurait répondre aux passions intimes de chacun. À ce titre, la mort n'a résolument pas le même statut pour les bourreaux et les victimes. Si pour les premiers, elle circonscrit l'essentiel de leur horizon subjectif, elle n'est, pour les seconds, qu'un encombrant résidu qu'il faut gérer16. Ces tueurs énoncent tous la même chose, à leurs yeux la mise à mort est un long processus qui débute dès la première minute de la rencontre avec l'ordre génocidaire et qui s'achève à l'issue de leur intervention. Une participation ponctuelle, clament-ils, dont ils ne sauraient porter la responsabilité. Ils se trouvent simplement au bout de la longue chaîne du processus de destruction. Rien de plus, assurent-ils avec une déconcertante conviction. On aurait tort de voir dans cette justification l'expression d'une pitoyable défense plaidant la dilution de l'acte de tuer dans l'ensemble de la chaîne de commandement. Il serait tout aussi erroné de reproduire ici l'interprétation classique, aujourd'hui encore tant de fois assénée, selon laquelle la soumission à l'autorité et l'obéissance aveugle rendrait compte de ce qu'ils nous disent17. Car de façon bien plus simple et plus assumée, ces hommes et ces femmes considèrent que donner l'ultime coup de gourdin, appuyer sur la gâchette, ou enfoncer le couteau dans la gorge est un geste tellement mécanique, précis et rapide qu'il en devient anodin et n'imprime plus leur mémoire. Seule la répétition du geste, jusqu'à l'épuisement, semble inscrire une trace mnésique chez ces tueurs. Leur mémoire n'est pas pour autant suspendue, leurs sensations ne sont pas anesthésiées. À l'inverse, c'est très précisément tout l'environnement de la mise à mort – c'est-à-dire, l'odeur, les cris, les hurlements des chefs, les projections, le sang, les corps qu'il faut charrier puis ensevelir et enfin l'épuisement physique – qui façonne l'expérience subjective qu'ils en ont. La mort, ou plus exactement son résidu c'est-à-dire le corps mort, ne se présente à eux que sous la forme de la contrainte technique qu'il leur impose et de la difficile gestion de son abondance. « Un problème que rencontrent toutes les municipalités », dira Duch, le directeur du centre S-21 de Phnom Penh, au cours de son procès devant les Chambres extraordinaires auprès des tribunaux cambodgiens. Interrogé sur les raisons qui le poussaient à inscrire la mention « à détruire » en bas des confessions manuscrites des détenus obtenues après des jours et des jours de torture, il n’hésitera pas à se présenter comme un simple responsable municipal chargé de la sécurité et du bien-être des populations qu’il avait sous sa responsabilité. « Pour garder une ville propre, il faut bien s'occuper des déchets », ajouta-t-il, avec arrogance ; « Eh bien chez nous, sous les Khmers rouges, il y avait des hommes et des femmes à traiter parmi les déchets, cette particularité ne change rien à la contrainte logistique de la gestion municipale des déchets ! ».
L'hypothèse d'une descente infernale dans les tréfonds de la perversion humaine avait au moins le mérite de nous laisser le faible espoir de voir ces bourreaux renoncer un jour par lassitude, par épuisement de leur jouissance dans l’inlassable répétition de la même séquence. La réalité est finalement encore plus terrifiante, parce que bien moins exotique. Personne ne se vautre dans la luxure, personne ne s'abreuve du sang des victimes, personne, enfin, ne se sent autorisé à franchir une barrière morale autrement interdite. Car pour ces tueurs, aucune barrière ne les freine dès lors que leurs victimes appartiennent au compartiment voué à la mort. Chaque matin, ils savent qu'ils vont de nouveau partir tuer. Chaque soir, ils savent que le lendemain sera identique. Alors ils se préparent. Ils réfléchissent pour savoir comment éviter les ampoules qu'on attrape en appuyant des heures durant sur une gâchette ou en tenant un lourd gourdin. Ils discutent avec leurs chefs pour trouver des moyens plus adaptés pour transporter les cadavres, pour gérer les restes, c’est-à-dire les corps, les objets, et pour finir au plus vite leur journée de labeur avant de recommencer la suivante.
Bien loin de la luxure et de la perversité théâtralement décrites par Luchino Visconti et Ivo Van Hove, ces hommes et parfois ces femmes, font de la façon la plus ordinaire un travail quotidien qui n'a rien d'ordinaire. Et c'est cela l'horreur la plus absolue. Est-il finalement possible de transposer dans les arts vivants cette déconcertante banalité qui caractérise tant de bourreaux ordinaires ? Le cinéaste américain Joshua Oppenheimer a précisément tenté de relever ce défi dans son film largement salué par la critique « The Act of Killing »18. En combinant une approche documentariste et une œuvre de fiction, Oppenheimer revient sur le massacre de plus d'un million d'opposants politiques en Indonésie en 1965. Le parti pris est audacieux puisqu'il consiste à faire rejouer des scènes de massacre et de torture devant la caméra par les auteurs de l'époque. Un demi siècle après les faits, ces hommes n'hésitent pas à reproduire leurs gestes : terroriser la foule, sélectionner les victimes, les torturer puis les exécuter. Se sachant filmer, ils cabotinent avec délectation. Exagérant les mimiques de cruauté, ils s'appesantissent longuement sur les supplices qu'ils infligeaient à leurs victimes. Tout, chez ces hommes insensibles au moindre remord ou à l'ébauche d'une culpabilité, donne la nausée au spectateur. Et c'est peut-être en ce point que le filme perd en crédibilité ce qu'il gagne en effroi. À l'évidence ces hommes sont effrayants et effroyables. À l'évidence, ils ne craignent ni la justice des hommes, ni le discrédit que produit leurs gesticulations. Mais pour autant, nous apprennent-ils quelque chose de la transformation d'un homme ordinaire en tueur de masse ? Rien n'est moins sûr. Eux même le reconnaissent bien volontiers, tous étaient déjà des voyous et des assassins avant d'être enrôlés dans les polices parallèles du régime. C'est d'ailleurs pour leur savoir-faire qu'ils furent recrutés. La plupart ont continué à tuer après les événements au sein de différentes mafias locales.

The Act of Killing, film de Joshua Oppenheimer, 2013.
À ce titre, si ces hommes peuvent aujourd'hui encore se targuer de leurs macabres prouesses avec la même jubilation qu'au moment des faits, c'est précisément parce que se sont toujours des tueurs en exercice. Le film de Joshua Oppenheimer est donc un témoignage exceptionnel sur l'impunité qui couvre encore les exactions perpétrées par le régime du Général Soeharto et sur les brutes qui les ont commises, mais il ne nous dit rien sur ces situations bien plus fréquentes où des hommes et des femmes, bien moins convaincus que les tueurs de Soeharto, acceptent néanmoins de devenir les exécutants / exécuteurs dociles d'une implacable machine de mort. Si les arts vivants acceptent un jour de rendre compte et de représenter cette réalité là, alors il leur faudra sans doute renoncer à la théâtralisation de l'acte de tuer au profit de l'autopsie méticuleuse de ses conditions intimes de possibilités.
Notes
1
Hélène Dumas, Le Génocide au village : le massacre des Tutsis du Rwanda, Paris, Le Seuil, 2014.
2
Magnifique Neza, La Double folie. Impact du génocide des Tutsis sur l’hôpital Neuropsychiatrique de Ndera au Rwanda, Mémoire de master 2, EHESS, 2016.
3
Voir notamment Stéphane Audoin-Rouzeau, Une Initiation. Rwanda (1994-2016), Paris, Le Seuil, 2017 et Émilienne Mukansoro, Psychothérapie de groupe, Génocide et violences sexuelles. Accès à la parole et résilience au Rwanda, Paris, Mémoire du diplôme de l’EHESS, 2016.
4
Voir l'excellent documentaire de Violaine Baraduc et Alexandre Westphal, À mots couverts.
5
Jean Hatzfeld, Une saison de machettes, Paris, Le Seuil, 2003.
6
Richard Rechtman, « Reconstitution de la scène du crime. À propos de Duch, le maître des forges de l'enfer, de Rithy Panh », Étvdes. Revue de Culture Contemporaine, 2011, p. 320-339.
7
« Près de 13 000 détenus ont été tués dans une prison syrienne en cinq ans, selon Amnesty », Amnesty International, compte-rendu, paru dans Le Monde, 7 février 2017.
8
Raphaël Lemkin, Qu'est-ce qu'un génocide ?, (1944, ed. La Rochelle), Éditions du Rocher, 2008.
9
Jacques Semelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2005.
10
Richard Rechtman, « Que ressentent les génocidaires lorsqu'ils tuent ? », in J-J. Courtine (dir.), L’Histoire des émotions. Vol. 3 : De la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2017, à paraître.
11
Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, (1966), 2002.
12
Christopher R. Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, (1992), 2006.
13
Harald Welzer, Les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, Paris, Gallimard, (2005), 2007.
14
Voir à ce propos l'audacieux essai d'auto-fiction-biographique de Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, Paris, Le Seuil, 2013.
15
Abraham de Swaan, Diviser pour tuer. Les régimes génocidaires et leurs hommes de main, Paris, Le Seuil, 2016.
16
Richard Rechtman, « Faire mourir et ne pas laisser vivre. Remarques sur l'administration génocidaire de la mort », Revue française de psychanalyse, vol. 80, n° 180, 2016, p. 136-148.
17
Sur la soumission à l'autorité voir Stanley Milgram, Soumission à l'autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974. Pour une critique de l'utilisation abusive de l'expérience de Milgram pour rendre compte de la transformation d'hommes ordinaires en tueurs de masse on pourra se reporter à Rechtman, op. cit, 2016.
18
Joshua Oppenheimer, The Act Of Killing, long métrage Danois, Norvégien, Britannique, 2013.
Bibliographie
Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, Paris, Gallimard, (1966), 2002.
Stéphane Audoin-Rouzeau, Une Initiation. Rwanda (1994-2016), Paris, Le Seuil, 2017.
Pierre Bayard, Aurais-je été résistant ou bourreau ?, Paris, Le Seuil, 2013.
Christopher R. Browning, Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne, Paris, Les Belles Lettres, (1992), 2006.
Hélène Dumas, Le Génocide au village : le massacre des Tutsis du Rwanda, Paris, Le Seuil, 2014.
Jean Hatzfeld, Une saison de machettes, Paris, Le Seuil, 2003.
Raphaël Lemkin, Qu'est-ce qu'un génocide ?, (1944, ed. La Rochelle), Éditions du Rocher, 2008.
Stanley Milgram, Soumission à l'autorité, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
Émilienne Mukansoro, Psychothérapie de groupe, Génocide et violences sexuelles. Accès à la parole et résilience au Rwanda, Paris, Mémoire du diplôme de l’EHESS, 2016.
Magnifique Neza, La Double folie. Impact du génocide des Tutsis sur l’hôpital Neuropsychiatrique de Ndera au Rwanda, Mémoire de master 2, EHESS, 2016.
Richard Rechtman, « Que ressentent les génocidaires lorsqu'ils tuent ? », in J-J. Courtine (dir.), L’Histoire des émotions. Vol. 3 : De la fin du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2017, à paraître.
Richard Rechtman, « Faire mourir et ne pas laisser vivre. Remarques sur l'administration génocidaire de la mort », Revue française de psychanalyse, vol. 80, n° 1, 2016, p. 136-148.
Richard Rechtman, « Reconstitution de la scène du crime. À propos de Duch, le maître des forges de l'enfer, de Rithy Panh », Étvdes. Revue de Culture Contemporaine, 2011, p. 320-339.
Jacques Semelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Paris, Le Seuil, 2005.
Abraham de Swaan, Diviser pour tuer. Les régimes génocidaires et leurs hommes de main, Paris, Le Seuil, 2016.
Harald Welzer, Les Exécuteurs. Des hommes normaux aux meurtriers de masse, Paris, Gallimard, (2005), 2007.









