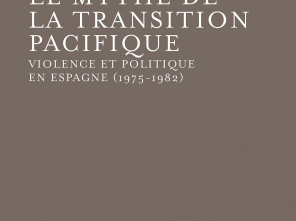À propos du livre de Johann Michel, Devenir descendant d’esclave. Enquête sur les régimes mémoriels (Rennes, PUR, 2015)
Une fois le tabou rompu, une fois que les mémoires souterraines réussissent à envahir l’espace public, d’autres se saisissent de cet enjeu de mémoire, et l’instrumentalisent à leurs fins.
Michael Pollak, « Mémoire, oubli, silence », 1993 [1989].
[…] les enjeux d’un débat qui […] sous des formes diverses, ne cesse de parcourir les sciences sociales nécessairement (ou fatalement) partagées entre des ambitions explicatives positives et un projet interprétatif qui fait place aux spécificités du discours et du récit dans une visée qui demeure, dans notre cas, tout aussi objectivante.
Dominique Blanc et Daniel Fabre1, Le Brigand de Cavanac. Le fait divers, le roman, l’histoire, 2015 [1982].
La parution du livre de Johann Michel, Devenir descendant d’esclave. Enquête sur les régimes mémoriels, participe du débat actuel sur la fabrication de mémoires créatrices du passé de l’esclavage. Dans le prolongement d’un article que j’ai publié, « Le négrier en ancêtre fondateur : Francisco Felix de Souza “grand négociant et bâtisseur” à Ouidah2», mon propos n’est pas de présenter un compte-rendu du texte de Michel, mais d’interroger certains arguments abordés par l’auteur à l’aune de la problématique du lien entre mémoires instituées et mémoires « incorporées » de ce passé.
Devenir descendant d’esclave est un ouvrage bien documenté sur l’histoire (par ailleurs très récente) d’un processus d’édification dans la sphère publique française de plusieurs registres commémoratifs du système esclavagiste : abolitionniste, anticolonialiste, victimaire. Le texte questionne la mise en souvenir officiel de la fin de ce système en métropole et dans d’anciennes colonies devenues par la suite des départements ou territoires d’outre-mer, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion. Il se compose de dix chapitres qui, à travers une reconstitution à la fois diachronique et thématique, passent en revue l’émergence et la cohabitation de « grammaires » mobilisatrices et procédurales ayant joué, selon les cas et les moments, un rôle de corollaire ou d’obstacle à la superposition des divers « régimes mémoriels » du passé esclavagiste. Selon Michel, ces régimes ont aussi gouverné (ou tenté de le faire) les cadres institutionnels de conflits autour du statut de ceux qui, de nos jours, se revendiquent être les descendants des esclaves déportés d’Afrique dans les plantations de territoires aujourd’hui français. À partir de la violence revendiquée de fait comme « matricielle » infligée à leurs ancêtres, les descendants-porteurs d’une mémoire latente de l’époque fondatrice de l’esclavage mettent en œuvre dans des espaces publics une praxis de son actualisation. La plasticité discursive de cette mémoire in fieri semble être désormais assumée par ces descendants comme l’un des facteurs nécessaires à la réalisation d’un devoir de réparation morale et psychique ainsi que d’affirmation identitaire. Ici, les entités vaincues du passé fondent des narrations où le statut de victime d’une histoire tragique se propage et se transmet à travers les siècles.
En résumant un des propos avancés par Jean-Luc Bonniol dans sa préface du texte, c’est sur « la reconnaissance d’une ancestralité » (p. I) que s’adosse « l’élection du traumatisme comme souvenir à cultiver (apte donc à la patrimonialisation) » (p. III). À ce titre, Bonniol voit dans ce mouvement de redéfinition d’une ancestralité traumatique « le postulat ethno-psychiatrique d’un trouble psychique transgénérationnel […]. On perçoit là de manière remarquable comment cette labellisation est construite : elle ne correspond pas simplement à un état, mais elle est le produit d’un processus : on ne naît pas descendant d’esclaves, mais on le devient » (p. VII). On le devient donc, pourrions-nous ajouter, à cause de la revendication du fait historique qu’on l’est et du fait présent que, dans les espaces publics et institutionnels, on peut ou on doit l’être encore. Le « nous » contemporain des descendants, qui militent pour une reconnaissance officielle de leur ancestralité traumatique et patrimoniale, hérite donc d’un « on » primordial et pérenne qui fonde et décline leur identification à des aïeux. Pourtant, loin de tout déterminisme, le fait qu’on le devienne implique – il me semble – qu’on puisse aussi ne pas le devenir et donc ne pas ou ne plus l’être.

Depuis plusieurs décennies, de nombreux chercheurs en sciences sociales étudient, à une échelle mondialisée, la circulation d’une mémoire présentée (par ses détenteurs et par eux-mêmes) comme traumatique, portée par les « descendants » d’esclaves. Dans les divers contextes observés, une telle mémoire est véhiculée par des discours institués aptes à modeler l’imagination cérémonielle qui, sur des scènes publiques, rend cette mémoire ostensible. En puisant dans les tactiques immédiates d’un présent patrimonial à saisir, ces usages du trauma font appel à la fois à une longue durée historique et à sa transformation en récit qui se veut fondateur. Les écrits et les manifestations officielles, tout comme les ritualisations, les narrations orales et les interprétations personnelles, peuvent aussi être des formes indéfinies et dynamiques de relation au passé, de contradictions et d’incompréhensions entre des competing legacies3qui interviennent dans les luttes autour de l’institution d’un héritage4. Si, comme certains chercheurs le pensent5, un tel héritage procède de la transmission/reconstitution méta-générationnelle d’un souvenir latent, une telle problématique est-elle également agissante dans les discours de ceux qui sont susceptibles d’être reconnus ou de se reconnaître comme des descendants d’esclavagistes ? De quelles manières les faits du passé sont-ils utilisés comme une matrice de sens à la fois disponible (déjà là) et élective (à venir) parmi d’autres ?
À travers le détour par la situation mémorielle apparemment « incomparable » propre à des descendants d’esclavagistes que j’ai étudiée à Ouidah dans le Bénin méridional, je voudrais interroger d’une manière critique l’hypothèse d’une transmission psychique transgénérationnelle du trauma que Michel prend en compte et qu’il intègre à sa lecture inhérente au contexte français du phénomène.
Des mémoires « durcies » et poreuses ?
Entre faits hérités du passé et usages affirmés d’une filiation, à cheval entre ressources et blessures identitaires, une ambiguïté rhétorique et morale peut produire des « mémoires durcies » de l’expérience historique de l’esclavage. Par cette formule de « mémoires durcies », Michael Pollak définissait la stabilisation de visions du passé de la Shoah issues de rapports de force entre plusieurs « interprétations contrastées » ou en concurrence6. À ce propos, parmi les passages que j’ai trouvés significatifs de la réflexion de Michel, j’ai été particulièrement intéressé par l’hypothèse-constat d’un « consensus équivoque » (p. 54) qui parfois relie des discours en situation (ou en régime ?) de concurrence. Un tel consensus semble être également à l’origine d’un « surplus de sens » (p. 69), circulant dans les arènes publiques de la compétition et de la gouvernance mémorielles, qui n’est pas sans rappeler la formule « logique du cumul7» que Marc Augé a utilisée pour définir, sur des terrains ouest-africains, des milieux religieux confrontés à des défis syncrétiques8.
De nos jours, à une échelle désormais globalisée, les cérémonies commémoratives du passé de la traite négrière sont présentées par leurs acteurs publics comme une riposte et un remède au silence imposé et transmis traumatiquement aux descendants des esclaves. Le rapport irrésolu entre la continuité de la matrice et ses usages intermittents, entre matrice agissante et/ou agie, caractériserait « l’émergence d’une nouvelle mémoire de l’esclavage » (p. 48). Ici, l’adjectif « nouvelle » suggère l’avènement d’une mémoire dont, à partir de ce qui est enfoui, on fabrique le caractère inédit. Comme toute forme de réminiscence ou de souvenir, cette mémoire dite nouvelle enclenche aussi ses propres oublis. Par exemple, à propos de l’un des changements de registres discursifs qu’il analyse, Michel remarque que « les luttes ne sont plus pensées dans une matrice nationaliste antillaise, mais dans une matrice multiculturelle qui se veut, dans son intention, soluble dans le modèle de la citoyenneté à la française » (p. 93). La mémoire de la violence esclavagiste comme souche/scène primordiale est donc pensée et vécue dans son devenir ; elle agirait par prolifération de sens et métamorphoses successives. De ce fait, la victimité héritée se transforme et se maintient dans une oscillation où, selon Michel, « émerge la reconnaissance de la victime comme nouvelle forme de subjectivité confrontée au traumatisme » (p. 111). Si je partage le constat de Michel au sujet de ce qu’on pourrait concevoir comme un souvenir des origines en devenir, la stabilisation victimaire publique allant de soi d’un tel dynamisme mémoriel me semble poser quelques problèmes d’interprétation et de définition.
Dans la reconnaissance poreuse des passés et des présents disponibles pour les « mémoires durcies » d’aujourd’hui, la question de la durée9du traumatisme demeure un impensé à l’œuvre dans l’immémorialisation des rapports de descendance. Par « immémorialisation », j’entends une activité de mythification, c’est-à-dire une narration des origines sous des formes imagées et libérées de la contrainte d’une reconstitution diachronique du passé mis en récits. À mon sens, c’est à travers une logique mythificatrice de l’immémorialisation que le traumatisme est devenu par la suite source de cérémonialisme patrimonialisateur. De cette manière, les divers registres commémoratifs du passé de l’esclavage pourraient être interrogés, en ayant recours à la leçon bien connue sur le rapport entre mythes et rites exposée dans le « Finale » de L’Homme nu. Dans ce texte, je le rappelle, Claude Lévi-Strauss observe que
« La fluidité du vécu tend constamment à s’échapper à travers les mailles du filet que la pensée mythique a lancé sur lui pour n’en retenir que les aspects les plus contrastés. En morcelant des opérations qu’il détaille à l’infini et qu’il répète sans se lasser, le rituel s’adonne à un rapetassage minutieux, il bouche des interstices, et il nourrit l’illusion qu’il est possible de remonter à contre-sens du mythe, de refaire du continu à partir du discontinu10. »
Entre matière et mémoire de l’esclavage, c’est la question de la durée du temps de la condition victimaire – celle des ancêtres, celle des descendants – qui, de nos jours, fait l’objet d’une cristallisation commémorative à répéter/rejouer, en fabriquant cérémoniellement du continu patrimonial à partir du discontinu de l’expérience historique et de la narration mythique. En tant que référence menacée par l’oubli, ce temps non-chronologique n’est pas immémorial par défaut de repères généalogiques, d’inventaires, d’archives, de témoignages et de dates commémoratives susceptibles d’être bonnes ou moins bonnes à penser. Il peut l’être par excès de réitération discursive : il n’arrive pas à cesser ; sans être actuel, il est présentifié. En raison de la mise en scène d’un legs moral dont des collectivités données seraient les héritières, ce temps retrouvé n’arrive pas non plus à commencer : il est commémoré, sans pouvoir être réellement fondateur. En effet, son identification avec l’époque esclavagiste est affectée par une relation d’intermittence entre ses origines et leur retentissement contemporain, alors que ces origines font l’objet d’une conquête généalogique, sans cesse renouvelée, du stigmate de l’histoire comme souffrance et endurance, condition nécessaire à la construction de leur « qualité épique11».
Il me semble donc nécessaire de confronter de manière critique l’évocation volontaire d’un passé symptomatique propre au devenir descendant d’esclave à la question d’une durée de la mémoire qui, à une échelle collective, fait plus problème que preuve. À ce titre, la créolisation du temps vécu par les « descendants » (avec le cumul des matrices disponibles pour dire le traumatisme hérité de l’esclavage) serait-elle le produit de la synthèse émotive et pragmatique entre des usages publics du passé et l’urgence de lutter au nom de la condition reconductible de victime ? Michel constate : « Le fait historique d’être descendant d’esclave est une chose, le fait de se labelliser sans honte comme descendants d’esclaves, le fait d’étiqueter des symptômes comme produits du système esclavagiste, le fait de catégoriser l’esclavage comme crime contre l’humanité en est une autre, qui suppose précisément un processus de construction sociale et historique » (p. 120). Or, le fait d’être descendant d’esclave n’est pas qu’un « fait historique », mais aussi une condition et un fait sociaux qui puisent leur performativité sémantique dans le présent. D’ailleurs, Michel lui-même revient sur son premier constat, en précisant « on comprend mieux en quoi être “descendant d’esclave” n’est pas simplement un état, une donnée historique ou biologique mais le produit d’un processus, d’une “existence” d’emblée collective qui procède de l’acte fondateur et de l’autocréation continue de l’institution symbolique d’une communauté imaginaire » (p. 257, je souligne).
Dans sa recherche d’un équilibre théorique – qui ne peut qu’être instable – entre approche constructiviste, qui lui permet (il l’autorise, en effet) de remarquer d’une manière péremptoire : « c’est une communauté imaginaire », et reconnaissance compréhensive des grammaires mobilisatrices susceptibles d’être appréhendées à la lumière d’« une herméneutique pragmatique post-structuraliste » (p. 121), Michel s’intéresse alors à l’existence d’« une activité délibérée et cohérente de construction de définition et de problématisation que l’on retrouve dans le public éclairé des descendants d’esclaves » (p. 121). Posons-nous la question : qu’est-ce qu’un « public éclairé » ? S’identifierait-il à des élites en quête d’hégémonie ? Les « constructions » (non imaginaires, mais bien réelles et parfois efficaces) dont ce public mémoriel, se fabriquant en tant que tel, est l’inspirateur et le récipiendaire, régentent-elles aussi les horizons d’attente et les émotions identitaires d’un public (« non éclairé » ?) de militants, souteneurs, prosélytes et spectateurs ?
Il faut le reconnaître : l’analyse de la communion ambiguë, entre demande d’institutionnalisation et affirmation d’un antagonisme, dans laquelle ce « public éclairé » baigne, suscite un embarras heuristique et interprétatif. D’un côté, nous (les chercheurs) étudions les narrations, les actions et les cérémonies qui façonnent des discours « publics », « culturels », « officiels » ; de l’autre côté, nous constatons, en les départicularisant de leurs conjonctures mémorielles, les vérités mouvantes auxquelles ces discours donnent lieu. Les faits ont bel et bien existé, mais leur resurgissement contemporain est, comme toujours en histoire et dans l’histoire, le produit éminent de tactiques, disputes, postures où la tragédie peut être donnée à voir et à penser à travers des dramaturgies, des scénographies, des scenarii dont nous sommes parmi les observateurs et les garants.
Groupe d'Afro-Américains attendant l'arrivée de la Marche du repentir et du devoir de mémoire à l'entrée du site dit Zomachi, janvier 2012, Ouidah, Bénin.
De nos jours, des « entrepreneurs » établissent, en reprenant les mots de Pollak, « une équivalence entre la mémoire qu’ils défendent et la vérité12». De ce fait, en s’appuyant simultanément sur leur identification à une indigénéité mémorielle (c’est-à-dire, dans le cas qui nous intéresse, sur leur appartenance à une communauté historiquement définie par l’expérience ancestrale et fondatrice de la traite négrière) et sur le caractère extraverti et stratégique de leurs actions, ils filtrent et mobilisent les traces du passé comme ressources politiques, juridiques, économiques. Leur place de maîtres de cérémonie nous oblige à penser autrement la question morale de la « juste distance » qu’ils mettent en scène et en symboles entre des mémoires en souffrance – qu’ils considèrent ataviques – dont ils se réclament être les porte-parole, et qu’un certain nombre de chercheurs définissent « incorporées » ou « implicites », et les enjeux politiques dont ces mémoires, désormais tournées aussi vers des regards extérieurs, sont les vitrines.
Selon mon point de vue, la mémoire incorporée, lorsqu’elle s’affiche en tant que telle dans les espaces cérémoniels, est déjà et désormais une mémoire instituée ou aspirant à le devenir. Les discours contemporains, avec les oublis qu’ils comportent, peuvent laisser imaginer des formes latentes de culpabilité historiquement opposées entre elles. Par exemple : un sentiment de honte peut se rapporter bien entendu au fait d’être reconnu et de se reconnaître comme descendant d’esclavagistes mais aussi à celui d’être reconnu et de se reconnaître comme descendant d’esclave. Dans les contextes observés par les chercheurs, les appréhensions dites implicites du passé de l’esclavage sont marquées par une très grande hétérogénéité. Les attitudes établies et tacites, les gestes individuels involontaires, les narrations familiales les plus morcelées, susurrées et allusives, les évocations personnelles ou circonstancielles peuvent être très fluctuantes13. La conscience du passé de l’esclavage semble alors opérer (ou remonter) comme si elle était constamment en sursis ou en apnée14. Ses traces « ethnographiques » ou ses représentations communautaires nous disent qu’une telle conscience est extrêmement mobile : elle est en même temps déjà là, sous-jacente au statut contemporain des individus qui peuvent en être affectés, et évolutive, c’est-à-dire aussi perméable aux tentatives de mythification et/ou d’institutionnalisation ritualisée qu’à chaque époque, ses divers « rhapsodes » racontent et mettent en œuvre. Multiple et fuyante, elle peut pourtant devenir l’enjeu d’une anamnèse publique ou, pour utiliser la formule déjà citée de Michel, une « reconnaissance de la victime comme nouvelle forme de subjectivité confrontée au traumatisme » et faire ainsi l’objet de reconstitutions vécues et mises en scène assurant une stabilité rhétorique à la figure du « descendant ».
Si, comme l’auteur l’affirme, « l’impact de l’esclavage sur les descendants passe moins par la mémoire explicite des souvenirs que par la mémoire implicite, mémoire-habitus, mais aussi mémoire inconsciente, symptômale » (p. 113), comment les entrepreneurs de mémoire entreprennent-ils en combinant cette mémoire-habitus et leurs projets mémoriaux ? Comme souvent dans l’histoire, le passé deviendrait-il le « butin » de ceux qui ont le pouvoir de le muer en « bien culturel », selon l’adage benjaminien15?
Il ne s’agit ni d’interroger la sincérité des élites mémorialistes du moment, ni de se limiter à sonder les strates narratives et les spirales « récitatives » multiples à travers lesquelles la valeur de ce patrimoine se sédimente. Ce qu’il me semble opportun de questionner – en maintenant une distance critique constamment (et non par intermittence) non-empathique – est le surgissement mouvant et polymorphe de mémoires bricolées en tant qu’artefacts historiques, symboliques, moraux. Leur vérité enfouie, refoulée, niée, oubliée est enfin exploitée à partir d’une durée problématique. Car cette durée est à la fois oublieuse et génératrice concrète ou potentielle de pratiques partiales et militantes autorisant, sur un mode projectif, son « nouveau » jaillissement sous forme de vérité habitée par une expérience traumatique. Dans ce cadre, l’évocation d’un oubli et la doxa discursive sur cet oubli fondateur de mémoire jouent un rôle crucial. L’oubli de ce passé aurait gardé « intacte » et donc authentique et authentificatrice du présent l’expérience dite ancestrale. Cette expérience primordiale serait enfin ressuscitée de ses tréfonds silencieux sous sa forme de « vérité oubliée et, par là même, gardée intacte16», et disponible à ses usages publics et donc à ses transformations contemporaines en tant que mémoire pragmatiquement incorporée et délibérément bricolée. Le traumatisme peut être transmis comme s’il était un héritage, et introjecté, en tant que patrimoine, dans les consciences de ceux qui deviennent ses détenteurs et porteurs ; le traumatisme est alors pratiqué comme un transformisme. En ce sens, tout en étant reliée à l’histoire de la violence originaire de l’esclavage, la mémoire dite matricielle de l’esclavage est un discours de type dynastique – c’est-à-dire conférant par le rang (dans ce cas, de descendant et de victime) un pouvoir d’agir – où la commémoration ritualisée du traumatisme vise à produire des effets politiques.
Devenir légataire d’un « bien » mémoriel
Dans le prolongement de mon texte « Le négrier en ancêtre fondateur : Francisco Felix de Souza “grand négociant et bâtisseur” à Ouidah17», je considère que l’observation des partialités ainsi que des subjectivités politiques et identitaires en jeu dans les vies publiques du passé de l’esclavage doit aussi être accompagnée d’une réflexion contournant la doxa équivoque déjà en place et à l’œuvre : s’il est possible de devenir descendant d’esclave, est-il également possible de devenir descendant d’esclavagiste ? Benjamin nous parle d’identification « par empathie » de l’historiciste au vainqueur, c’est-à-dire à celui qui hérite « des vainqueurs du passé », autrement dits « les maîtres du moment ». Nous pouvons nous poser la question si, en ce qui concerne le passé de l’esclavage, une telle identification par empathie ne guette pas les analystes en sciences sociales qui observent le devenir-descendant de ceux qui héritent des vaincus d’autrefois autrement dits « les victimes du moment ».
Émile Benveniste signale que dans la langue grecque ancienne :
« un bien se transmet directement au descendant, qui n’est pas pour cela qualifié d’héritier. On n’éprouvait pas alors ce besoin juridique de précision qui nous fait appeler “héritier” celui qui entre en possession de biens matériels, quel que soit son degré de parenté avec le défunt [...] le fils n’était pas désigné comme héritier ; n’étaient dits héritiers que ceux qui héritaient à défaut du fils ; c’est le cas des kherostaí, des collatéraux qui se partagent un bien tombé en déshérence18. »
Sans vouloir attribuer au cas grec traité par Benveniste une portée généralisante, cet exemple corrobore l’idée que faute de descendants directs, on peut devenir héritiers d’un bien ; l’héritage peut relever d’une appropriation ou d’un octroi qui n’est pas synonyme de transmission par filiation (soit-elle biologique, « en devenir » ou inventée).
Toujours dans La Mémoire culturelle, Jan Assmann rappelle que dans la deuxième dissertation de sa Généalogie de la morale, Nietzsche écrit que la mémoire naît de l’esprit du droit. La mémoire serait donc intimement liée à l’idée qu’il faut rétablir une juste condition à travers le rachat d’un oubli. Si on reste près de cette hypothèse, on pourrait en déduire que du point de vue de ceux qui ont perpétré le « mal », l’exigence du rétablissement d’une « juste condition » à travers l’effort mémoriel est ressentie d’une manière moins pressante, voire est complètement absente. En ce sens, de nos jours, il serait plus difficile de devenir descendant d’esclavagiste que descendant d’esclave ; de la même manière, il serait plus difficile d’hériter de ceux qui ont perpétré des crimes que de ceux qui les ont subis.
En ce qui concerne les recherches que je mène sur les mémoires culturelles du passé de l’esclavage, une telle hypothèse demande à être sensiblement nuancée. D’anciens comptoirs négriers, comme Ouidah au Bénin, Nantes en France, sont devenus des villes marquées par une inversion du stigmate, la reconnaissance de leur passé coupable ayant participé de leur transformation actuelle en cités-scènes d’un certain humanisme diasporique et cosmopolitisme culturel organisés19. De même, les descendants d’individus, de familles, de royaumes, qui ont été impliqués dans la traite négrière en tant que razzieurs, vendeurs, acheteurs, propriétaires exploitants, comme par exemple les de Souza à Ouidah ou la dynastie des souverains d’Abomey toujours au Bénin, revendiquent, parfois sur les modes de la dénégation, la trouble ascendance – à certains égards, fascinante20– du pouvoir exercé par leurs ancêtres esclavagistes. En ce sens, la patrimonialisation du passé de l’esclavage telle qu’elle est mise en scène au Bénin s’inscrit, elle-aussi, dans un contexte anthropologique et religieux caractérisé par des pratiques diffuses du malentendu (ou d’une sartrienne « mauvaise foi » ?), transformant les stigmates en emblèmes culturels. Il faut pourtant tenter d’appréhender d’une manière non équivoque de telles pratiques fondées sur l’accumulation et l’appropriation d’objets, de pratiques, de figures de l’histoire, de lieux tous dotés d’une portée performative très concrète. Ainsi, l’opposition qui renverse (et parfois brouille) les visions des différents vaincus de l’histoire participe d’un héritage à la fois commun et divisé, où l’affirmation d’une puissance révolue, comme celle des potentats esclavagistes qui ont précédé la colonisation française, peut être associée d’une manière paradoxale à la rhétorique politiquement correcte du repentir.
Ce qui diffère entre le processus analysé par Michel et les cas que j’ai esquissés très rapidement – et à leur tour susceptibles de comparaisons et de distinctions particulièrement importantes – est le genre de procédures normatives et d’appels affectifs qui rend le devenir descendant possible et discursivement efficace. D’un côté, le statut de dominé, victime, insurgé fait l’objet d’une projection dans le présent sous le signe d’une dette à commémorer et encore à réparer ; de l’autre, le pouvoir révolu des ancêtres ou de l’entité esclavagiste se métamorphose sous le signe d’une faute déjà expiée ou en train de l’être sous forme de reconnaissance morale du passé. Une telle expiation permettant, comme j’ai pu l’observer sur le tracé de la Route de l’Esclave au Bénin, la commémoration simultanée de la souffrance subie par les esclaves et la célébration d’une force royale qui fut esclavagiste, mais aussi, par la suite, anticoloniale et aujourd’hui imaginée par certains comme fondatrice de l’État béninois actuel21. Malgré ces différences majeures et leur opposition structurale, comme nous l’observons, dans mon article déjà cité, chez les héritiers attitrés de Francisco Felix de Souza à Ouidah et chez les entrepreneurs des divers discours mémoriels analysés par Johann Michel, les deux procédures intègrent et partagent le même moment historique de transformation du passé de l’esclavage en bien mémoriel politique et culturel et, parfois, personnel.
Mito Honoré Feliciano Juliao de Souza Chacha VIII à la célébration de l'anniversaire de la naissance de son ancêtre Francisco Felix de Souza, octobre 2006, Ouidah, Bénin.
En conclusion, nous le savons, le passé de l’esclavage n’a jamais cessé de se transmettre sous des formes de mémoires familiales, communautaires et « raciales » fortement divisées ; des formes de hiérarchisation ont structuré l’univers économique et sémiotique de l’aliénation esclavagiste. Leurs conséquences ainsi que leur souvenir agi et agissant continuent d’affecter les sociétés issues des traites négrières, avec leurs rapports de force instaurés aussi par les taxinomies régissant les logiques de la couleur, par exemple. Dans toutes les sociétés post-esclavagistes, les « descendants » d’esclaves ne constituent pas un bloc solidaire et métahistorique de porteurs du « même » traumatisme qui aurait traversé les siècles et les milieux. Dans toutes les sociétés post-esclavagistes, les commémorations de la traite transatlantique et l’actualisation victimaire du trouble psychique hérités de ce passé sont corrélées à des facteurs d’inégalité face aux problèmes et aux aspirations du présent. Elles sont corrélées aux formes contemporaines de fétichisation symbolique, morale et patrimoniale de ce passé, c’est-à-dire de fabrication d’un objet fictionnel doxique22. Si le fétiche est la dénégation, parce qu’il est précisément voué à préserver une croyance illusoire de sa désagrégation23, en essayant de rester au plus près du principe freudien, le traumatisme hérité pourrait correspondre à une forme de fétichisation qui nie, accepte et conserve la transformation du trauma comme bien culturel à détenir publiquement. En ce sens, les formes de capitalisation symbolique à l’œuvre dans les discours des descendants d’esclaves et d’esclavagistes ainsi que des stratégies patrimoniales que nous avons prises en compte sont relativement désincorporées du caractère psychique héréditaire du mal subi ou perpétré. Ces discours et ces stratégies manient le traumatisme rendu public comme l’objet émotif d’un intérêt politique.
Entre mémoires intimes et usages publics de la mémoire, la différence ne concerne pas les degrés d’intensité ou de vérité, mais le sens que les individus concernés confèrent à leur présence dans les conjonctures où leurs souvenirs émergent. Manifestations d’une souffrance personnelle ou collective pouvant être intimement vécue mais rituellement ou ponctuellement rejouée aussi (et surtout) pour des regards extérieurs, les commémorations propres au devenir descendant d’esclaves sont significatives d’un processus d’actualisation théâtrale du devenir des origines, c’est-à-dire de leur mise à distance vécue et incarnée par des acteurs. Dans ces contextes cérémoniels et identitaires, le devenir descendant est rendu réel aussi bien par le trauma hérité que par l’héritage convoité.
Notes
1
Daniel Fabre nous a quittés le 24 janvier 2016 ; ce texte lui est dédié.
3
Theresa A. Singleton, « The Slave Trade Remembered on the Former Gold and Slave Coasts », Slavery and Abolition, vol. 20, 1999, p. 150-169.
4
Bogumil Jewsiewicki, « Héritages et réparations en quête d’une justice pour le passé ou le présent », Cahiers d’études africaines, vol. 173-174, 2004, p. 7-24.
5
Parmi les auteurs qui, selon diverses perspectives, font appel à cette notion de « mémoire incorporée », citons à titre d’exemples : Nicolas Argenti et Ute Röschentaler, « Introduction. Between Cameroon and Cuba: Youth, Slave Trade and Translocal Memoryscapes », Social Anthropology, vol. 14, no 1, 2006, p. 33-47 ; Nicolas Argenti, « Remembering the Future: Slavery, Youth and Masking in the Cameroon Grassfields », Social Anthropology, vol. 14, no 1, 2006, p. 49-69 ; Christine Chivallon, L’Esclavage, du souvenir à la mémoire. Contribution à une anthropologie de la Caraïbe, Paris, Karthala/Ciresc, 2012 ; Rosalind Shaw, Memories of the slave trade. Ritual and the historical imagination in Sierra Leone, Chicago, The University of Chicago Press, 2002.
6
Michael Pollak, « Mémoire, oubli, silence », Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993, p. 17 et suiv.
7
Marc Augé, « Les syncrétismes », in Le grand atlas des religions, Paris, Encyclopædia Universalis France, 1988, p. 130.
8
J’emprunte l’expression à André Mary : Le Défi du syncrétisme. Le travail symbolique de la religion d’Eboga (Gabon), Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.
9
J’emploie ici le terme de durée dans l’acception bergsonienne de synthèse ; cf. Henri Bergson, Matière et mémoire [1896], in Œuvres, Paris, PUF, 1970. Le principe de sélection que les sciences sociales situeront à la base de l’acte anthropologique de la mémoire se présente pour Henri Bergson non comme une élaboration culturelle collective, mais comme immanente à une prise de conscience intuitive individuelle. Se souvenir du vécu serait donc en même temps explicitation « mémoriale » de la perception et contraction de la multiplicité des moments qui l’ont constituée. Après avoir découpé le réel, la mémoire traverserait l’espace temporel de son assimilation comme matière vécue dont il faut se rappeler, et le recomposerait en établissant une durée qui va du passé au futur, en passant par le présent. Dans ce sens, c’est l’usage du temps, sujet à métamorphose, qui s’achève dans l’oubli ou dans le souvenir. La faculté mentale de conserver et réveiller les images des choses vues ou écoutées ainsi que les idées acquises serait donc formée de deux moments simultanés : celui de la translation, qui porte l’intégralité de la mémoire dans la durée incessante du temps, et celui de la rotation, qui l’oriente « vers la situation du moment pour lui présenter la face plus utile » (p. 308). Le problème de la mémoire finit donc par être assimilé à celui de la durée, conçue comme synthèse où la dissociation et la juxtaposition des instants qui la composent se fondent dans une action où les individus laissent passer le temps grâce à un contrepoint crucial : l’immobilisation des faits à travers leur réminiscence.
10
Claude Lévi-Strauss, « Finale », L’Homme nu, Paris, Plon, 1971, p. 603.
11
Siegfried Kracauer, L’Histoire des avant-dernières choses, Paris, Stock, 2006, p. 100.
12
Michael Pollak, « Mémoire, oubli, silence », Une identité blessée, Paris, Métailié, 1993, p 30. En reprenant la partie du travail d’Howard Saul Becker (Outsiders. Études de sociologie de la déviance [1963], Paris, Métailié, 2012) sur les « entrepreneurs de morale », Pollak s’était intéressé aux entrepreneurs d’une mémoire officielle de la Shoah.
13
Sur ce sujet, voir : Martin Klein, « Studying the History of Those Who Would Rather Forget : Oral History and the Experience of Slavery », History in Africa, vol. 16, 1989, p. 209-217.
14
Je dois à Isabelle Ullern ce dernier mot que je trouve particulièrement suggestif.
15
« Le butin, selon l’usage de toujours, est porté dans le cortège. C’est ce qu’on appelle les biens culturels » ; Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire » [1939], Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p 432.
16
Jan Assmann, La Mémoire culturelle. Écriture, souvenir et imaginaire politique dans les civilisations antiques [2002], Paris, Aubier, 2010, p 203.
18
Émile Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. 1, Paris, Éditions de Minuit, 1969, p. 84 (en gras dans le texte).
19
Sur le cas de Nantes, voir : Renaud Hourcade, Les Ports négriers face à leur histoire. Politiques de la mémoire à Nantes, Bordeaux, Liverpool, Paris, Éditions Dalloz, 2014. Sur le cas de Ouidah, voir : Gaetano Ciarcia, Le Revers de l’oubli. Mémoires et commémorations de l’esclavage au Bénin, Paris, Karthala, 2016 ; « Du stigmate comme emblème. Le cumul des mémoires à Ouidah, ancien comptoir négrier », Ethnologie française, no 164, 2016, p. 691-700.
20
Dans le sens étymologique de porteuse d’un charme pouvant être à la fois attractif et maléfique.
21
Gaetano Ciarcia, « L’oubli et le retour. Figures d’une épopée mémorielle sur la Route de l’Esclave au Bénin », L’Homme, no 206, 2013, p. 89-120.
22
Sur la relation entre dénégation, fétichisme et croyance, voir les textes classiques de Sigmund Freud, La Dénégation [1925], Paris, Le Coq-Héron 1982 ; « Fétichisme » [1927], Œuvres complètes, Paris, PUF, 1994, p. 125-131 ; Claude Lévi-Strauss, « Le sorcier et sa magie », Les Temps modernes, no 41, 1949, p. 3-24 (réédité dans : Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958, p. 183-203) ; Octave Mannoni, « Je sais bien mais quand même… », Clefs pour l’imaginaire ou l’Autre Scène, Paris, Le Seuil, 1969, p. 9-33. Sur ce sujet, je me permets également de renvoyer le lecteur à mon article : « Le goût de la croyance. Sur la dénégation nécessaire et son objet fétiche », L’Homme, no 166, 2003, p. 171-184.
23
Sigmund Freud, « Fétichisme » [1927], Œuvres complètes, Paris, PUF, 1994, p. 125-131.