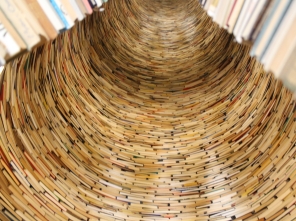(Université de Zadar, Croatie - Département d’études françaises et francophones)
(Université de Zadar, Croatie - Département d’études françaises et francophones)
Les traductions, en tant que produits sociaux et culturels, sont des vecteurs de circulation et, à ce titre, ont un impact sur le développement des systèmes culturels/littéraires, ainsi que sur les relations entre cultures/littératures. Depuis les années 1990, les échanges culturels entre la France et la Croatie se sont considérablement intensifiés précisément grâce aux traductions littéraires, et il convient donc de les examiner plus en détail.
Selon les données de la Bibliothèque nationale et universitaire croate (NSK), au cours de la période de dix ans, allant de 2012 à 2022, entre 4007 et 4966 livres ont été publiés chaque année en Croatie, le nombre d’ouvrages littéraires oscillant entre 1462 et 2304. En fait, les traductions représentent environ 45 % de la production littéraire annuelle. En 2020, par exemple, il a été publié 1002 titres croates contre 852 traductions. Cela signifie que les traductions littéraires occupent une part extrêmement importante du champ littéraire croate. Les traductions du français y occupent la deuxième place, après les traductions de l’anglais ; elles sont suivies des traductions de l’allemand, de l’italien, de l’espagnol, du russe, etc.
Dans la présente contribution, notre attention se focalisera sur les traductions des littératures française et francophones vers le croate entre 1991 et 2020, c’est-à-dire dans cette période de trente ans marqués par la transition vers une démocratie libérale et pluraliste et une économie de marché1. Le but de cette recherche est de déterminer dans quelle mesure les traductions publiées après 1991 ont conduit à la révision et à l’ouverture du canon de la littérature française – et francophone – dans la culture croate.
Les données ont été collectées au début de l’année 2023 en examinant systématiquement diverses sources bibliographiques disponibles et accessibles, notamment la base bibliographique Crolist, le catalogue de la Bibliothèque nationale et universitaire croate (NSK), le catalogue de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Zagreb, Index Translationum, ainsi que les sites web des maisons d’édition croates. La base bibliographique ainsi constituée à partir de titres traduits du français entre 1991 et 2020 inclut toutes les unités bibliographiques littéraires (prose, poésie, théâtre, essai) monographiques2.
Au cours des décennies précédentes, depuis la Seconde Guerre mondiale, le champ littéraire croate a connu une situation similaire sur le plan de la distribution des langues à partir desquelles on traduisait. Selon les données disponibles grâce à Dragojević et Cacan3, la plupart des traductions publiées entre 1945 et 1985 ont été faites à partir de l’anglais (705 titres américains, 476 titres britanniques, 11 titres canadiens anglophones, 8 titres australiens). Pendant la même période, 634 titres ont été traduits du français. Viennent ensuite les littératures allemande (437), russe (417), italienne (223), slovène (195), autrichienne (86), tchèque (77), polonaise (64), espagnole (52) et suédoise (40). Cette situation révélatrice, notamment quand il s’agit des littératures anglophones et russe, s’explique, d’un côté, par la position neutre de la Yougoslavie dès 1948 (l’année de la rupture entre Tito et Staline), et surtout depuis la Déclaration de Brioni signée par Tito, Nasser et Nehru en 1956 qui a mené à la création, en 1961, du Mouvement des non-alignés. D’un autre côté, elle reflète l’essor global des littératures anglophones, et celle américaine plus en particulier. En même temps, la deuxième position de la littérature française était certainement due au capital symbolique qu’elle avait accumulé depuis le XVIIIe siècle, ainsi qu’à la francophilie prononcée des intellectuels croates qui depuis le XIXe siècle désiraient s’affranchir de la domination germanique en se tournant vers Paris (August Šenoa, Eugen Kumičić, Antun Gustav Matoš, Tin Ujević, etc.). Les littératures allemande et italienne ont conservé, néanmoins, pour des raisons historiques, une position élevée dans le champ littéraire croate après la Seconde guerre mondiale4.
Cette situation correspond à peu près à celle que l’on retrouve à l’échelle mondiale. En fait, la place d’une langue sur le marché mondial de la traduction peut être mesurée par les flux de traductions. Selon Heilbron, le marché mondial de la traduction est hiérarchisé en langues hypercentrales, centrales, semi-périphériques et périphériques5. Les données statistiques concernant le marché international des livres traduits, tous domaines confondus, montrent qu’environ la moitié des livres traduits dans le monde ont été écrits en anglais. Viennent ensuite le français et l’allemand qui représentent entre 10 % et 12 % du marché mondial des traductions6. Huit langues, parmi lesquelles, notamment, l’italien, le suédois et l’espagnol, occupent entre 1 % et 3 % du marché international, tandis que toutes les autres langues sont considérées comme périphériques et détiennent moins de 1 % de marché7. Bien que la circulation internationale des livres soit influencée par des facteurs économiques, politiques et culturels très variés, les traductions circulent principalement du centre vers la périphérie, ce qui signifie que les langues (semi-)périphériques sont dans une large mesure des langues cibles8.
Malgré la domination de l’anglais, la langue française reste une langue centrale. Selon Sapiro9, le français a connu un déclin dans les années 1990 (de 10,8 % à 10 %) et au début des années 2000 (entre 8 % et 9 %), tout en gardant sa position centrale, après la langue allemande qui, de son côté, a connu une permanente hausse depuis les années 1980. Le français étant une langue centrale et le croate une langue périphérique, on peut faire l’hypothèse que les échanges sont asymétriques et qu’ils reflètent un rapport de domination (culturelle), ce que l’analyse empirique permet de vérifier.

Les traductions de la littérature française de 1945 à 1991
La culture a joué un rôle important dans l’affirmation du Parti communiste et de la nouvelle société yougoslave d’orientation socialiste. Une politique culturelle contrôlée a tout fait pour dévaloriser les systèmes politiques précédents et, d’un autre côté, a créé une base idéologique pour une culture prolétarienne différente de la culture d’élite bourgeoise perçue comme incompréhensible pour le travailleur moyen. En politique intérieure, la culture a joué un rôle intégrateur au sein d’un État multinational dirigé par le Parti. Jusqu’en 1948, le réalisme socialiste était le principal paradigme artistique, suivant un modèle importé d’URSS10.
Après la rupture entre Tito et Staline en 1948, la culture s’est vu confier la tâche d’établir un lien avec l’Occident. La culture pouvait très facilement et rapidement montrer la nouvelle orientation du Parti et de l’État, ou du moins en donner l’apparence. Le pays a commencé à s’ouvrir vers l’Ouest et à chercher de nouveaux modèles politiques et culturels11.
L’intervention du Parti dans la vie culturelle était systématique. Il a mis les maisons d’édition sous son contrôle12. Si la censure n’existait pas officiellement, les maisons d’édition l’exerçaient elles-mêmes. Le rôle des éditeurs était de fournir au peuple les œuvres nationales et internationales les plus importantes13, c’est-à-dire les classiques. La littérature grecque et latine, les littératures de l’Europe occidentale, la littérature russe et d’autres littératures slaves étaient parmi les plus traduites. À partir de 1952, le domaine culturel gagnait de plus en plus en autonomie par rapport au contrôle politique. C’est grâce aux traductions de la littérature anglaise et américaine que le pays s’est progressivement ouvert à l’Occident.
Les catalogues des éditeurs croates, serbes et bosniaques étaient régulièrement coordonnés afin d’éviter de traduire les mêmes titres, des efforts ayant été faits pour créer une zone linguistique serbo-croate uniforme et un marché littéraire serbo-croate unique14. Entre 1944 et 1959, 28 % des traductions provenaient du russe, 15 % de l’anglais, 11 % du français et 10 % de l’allemand15. Les auteurs russes dominaient dans les années qui ont suivi la guerre. Après s’être éloignée du bloc de l’Est, la Yougoslavie a eu besoin de se tourner vers l’Occident, en particulier vers les États-Unis, ce qui a généré une effervescence de stimuli culturels où la traduction a joué un rôle de premier plan16. André Breton, Albert Camus, L.-F. Céline, Gabriele d’Annunzio, T. S. Eliot, William Faulkner, James Joyce, Franz Kafka, Ezra Pound, Jacques Prévert, Jean-Paul Sartre, Gertrude Stein, Oscar Wilde, Virginia Woolf, etc., interdits dans d’autres pays communistes, ont été traduits. Parallèlement à cette nouvelle tendance, le nombre des auteurs soviétiques traduits diminuait.
Si l’on observe la période allant de 1945 à 1985, pour laquelle on dispose de données grâce à Dragojević et Cacan17, on s’aperçoit que cette ouverture de la Yougoslavie vers l’Ouest s’accompagne, à partir de 1952, d’une remarquable croissance du nombre de traductions publiées dans la République de Croatie18. Quant à la littérature française traduite en Croatie dans cette période, toujours selon Dragojević et Cacan, parmi les 634 titres figuraient 581 titres de prose (romans, nouvelles, etc.), 27 titres de poésie (dont 2 anthologies), et 26 titres relevant du théâtre (dont 1 anthologie). Les auteurs les plus traduits et publiés au cours de cette période étaient Honoré de Balzac, Jules Verne, Guy de Maupassant, Émile Zola, Alexandre Dumas, Stendhal, Albert Camus, Delly, André Gide, Juliette Benzoni, Anne Golon, Georges Simenon, Romain Rolland, etc.
Tableau 1. Les auteurs français les plus traduits et publiés en Croatie entre 1945 et 1985.
|
Auteur |
Nombre de (ré)éditions publiées |
|
Honoré de Balzac |
34 |
|
Jules Verne |
19 |
|
Émile Zola |
16 |
|
Guy de Maupassant |
16 |
|
Alexandre Dumas père |
14 |
|
André Gide |
13 |
|
Juliette Benzoni |
13 |
|
M. Delly |
12 |
|
Albert Camus |
11 |
|
Stendhal |
11 |
|
Georges Simenon |
11 |
|
Anne Golon |
9 |
|
Romain Rolland |
9 |
|
Gustave Flaubert |
5 |
|
Marcel Proust |
5 |
À l’époque, les maisons d’édition étaient de grandes structures étatiques qui publiaient régulièrement des séries d’ouvrages, voire des œuvres complètes d’un auteur (Zola, Gide, Camus, Balzac, Golon, Delly, etc.), des anthologies, en d’autres mots, des projets d’envergure. Parmi les traductions d’auteurs français, les classiques du XIXe siècle prédominaient (Balzac, Stendhal, Zola, Maupassant, Flaubert) suivis des classiques de la modernité (Gide, Proust, Rolland). On remarque également un intérêt accru pour la littérature de genre, notamment les polars (Simenon) et les romans sentimentaux (Benzoni, Golon, Delly), destinés à un public plus large. Jules Verne était, quant à lui, très présent en tant qu’auteur écrivant pour un public plus jeune également. Généralement parlant, l’évidente prédilection pour le corpus réaliste correspond aux canons littéraires promus dans les régimes communistes.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue qu’à l’époque de la Yougoslavie socialiste, de nombreuses éditions étaient imprimées, par exemple à Sarajevo ou à Belgrade, et que ces traductions étaient disponibles dans tout le pays, y compris en République Socialiste de Croatie. Par exemple, le roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, a été publié à Belgrade en 1959, dans la traduction de Zorica Mišković, tandis que L’Amant de la même auteure a été publié à Sarajevo en 1985, dans la traduction de Muhamed Nezirović. En Croatie, Brana na Pacifiku a été publié pour la première fois en 2002 et Ljubavnik en 1998, tous deux traduits par Ingrid Šafranek. Parfois, les mêmes traductions étaient publiées à Zagreb et à Belgrade. C’est le cas, par exemple, de Jacques le Fataliste de Denis Diderot, qui est d’abord paru dans la traduction de Raško Dimitrijević à Zagreb en 1963 sous le titre Fatalist Jacques, puis à Belgrade en 1975 sous le titre Fatalista Žak i njegov gospodar.
Après 1991 : Continuités et ruptures
Le processus de transition, qui impliquait l’abandon du mode de gestion socialiste et l’orientation vers l’économie de marché, a entraîné une restructuration radicale de l’édition croate après 199019. De nombreuses maisons d’édition indépendantes ont été fondées au cours de cette période, le plus souvent en tant qu’« aventures intellectuelles individuelles, non motivées par le profit20 ». La plupart des nouveaux éditeurs connaissaient déjà le secteur (ayant travaillé dans des maisons d’édition socialistes, par exemple). Leur capital initial étant extrêmement réduit, ils étaient contraints d’improviser21 dans un contexte difficile et très perturbé par la guerre d’indépendance qui a eu lieu entre 1991 et 1995.
Au tout début, une réduction importante du marché du livre, qui est passé de 23,5 millions de citoyens yougoslaves à 4,5 millions de Croates, ainsi que des processus de privatisation et de transition problématiques, ont provoqué une instabilité structurelle et fonctionnelle dans ce domaine, qui n’a jamais été surmontée. Plusieurs maisons d’édition importantes ont cessé leurs activités (notamment Mladost [Jeunesse] et Grafički zavod Hrvatske [Institut graphique de Croatie]), tandis que d’autres ont changé de propriétaire (Školska knjiga [Livre scolaire] et Znanje [Connaissance], par exemple). Le réseau des libraires s’est également effondré22, sans qu’un réseau de distribution national ne soit mis en place. En revanche, de nouvelles revues littéraires, festivals, prix littéraires et de traduction, associations professionnelles, méthodes de financement, etc., ont vu le jour au cours de cette période.
Au niveau mondial, le processus de mondialisation, le tournant digital dans l’édition dans les années 1990, la crise économique qui a commencé en 2008, ainsi que les crises causées par la pandémie du virus COVID-19 en 2020 et la guerre en Ukraine qui dure depuis 2022, ont fragilisé le secteur déjà instable de l’édition croate. Selon Hocenski23, pendant la crise économique, qui a duré plus longtemps en Croatie que dans le reste de l’Europe, les ventes de livres ont diminué de 30 à 40 %, de même que le nombre de titres publiés et le nombre d’exemplaires imprimés. Pendant la période de la pandémie, plus de 60 % des éditeurs ont connu une baisse de revenus de 50 % ou plus24.
Au niveau national, quelques autres événements survenus dans le secteur du livre au cours de ces trois décennies ont eu un impact important en créant d’énormes problèmes ou déséquilibres, tels que l’imposition d’une TVA de 22 % sur les livres au début de 1998, les « éditions kiosques25 » qui sont apparues en 2004, ainsi que la faillite de la maison d’édition et chaîne de librairies Algoritam en 2017. Par ailleurs, le financement de certains éditeurs par l’État à travers l’achat direct de livres scolaires, la vente de livres à la commission à un taux pouvant atteindre 55 % avec de longs délais de paiement, l’absence de réseau de distribution qui a incité certains éditeurs à ouvrir leurs propres (chaînes de) librairies, les coûts de production élevés, ainsi que le prix unitaire élevé26 n’ont pas contribué à la stabilisation du secteur de l’édition, malgré certaines mesures d’incitation de l’État introduites au milieu des années 1990. Enfin, la conversion à l’euro au début de l’année 2023 n’a fait qu’augmenter le prix du livre en Croatie.
On peut donc constater qu’au cours des trois dernières décennies, les éditeurs croates ont principalement opéré dans des conditions de crise, lesquelles sont devenues pour eux une sorte d’environnement naturel, en particulier pour les petits éditeurs (moins de cinquante employés), qui sont majoritaires.
Entre 1991 et 2020, un total de 1046 titres littéraires français a été publié en traduction croate27. Ainsi, une moyenne de 35 titres est publiée chaque année en traduction de la langue française. Malgré les conditions plutôt difficiles, la production est devenue plus importante à partir de la deuxième décennie, pour baisser de nouveau dans la troisième. En fait, au début du XXIe siècle, après la première décennie marquée par la guerre, le champ éditorial croate a connu un essor avec, d’un côté, une série de nouvelles maisons d’édition, et de l’autre, un soutien financier plus consistant et systématique de la part du ministère de la Culture et des autorités locales.
Tableau 2. Nombre des traductions littéraires publiées du français vers le croate entre 1991 et 2020.
|
Décennie |
Nombre de titres publiés |
Pourcentage |
|
1991 – 2000 |
189 |
18 % |
|
2001 – 2010 |
486 |
46,5 % |
|
2011 – 2020 |
371 |
35,5 % |
|
Total |
1 046 |
100 % |
Au cours de ces trois décennies, les auteurs les plus traduits et publiés ont été Antoine de Saint-Exupéry, Jules Verne, Charles Perrault, Honoré de Balzac, Samuel Beckett, Albert Camus, Émile Zola, Milan Kundera, Delly, Gustave Flaubert, Jean de La Fontaine, Molière, Amélie Nothomb, Marcel Proust, Frédéric Beigbeder, Anne Golon, Marguerite Duras, Michel Houellebecq, Guillaume Musso et Pascal Bruckner.
Tableau 3. Les auteurs de langue française les plus traduits entre 1991 et 2020.
|
|
Auteur |
Nombre de publications |
Nombre de titres publiés |
|
1 |
Antoine de Saint-Exupéry |
60 |
11 |
|
2 |
Jules Verne |
42 |
19 |
|
3 |
Charles Perrault |
35 |
*i |
|
4 |
Honoré de Balzac |
22 |
10 |
|
5 |
Samuel Beckett |
18 |
9 |
|
6 |
Albert Camus |
17 |
8 |
|
7 |
Émile Zola |
17 |
9 |
|
8 |
Milan Kundera |
16 |
9 |
|
9 |
Delly |
15 |
15 |
|
10 |
Gustave Flaubert |
15 |
5 |
|
11 |
Jean de La Fontaine |
15 |
* |
|
12 |
Molière |
14 |
9 |
|
13 |
Amélie Nothomb |
14 |
14 |
|
14 |
Marcel Proust |
14 |
3ii |
|
15 |
Frédéric Beigbeder |
12 |
8 |
|
16 |
Anne et Serge Golon |
11 |
11 |
|
17 |
Marguerite Duras |
10 |
9 |
|
18 |
Michel Houellebecq |
10 |
12 |
|
19 |
Guillaume Musso |
10 |
10 |
|
20 |
Pascal Bruckner |
9 |
7iii |
i. Perrault et La Fontaine sont représentés par différents contes (de fée) dans des formats variés.
ii. À la recherche du temps perdu est ici considéré comme une œuvre. La traduction croate intégrale existe, mais les retraductions et les rééditions concernent surtout Combray, figurant sur la liste de lectures obligatoires au lycée.
iii. Ce chiffre n’indique que le nombre de ses titres littéraires ; avec ses livres d’essais, Bruckner a 14 titres traduits en croate.
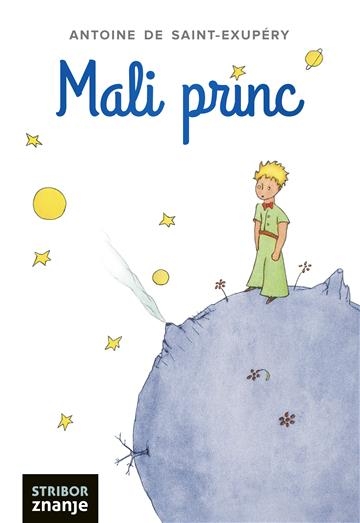
Édition croate du Petit Prince d’Antoine de Saint Exupéry (Éd. Stribor Znanje, traduit en croate par Sanja Lovrencic, 2023).
Ces données permettent de constater tout d’abord que la priorité est donnée à la prose. Parmi les auteurs les plus traduits figurent surtout les auteurs canoniques français, à quelques exceptions près, relatives à des titres à succès (Frédéric Beigbeder, Delly, Anne et Serge Golon, Guillaume Musso, Daniel Pennac) ou bien à des auteurs contemporains de renommée mondiale (Tahar Ben Jelloun, Pascal Bruckner, Philippe Claudel, Delphine de Vigan, Michel Houellebecq, Andreï Makine, Patrick Modiano, Amélie Nothomb, Lydia Salvayre, Michel Tournier). Parmi ces derniers, il faut compter également Milan Kundera, auteur tchèque qui s’est mis à écrire en français après son installation à Paris en 1975, et qui reste le seul auteur de langue française à voir son œuvre complète publiée en croate.
L’analyse de la base bibliographique montre que la plupart des ouvrages traduits ont originalement été publiés par les grandes maisons d’édition françaises, notamment Gallimard (176), Grasset (56), Éditions de Minuit (39), Éditions du Seuil (35), Albin Michel (34) et Flammarion (27).
Les prix jouent un rôle non négligeable dans la sélection des auteurs et ouvrages à traduire et à publier, les prix Nobel et les prix Goncourt figurant souvent dans les catalogues des éditeurs. Aussi est-il intéressant de noter qu’Annie Ernaux est représentée dans notre base avec deux titres seulement (Samo strast / Passion simple, 2002 ; Mjesto / La Place, 2008). À partir de 2021, et surtout depuis qu’elle a reçu le Prix Nobel (2022), sept titres ont été traduits, publiés, et pour la plupart réédités28, ce qui confirme le capital symbolique du prix suédois. Il en va de même pour Patrick Modiano qui, avant d’obtenir le prix Nobel, n’avait que deux titres traduits en croate (Ulica mračnih dućana / Rue des boutiques obscures, 1980 ; Mali dragulj / La Petite Bijou, 2005). Après 2014 de nouvelles éditions et des rééditions de ses ouvrages ont vu le jour29.
Les données montrent également que l’auteur le plus traduit et publié en Croatie, Antoine de Saint-Exupéry30, occupe à lui seul 5,8 % de la production totale à partir de la langue française, et que les 19 premiers auteurs, qui ont dix titres ou plus traduits du français vers le croate, concentrent 35 % de la production avec 367 livres publiés. Si on y ajoute les auteurs ayant entre trois et neuf titres traduits et publiés en Croatie, 86 auteurs représentent près de 63 % du nombre total des traductions du français.
Par ailleurs, le ratio entre le nombre des publications et le nombre des titres traduits permet de conclure que certains textes d’Antoine de Saint-Exupéry, Jules Verne, Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, Eugène Ionesco, Molière, Voltaire et Albert Camus ont été traduits et édités à plusieurs reprises. En revanche, certaines éditions comportent plusieurs titres du même auteur, par exemple celles de Ben Jelloun et Gide. Un large nombre de titres ont été traduits une seule fois, comme c’est le cas pour les livres de Bruckner, Nothomb, et du binôme Golon et Musso.
Trente éditeurs ont publié plus de dix titres entre 1991 et 2020. Les auteurs canoniques et les classiques de la modernité sont parmi les plus traduits, notamment ceux dont les livres figurent sur la liste des lectures obligatoires à l’école (en primaire et secondaire). Par ailleurs, un grand nombre d’auteurs publiés se trouve dans le domaine public, dont Charles Perrault et Jean La Fontaine, que différentes maisons d’édition publient régulièrement et dans des formats variés. Charles Baudelaire (4), Paul Claudel (3), Jacques Prévert (3) et Arthur Rimbaud (3) comptent à peu près le même nombre de livres publiés dans les deux périodes. En revanche, dans la période précédente, Charles Perrault (4), Voltaire (4), Alphonse Daudet (3), Denis Diderot (3), Eugène Ionesco (2), Jean Racine (2), Antoine de Saint-Exupéry (2), Jean de La Fontaine (1) et Marguerite Duras (1) ont très peu de publications par rapport à la période postérieure à 1991. On constate ainsi que le canon existant n’a pas subi de profonde révision ; depuis 1991, aucun « nouvel » auteur classique n’a été introduit dans le champ littéraire croate31. Cependant, quelques ouvrages d’écrivains catholiques français, peu présents dans la période précédente pour des raisons évidentes, ont été traduits : quatre romans de Joris-Karl Huysmans32, ainsi que plusieurs œuvres de Georges Bernanos33 et Paul Claudel34. On retrouve également quelques retraductions, de Madame Bovary par exemple35. Même si au premier abord on pourrait y voir une certaine ressemblance, voire une influence des États-Unis, où une nouvelle traduction de Lydia Davis a vu le jour en 201036, ce fait est plutôt lié en Croatie à la liste des lectures scolaires destinées aux lycées, sur laquelle figure le fameux roman de Flaubert.
À partir de 1991, les éditeurs suivent la production contemporaine d’une manière plus systématique. Certains se concentrent presque exclusivement sur la littérature contemporaine (Vuković&Runjić, Disput, Fraktura). Parmi les auteurs contemporains régulièrement publiés figurent Milan Kundera (dont l’œuvre complète est publiée par Meandar Media), ainsi que des auteurs à succès comme Amélie Nothomb et Frédéric Beigbeder (pour lesquels des stratégies de marketing particulièrement efficaces sont déployées). Pascal Bruckner est également très présent à cause de son soutien apporté à la Croatie lors de la dernière guerre.
Selon Mikšić37, on s’aperçoit que la part des traductions d’auteures de langue française parmi l’ensemble des traductions du français s’établit en moyenne autour de 17 % pour la décennie 1991–2000, 20 % pour la décennie 2001-2010, et 19 % pour la décennie 2011-2020. Dans la période allant de 1945 à 1985, leur part était de 16 %, ce qui nous amène à la conclusion qu’aujourd’hui la situation s’est très modestement améliorée pour les écrivaines. En revanche, la situation est nettement plus avantageuse – grâce au mouvement initié aux États-Unis – pour les auteures contemporaines, dont la part atteint 24 % (1991-2000), puis 40 % (2001-2010) avant de retomber à 35 % (2011-2020). Toujours selon notre base de données bibliographiques, parmi les auteures de langue française les plus présentes dans le champ littéraire croate, on retrouve notamment Delly, Amélie Nothomb, Anne Golon, Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar, suivies de Françoise Sagan, Lydie Salvaire, Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, Delphine de Vigan, Simone Weil, Jeanne Bourin, Catherine Clément, Virginie Despentes, Flora Dosen38, Yasmina Reza et Shan Sa39.
On constate également, depuis 1991, la présence d’un nombre plus élevé d’auteurs francophones, selon une évolution déjà observée pour les États-Unis40, qui semblent donner le ton. S’ils sont représentés dans plusieurs anthologies publiées dans cette période, c’est le plus souvent en tant qu’auteurs français. Le volume Onda sam to ja. Izbor iz suvremene frankofonske kratke proze41 est le seul à proposer un choix de vingt nouvelles francophones, avec une introduction qui contextualise la francophonie et les littératures de langue française42. Quant aux ouvrages monographiques, sur un total de 442 auteurs de langue française publiés dans la traduction croate depuis 1991, presqu’un quart sont des écrivains francophones ou français mais originaires d’un autre pays. Parmi les auteurs les plus présents sur le marché croate on retrouve Samuel Beckett (18), Milan Kundera (16), Amélie Nothomb (14), Marguerite Yourcenar (8), Tahar Ben Jelloun (7), Eugène Ionesco (7), Georges Simenon (6), Jean-Jacques Rousseau (6), Andreï Makine (5), Joël Dicker (4), Yasmina Khadra (4), Amin Maalouf (3), Rifaat Sallam (3), Leïla Slimani (3).
Sur un marché aussi réduit fonctionnant dans des conditions plutôt complexes, une politique culturelle qui soutient la production littéraire s’est progressivement développée. Différentes aides aux éditeurs et traducteurs sont proposées par le ministère de la Culture, par les autorités locales et régionales, ainsi que par les institutions européennes (Europe Créative) et étrangères. S’agissant de la traduction du français vers le croate, le Centre du livre français, l’Institut français de Paris, l’Institut français en Croatie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Pro Helvetia, etc. sont les institutions les plus présentes qui permettent aux éditeurs croates de poursuivre leurs activités et de proposer des traductions d’ouvrages de langue française au public croate qui, force est de constater, lit de moins en moins (en moyenne deux livres par an, selon une enquête menée par Karika koja nedostaje43 en mars 2024) et dont le pouvoir d’achat reste relativement faible par rapport au prix élevé des livres.
Des politiques éditoriales orientées vers l’Europe – remarques conclusives
Dans les deux périodes observées (1945-1985 et 1991-2020), les traductions ont une part importante dans le champ littéraire croate avec, en moyenne, 45 % de production littéraire annuelle quand il s’agit des trois dernières décennies.
Après la rupture de Tito avec Staline (1948) et jusqu’au début des années 1990, de nombreuses traductions ont été publiées avec l’idée de rapprocher la Yougoslavie de l’Occident. Dans cette période, une politique culturelle forte et dirigée imposait la traduction des classiques du XIXe siècle pour combler des lacunes et éduquer le peuple, sans pour autant oublier les auteurs majeurs du XXe siècle.
À partir des années 1990 et l’indépendance de la Croatie, la volonté de rapprochement de l’Union européenne, accompagnée d’un détachement net des anciennes républiques yougoslaves est très prononcée dans la politique culturelle du pays. La grande majorité des ouvrages traduits appartient, de ce fait, aux littératures européennes. La distribution des langues depuis lesquelles on traduit reste plus ou moins inaltérée, le russe n’ayant dominé que dans l’immédiat après-guerre, jusqu’en 1952.
Depuis 1991, les éditeurs croates ont réussi à créer un champ éditorial autonome. Ils ont travaillé dans des conditions sociales, politiques et économiques qui ont considérablement changé par rapport aux décennies précédentes, même si certaines formes de continuité ne peuvent être niées, comme la prédominance des traductions de l’anglais, du français et de l’allemand. En outre, les maisons d’édition, pour la plupart de petites entreprises, ont connu une crise constante. Le passage à l’économie du marché dans les années 1990 a entraîné des changements importants dans la logique de la production des livres : le potentiel commercial des livres doit désormais être pris en compte ; il n’y a plus, ou très peu, de projets éditoriaux d’envergure (anthologies, collections, œuvres complètes, etc.) ; les prix littéraires deviennent un repère de plus en plus pertinent (Nobel, Booker, Goncourt, etc.) ; le passage de certains auteurs dans le domaine public se reflète également dans les catalogues des éditeurs croates ; une place importante est réservée aux ouvrages figurant sur la liste des lectures scolaires (obligatoires ou facultatives). Enfin, les politiques d’aides favorisent cette orientation européenne des éditeurs croates.
Dans les deux périodes observées (1945-1990 et 1991-2020), les traductions de la littérature française dans le champ culturel croate étaient nombreuses et importantes, malgré le fait que les contextes et les motivations socio-politiques, économiques et culturels étaient nettement différents. Dans les deux cas, l’orientation vers la littérature française, et anglophone, reflète le souhait de se rapprocher de l’Occident.
Les relations littéraires franco-croates ont été et restent asymétriques, car la plupart des échanges vont de la langue française vers le croate, autrement dit du centre vers la périphérie.
Les littératures de langue française gardent, entre 1991 et 2020, leur deuxième position après les littératures anglophones. La prose est certainement la plus traduite. À partir de 1991 les éditeurs croates publient annuellement environ trente-cinq livres. Parmi les auteurs les plus (re)traduits et publiés on compte ceux dont les ouvrages sont libres de droits, qui sont destinés aux jeunes (ils sont souvent illustrés), et/ou qui figurent sur la liste des lectures scolaires. Certains auteurs ayant un grand potentiel commercial et très médiatisés, tels que Frédéric Beigbeder et Michel Houellebecq, qui ont su attirer l’attention des éditeurs et des lecteurs à l’échelle mondiale, ont non seulement été abondamment traduits et publiés en Croatie, mais aussi invités pour rencontrer le public croate pour lequel ils sont devenus presque des synonymes de la littérature française (contemporaine). Enfin, dans les trois dernières décennies, on remarque une présence majeure des auteurs catholiques, qui se sont vus (re)traduire.
Constatons, pour conclure, qu’après 1991, les livres écrits par des auteurs masculins français, publiés par Gallimard, Grasset, Minuit, Le Seuil, Albin Michel ou Flammarion, sont les plus susceptibles d’être traduits en croate. Ces résultats convergent avec ceux concernant les traductions de la littérature française aux États-Unis44. Le canon littéraire français établi dans la période précédente n’a été ni ébranlé, ni considérablement élargi. On perçoit cependant, depuis une vingtaine d’années, une présence prononcée de la littérature contemporaine, qui s’accompagne d’une majeure visibilité des auteurs francophones ou originaires d’un autre pays que la France, et des auteures.
Notes
1
Srećko Horvat et Igor Štiks (dir.), Dobro došli u pustinju postsocijalizma, Zaprešić, Fraktura, 2015 ; Guillermo A. O’Donnell et Philippe C. Schmitter, Tranzicija iz autoritarne vladavine: Provizorni zaključci o neizvjesnim demokracijama, traduit de l’anglais par Irena Gluhak, Zagreb, Centar za politološka istraživanja – Pan Liber, 2006 ; Vjeran Pavlaković et Goran Korovl (dir.), Strategije simboličke izgradnje nacije u državama jugoistične Europe, Zagreb, Srednja Europa, 2016 ; Nada Švob-Đokić, Tranzicija i nove europske države, Zagreb, Barbat, 2000, etc.
2
Les livres de jeunesse, les romans graphiques, la théorie, les ouvrages non-littéraires, ainsi que les traductions publiées dans des revues n’ont pas été pris en compte.
3
Nataša Dragojević et Fikret Cacan, Svjetska književnost u hrvatskim prijevodima 1945-1985. Bibliografija, Zagreb, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1988.
4
La forte présence de la littérature slovène est due, elle aussi, à des raisons historiques et au voisinage géographique, mais aussi au fait d’avoir fait partie de la fédération yougoslave.
5
Johan Heilbron, « Towards a Sociology of Translation: Book translations as a cultural world system », European Journal of Social Theory, vol. 2, n° 4, 1999, p. 429-444.
6
Le russe a, lui aussi, fait partie de cette catégorie des langues centrales jusqu’à l’effondrement des régimes communistes, quand le taux des traductions venant du russe a brutalement chuté, passant de 11,5 % à 2,5 % (cf. Gisèle Sapiro, « Situation du français sur le marché mondial de la traduction », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS, 2008, p. 69.
7
Johan Heilbron et Gisèle Sapiro, « La traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS, 2008, p. 29.
8
Pascale Casanova, La Langue mondiale. Traduction et domination, Paris, Seuil, 2015 ; Johan Heilbron et Gisèle Sapiro, « La traduction comme vecteur des échanges culturels internationaux », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS, 2008, p. 25-44 ; Theo D’haen, Iannis Goerlandt, Roger D. Sell, Major versus Minor? Languages and Literatures in a Globalized World, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, 2015 ; Gisèle Sapiro, « Situation du français sur le marché mondial de la traduction », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS, 2008, p. 65-106 ; Gisèle Sapiro, « Les grandes tendances du marché de la traduction », in B. Banoun, I. Poulin, Y. Chevrel (dir.), Histoire des traductions en langue française, XXe siècle, Paris, Verdier, 2019, p. 55-158.
9
Gisèle Sapiro, « Situation du français sur le marché mondial de la traduction », in G. Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS, 2008, p. 69-82.
10
Zlata Knezović, « Obilježja boljševizacije hrvatske kulture (1945. – 1947.) », Časopis za suvremenu povijest, n° 24, 1992, p. 101-132.
11
Branka Doknić, Kulturna politika Jugoslavije 1946-1963, Belgrade, JP Službeni glasnik, 2013 ; Magdalena Najbar-Agičić, Kultura, znanost, ideologija: prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Zagreb, Matica hrvatska, 2013.
12
Maria Rita Leto, « The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952 », in Ch. Rundle, A. Lange et D. Monticelli (dir.), Translation Under Communism, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, p. 179.
13
Maria Rita Leto, « The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952 », in Ch. Rundle, A. Lange et D. Monticelli (dir.), Translation Under Communism, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, p. 184-185.
14
Maria Rita Leto, « The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952 », in Ch. Rundle, A. Lange et D. Monticelli (dir.), Translation Under Communism, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, p. 86-187.
15
Maria Rita Leto, « The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952 », in Ch. Rundle, A. Lange et D. Monticelli (dir.), Translation Under Communism, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, p. 188.
16
Maria Rita Leto, « The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952 », in Ch. Rundle, A. Lange et D. Monticelli (dir.), Translation Under Communism, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, p. 194.
17
Nataša Dragojević et Fikret Cacan, Svjetska književnost u hrvatskim prijevodima 1945-1985. Bibliografija, Zagreb, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1988.
18
La bibliographie exhaustive des traductions littéraires publiées entre 1986 et 1990, n’est malheureusement toujours pas disponible.
19
Nives Tomašević et Miha Kovač, Knjiga, tranzicija, iluzija, Zagreb, Naklada Ljevak, 2009.
20
Anne Madelain, « Izdavači u postjugoslavenskom prostoru: nasljeđe, kontinuitet i pamćenje », in A. Buhin et T. Filipović (dir.), Kontinuiteti i inovacije. Zbornik odabranih radova s Četvrtog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi – Kontinuiteti i inovacije, Zagreb – Pula, Srednja Europa – Sveučilište Jurja Dobrile, 2021, p. 181.
21
Ines Hocenski, Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020., thèse de doctorat, sous la direction de Zoran Velagić. Zadar, Université de Zadar, 2023, p. 193.
22
Ines Hocenski, Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020., thèse de doctorat, sous la direction de Zoran Velagić. Zadar, Université de Zadar, 2023, p. 118.
23
Ines Hocenski, Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020., thèse de doctorat, sous la direction de Zoran Velagić. Zadar, Université de Zadar, 2023, p. 50.
24
Ines Hocenski, Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020., thèse de doctorat, sous la direction de Zoran Velagić. Zadar, Université de Zadar, 2023, p. 60.
25
Les livres qui pouvaient être achetés avec les journaux ou même séparément dans les kiosques pour un prix modique.
26
Ines Hocenski, Poslovanje nakladnika u kriznim razdobljima: hrvatsko nakladništvo od 1990. do 2020., thèse de doctorat, sous la direction de Zoran Velagić. Zadar, Université de Zadar, 2023, p. 50.
27
Cf. Vanda Mikšić, Mirna Sindičić Sabljo et Željka Tonković, « Francuska i frankofonske književnosti u prijevodima na hrvatski jezik od 1991. do 2020. godine », Književna smotra, vol. 209, n° 3, 2023, p. 34.
28
Jedna žena / Une femme, 2021, 3 éditions ; Djevojačke uspomene / Mémoire de fille, 2022, 2 éditions ; Događaj / L’Événement, 2022, 2 éditions ; Godine / Les Années, 2022, 2 éditions ; Izgubiti se / Se perdre, 2023 ; Sram / La Honte, 2023, 2 éditions, Nisam izašla iz svoje noći / Je ne suis pas sortie de ma nuit, 2023. Samo strast a également été réédité en 2022.
29
Ulica mračnih dućana, 2014 ; Mali dragulj, 2014 ; Dora Bruder, 2015 ; Mjesto za zvijezdu / La Place de l’étoile, 2016 ; U kavani izgubljene mladosti / Dans le café de la jeunesse perdue, 2023.
30
Parmi les onze ouvrages qui ont été traduits et publiés, seul Le Petit Prince a connu plusieurs rééditions et retraductions. Mia Pervan l’a traduit la première en croate en 1973 ; depuis, cette version a connu 26 rééditions. À partir de 1991, seize traducteurs se sont attelés à la tâche, dont quatre ont travaillé en binôme. Cinq versions ont connu plusieurs (ré)éditions : celles de Maja Vukušić Zorica (3), Robert Martinov (6), Goran Rukavina (6), Sanja Lovrenčić (9) et Ivan Kušan (11). Au total, on compte 58 (ré)éditions de l’ouvrage entre 1991 et 2020. La plupart des traductions ont été faites en croate standard, mais on compte également cinq versions dialectales, dont deux ont été publiées à l’étranger (Autriche et Allemagne).
31
Tenant compte du fait que, à l’époque yougoslave, des auteurs français et leurs ouvrages étaient disponibles également dans les traductions publiées en Serbie, en Bosnie-Herzégovine et au Monténégro. Plus haut, nous avons déjà évoqué le cas de Marguerite Duras ; on peut y ajouter les auteurs tels qu’Antonin Artaud, Georges Bataille, Simone de Beauvoir, François-René de Chateaubriand ou Joris-Karl Huysmans, qui avaient été traduits en serbe et qui, donc, étaient accessibles au lectorat croate. Chose curieuse, en 2005, ce dernier s’est vu traduire en croate deux fois (par Ana Buljan et Vjekoslav Boban) et publié par deux maisons d’édition de Zagreb (Litteris et Naklada Jurčić).
32
Naopako (A rebours, 2005), Pakao (Là-bas, 2011), Na putu (En route, 2012), Katedrala (La Cathédrale, 2015).
33
Pod sotoninim suncem (Sous le soleil de Satan, 2008), Sveti Dominik (Saint Dominique, 2017), Gospodine Ouine (Monsieur Ouine, 2020), Zločin (Un crime, 2021), Prijevara (Imposteur, 2024).
34
Križni put (Le Chemin de la croix, 2005), Improvizirani memoari (Mémoires improvisés, 2008), Tobija i Sara (L’Histoire de Tobie et Sara, 2021).
35
De Mia Pervan (2003) et de Divina Marion (2006), notamment, la première étant celle de Josip Matijaš (1957).
36
Gisèle Sapiro, « Translation and Symbolic Capital in the Era of Globalization: French Literature in the United States », Cultural Sociology, vol. 9, n° 3, 2015, p. 20.
37
Vanda Mikšić, « Pitanje rodnog (dis)pariteta u prijevodima francuskih i frankofonskih autora u Hrvatskoj od 1991. do 2020. godine », Anafora, vol. X, n° 2, 2023, p. 285-309.
38
Écrivaine française d’origine croate.
39
Vanda Mikšić, « Pitanje rodnog (dis)pariteta u prijevodima francuskih i frankofonskih autora u Hrvatskoj od 1991. do 2020. godine », Anafora, vol. X, n° 2, 2023, p. 303.
40
Aux États-Unis, il s’agissait surtout des littératures de langue française venant d’Afrique et du Maghreb. Gisèle Sapiro, « Translation and Symbolic Capital in the Era of Globalization: French Literature in the United States », Cultural Sociology, vol. 9, n° 3, 2015, p. 1-27.
41
Vanda Mikšić et Mirna Sindičić Sabljo, Onda sam to ja. Izbor iz suvremene frankofonske kratke proze, Zagreb, Meandar Media, 2020.
42
Par ailleurs, deux numéros thématiques ont été accueillis par la revue scientifique et littéraire Književna smotra, consacrés aux lettres francophones belges (180, 2, 2016) et canadiennes (192, 2, 2019). La revue littéraire Tema a, quant à elle, proposé un dossier sur la littérature belge francophone (1-3, 2018), ainsi qu’un dossier sur la littérature autochtone du Québec (4-6, 2018).
43
https://knjigasvimaisvuda.znk.hr/istrazivanje-o-navikama-citanosti-2024 (dernière consultation le 2 décembre 2024).
44
Gisèle Sapiro, « Translation and Symbolic Capital in the Era of Globalization: French Literature in the United States », Cultural Sociology, vol. 9, n° 3, 2015, p. 1-27.